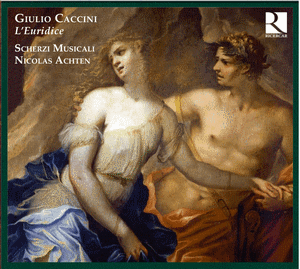Ce n’est pas tous les jours qu’un inédit paraît en CD. En l’occurrence, l’événement est d’autant plus remarquable qu’il s’agit du premier opéra jamais imprimé : L’Euridice de Giulio Caccini, publiée à Florence en 1600 et gravée par le label RICERCAR… en 2008 ! Est-ce le premier opéra de l’Histoire ? Le premier ouvrage créé sur scène est-il le premier à avoir été composé ? Qui a inventé le genre ? Comment chantait-on à l’époque ? L’Euridice de Caccini nous convie à un voyage aux origines de l’univers, cette fascinante genèse de l’opéra qui n’a pas encore livré tous ses secrets. FORUM OPERA a rencontré le maître d’œuvre de cet enregistrement, Nicolas Achten, directeur de l’ensemble Scherzi Musicali et interprète du rôle d’Orphée. 50 ans après les prémices de la révolution baroque, même si d’indéniables progrès ont été réalisé, l’interprétation des ces œuvres fondatrices soulève encore de nombreuses questions. Heureusement, la flamme des défricheurs est intacte, elle anime une nouvelle génération avide de comprendre et d’explorer ce formidable laboratoire de la musique de théâtre européenne.
A part « Amarilli mia bella », une des plus célèbres arie antiche avec lesquelles les chanteurs lyriques s’échauffent volontiers la voix, la musique de Caccini n’est guère connue. C’est pourtant un pionnier de la monodie accompagnée et de l’opéra. Comment expliquez-vous que son Euridice intéresse si peu les musiciens ?
D’abord, Caccini reste dans l’ombre de Monteverdi, dont l’Orfeo est un véritable chef-d’œuvre, largement représenté et intégré au répertoire. On a un peu oublié ce qui s’est fait avant au point de croire que l’Orfeo est le premier opéra de l’Histoire. Il y a quelques curieux qui savent qu’une version de Peri existe aussi, mais affirment qu’elle n’est d’un intérêt que musicologique. Ce qui soulève déjà une question : comment peut-on juger une œuvre pareille aujourd’hui si on ne lui a pas donné la chance d’exister ?
Cette Euridice de Peri a quand même été remontée et même enregistrée à plusieurs reprises, alors que pour celle de Caccini, votre enregistrement est une première mondiale en CD…
Oui, en fait les deux ont été écrites au même moment, mais celle de Caccini dans le dos de Peri. Aussi, l’histoire de la musique a en quelque sorte condamné l’opéra de Caccini en considérant un peu comme une trahison le fait de s’y intéresser. A l’époque, Caccini dominait la vie musicale florentine. Il était responsable d’un spectacle auquel assistèrent environ mille cinq cents personnes, avec quatre-vingts artistes sur scène, Il Rapimento di Cefale, dont nous n’avons conservé que quelques extraits dans les Nuove musiche1. Le lendemain de la création, un plus petit spectacle était donné dans le Palazzo Pitti, l’Euridice de Peri sur un livret de Rinuccini. Des élèves et même des filles de Caccini figuraient parmi les interprètes. Caccini est intervenu dans l’écriture de certains passages : les interventions d’Eurydice, de certaines Nymphes et une partie des chœurs. Caccini est parfois évoqué dans l’ombre de Peri, alors que c’était l’inverse. La partition de Peri devait être publiée en janvier, mais Caccini l’a pris de vitesse. Il faut savoir que tous ces compositeurs appartenaient à la Camerata Bardi, qu’ils avaient les mêmes références et ont réfléchi ensemble à la genèse de l’opéra. Ils s’en disputent la paternité et on ne sait pas vraiment qui l’a inventé. Caccini est le seul à avoir publié une réflexion très construite, dans les Nuove Musiche, neuf pages denses et d’une écriture menue. Sans doute persuadé d’avoir forgé cette forme, ce nouveau langage, il a voulu être le premier à publier une Euridice. On ne sait pas s’il a commencé à l’écrire après la représentation de celle de Peri, estimant qu’elle ne correspondait pas à la manière dont il fallait écrire un opéra. Très idéaliste, Caccini voulait sans doute que le premier opéra imprimé reflète sa vision des choses. On pourrait aussi dire qu’il était jaloux. La relation entre Peri et Caccini était très complexe, comme souvent entre pairs.
Vu l’importance des écrits théoriques de Caccini et son rôle dans la Camerata florentine, il il est étonnant que son Euridice n’ait pas davantage retenu l’attention…
Beaucoup de personnes se sont penchées sur l’Euridice de Peri, qui est une œuvre très intéressante et belle, mais assez difficile à interpréter. Un musicologue a même consacré une thèse à la confrontation des deux Euridice, écrites sur le même livret, mais en prenant pour points de comparaison les passages de l’ouvrage de Peri qui avaient été écrits par Caccini (Eurydice, les Nymphes…) et sa conclusion, c’est que Peri est un meilleur compositeur ! Quand j’avais douze ou treize ans, je pense, j’ai lu qu’il y avait eu avant l’Orfeo de Monteverdi, une Euridice de Peri ainsi qu’une autre de Caccini. A l’époque, je suis allé en bibliothèque, mais je n’ai rien trouvé et je trouvais cela assez curieux. J’ai découvert la musique de Caccini par Amarilli, sans doute comme tout le monde, et je me disais que son opéra devait valoir la peine. Je découvrais alors le chant et la musique ancienne. Je savais que devais lire sa préface aux Nuove Musiche, j’avais une vague traduction en anglais, mais bon, je ne comprenais rien à l’époque [Rires !] J’ai dirigé l’Euridice à l’Opéra Studio des Flandres, où, depuis trois ans, je suis responsable de la musique ancienne. Nous montons un opéra chaque année et ce sont les premiers à m’avoir laissé prendre un risque pareil, avec un ouvrage à peu près inconnu. En fait, les deux Euridice reflètent les différences de tempérament entre les compositeurs. Peri essaie de convaincre en usant de dissonances et d’effets plastiquement moins beaux, mais expressifs, alors que Caccini (on le lui a reproché) est plus séducteur, et c’est ce qui rend aujourd’hui sa musique plus « accessible ». Chez Peri, il n’y a rien de vocal, dans le sens où il n’y a pas de mélodie, même dans le recitar cantando, il y a beaucoup de notes répétées et le texte domine sans partage, par contre, Caccini s’oriente vers un mélodisme, implicite, mais qui pour Peri dévie déjà trop du texte. Caccini va se permettre des diminutions et une écriture plus vocale, mais bon, ce n’est pas encore du Puccini [Rires] !
Alors justement, que diriez-vous aux fans d’opéra qui redoutent un ouvrage aride, dominé par le récitatif et qui laisse peu de place au chant ?
Je réécoutais récemment Pelléas et Mélisande et, pour moi, cet opéra est quasiment moins vocal que l’Euridice de Caccini.
Mais n’est-il pas plus expressif ?
C’est une question de goût, c’est une autre langue aussi, il y a beaucoup plus d’ondulations dans l’intonation de l’italien alors que le français est une langue beaucoup plus plate, Debussy en était conscient et a donc voulu quelque chose de très statique. Caccini me touche plus, mais c’est très personnel…
Vous pensez donc que cet ouvrage peut toucher le public d’aujourd’hui, même si le récitatif domine ?
Oui, parce que c’est un récitatif mélodique, ce n’est pas du tout un récitatif haendélien, sec, parce que là, on perdrait un peu le fil…
La pratique du recitar cantando ne s’est pas transmise jusqu’à nous, comment avez-vous abordé ce style si particulier, à mi-chemin entre la déclamation et le chant ?
Nous avons des sources très détaillées et précises, mais qui laissent aussi plein de points d’interrogation. On sait ce qui l’a inspiré: c’est la pratique des Grecs, on sait encore, selon les philosophes et les textes grecs et romains, comment la tragédie antique était exécutée. On connaît également la vision des artistes et intellectuels de la Camera Bardi, on a des échanges de correspondances, les recommandations de Caccini sur la manière d’interpréter ses œuvres et sur le concept, fondamental, de sprezzatura qu’il a véritablement élaboré : au départ, c’est une attitude prescrite au courtisan, mais qui s’applique aussi au musicien, à l’artiste en général comme à l’orateur, c’est cette faculté de présenter ce qui a été travaillé comme quelque chose de naturel ou inné.
Faire passer l’artifice pour quelque chose de spontané ?
Voilà, garder cette spontanéité, qu’il s’agisse d’un musicien ou d’un avocat qui plaide, il faut que cela semble complètement improvisé, naturel et facile, alors que – Caccini le dit très clairement –, dans le cadre du chant, toutes ces choses sont à travailler pendant des années. En fait, il donne différentes explications de la sprezzatura, parfois plusieurs définitions dans le même texte, dans ses deux préfaces aux Nuove Musiche comme dans sa préface à l’Euridice. Il y a donc quatre ou cinq explications de cette notion clé, entre autres cette idée de souplesse rythmique dans l’exécution du recitar cantando : le rythme noté se rapproche du rythme parlé, on voit très clairement qu’il a essayé de trouver la meilleure façon de noter le rythme naturel de la langue, mais en ne disposant que du solfège existant (blanches, noires, croches, doubles croches et valeurs pointées). S’il avait voulu noter exactement le rythme du langage parlé, il aurait dû avoir recours à des rythmes très complexes comme on en rencontre parfois dans la musique contemporaine où dans la notation des partitions de chanteurs pop ou de jazz, qui, à la lecture, semblent très compliqués, alors que ce sont en réalité des rythmes fort simples mais avec un peu de rubato. La sprezzatura, c’est donc le naturel aussi bien rythmique que rhétorique, dans la manière d’ajouter des diminutions, de petits ornements qui renforcent l’expression du texte.
C’est donc une rupture avec la musique de la Renaissance où les diminutions étaient surtout des éléments décoratifs et purement virtuoses ?
Oui tout à fait, pour Caccini, il ne faut pas les utiliser gratuitement. Peri, lui, les abolit : il n’y a aucune diminution écrite, on sent que pour lui, c’est hors de propos. Peri est un puriste, obnubilé par le texte. Caccini poursuivait aussi son idéal mais il avait davantage le sens du contact avec le public et cherchait à plaire.
La partition de Caccini pose-t-elle des problèmes en matière d’effectif instrumental ou pour la réalisation des chœurs, comme celle de l’Orfeo de Monteverdi ?
Nous avons moins de questions, mais en même temps moins d’informations.
Autrement dit, vous avez plus de liberté mais aussi de responsabilités ?
Oui ! A mon avis – le sujet est fort débattu –, la partition de l’Orfeo que nous avons est plutôt le témoignage de ce qui s’est fait en 1607, dans un lieu donné, avec son acoustique propre, comme avec les chanteurs et les instrumentistes disponibles. Il écrit, par exemple, que ce passage a été joué par tel et tel instrument. Il y a des endroits où il donne des indications très précises même pour deux mesures, « là, il faut le clavecin et le théorbe » pour une demi phrase. Par contre, au cinquième acte, par exemple, Orphée est seul, avec la basse continue, pendant cinq pages, et nous n’avons aucune indication sur la réalisation de cette basse, or il va de soin que les interprètes la coloraient suivant cette pratique décrite par les contemporains de Caccini, comme Cavalieri2, qui dit qu’il faut changer aussi souvent que possible pour éviter l’ennui, et changer les couleurs en fonction de l’émotion.
C’est ce que vous avez essayé de faire dans l’Euridice, en variant constamment le continuo…
Oui, l’œuvre de Caccini est très ouverte. On connaît l’effectif de Peri, mais pas celui de Caccini : il avait un clavecin, un chitarrone (théorbe), un liuto grosso – on ne sait pas si c’est un luth Renaissance, plus grave, utilisé plutôt comme ornement ou complément du théorbe, ou si c’est un liuto attiorbato, donc un petit archiluth, c’est le choix que j’ai fait pour compléter le théorbe. Il avait aussi une lira granda, donc un lirone.
Vous êtes très attaché au timbre et à la sonorité de cet instrument, qu’a-t-il de spécial ?
C’est une sorte de viole de gambe à treize cordes, avec un chevalet plus plat que celui de la gambe, ce qui permet de jouer quatre cordes en même temps. C’est comme un consort de gambes en un seul instrument, cela donne un son assez magique. C’est un instrument qui ne joue que les accords et pas de basse, il est accordé en quintes et sa tessiture est plutôt réduite, mais on peut jouer tous les accords possibles et imaginables. Ce n’est donc pas un instrument qui se suffit à lui-même mais il se marie fort bien avec les autres et il offre en plus la possibilité de réaliser pas mal de nuances, ce qui est fort intéressant dans ce répertoire. J’ai essayé de rassembler tous les instruments qui étaient probablement utilisés à l’époque de Caccini, non pas pour dresser un inventaire musicologique, mais pour servir au mieux l’émotion du texte.
Vous confiez les rôles de la Tragédie et de la Messagère à un falsettiste (contre-ténor), Magid El Bushra. Or, dans sa préface aux Nuove Musiche, Caccini écrit que « des voix feintes [le voce finte] ne peut naître la noblesse du bon chant qui vient d’une voix naturelle, à l’aise dans toute l’étendue » : cette critique ne vise-t-elle pas précisément les falsettistes ?
Pas forcément, cela dépend de la manière dont nous interprétons aujourd’hui la terminologie de l’époque. Caccini dit qu’on peut transposer ses airs de manière à ce que toutes les notes chantées soient dans la tessiture du chanteur, il pense notamment aux voix d’hommes, il dit que si un air monte trop, on peut le transposer vers le grave, parce qu’il ne faudrait pas devoir utiliser la « voce finta ». Il y a, par exemple, des airs pour basse qui montent au sol aigu. Caccini dit qu’on peut les transposer afin de ne pas chanter ces notes, hors tessiture, en fausset. Personnellement, je comprends qu’un chanteur ne doit pas, subitement, sur les notes aiguës, passer dans un registre qu’il n’aurait pas travaillé et qui sonnerait mal. Il faut faire confiance à son oreille.
Donc par voce finta, il veut dire un fausset mal travaillé ?
Oui, en tout cas une voix qui n’est pas cohérente. C’est ma vision des choses.
Ce n’est donc pas trahir Caccini que d’utiliser un contre-ténor ?
Non, Caccini cherchait l’émotion du texte et je ne pense pas que l’emploi d’un contre-ténor nuise à l’émotion de la Messagère. J’ai voulu confier ce rôle à un homme pour suivre l’idée de Peri et démarquer le personnage. Peri l’a donné à un enfant. Pour en revenir à cette histoire de registre, Caccini oppose à la voix « feinte », la voix « pleine et naturelle », or, quand un soprano féminin chante, il n’utilise pas sa voix parlée naturelle, c’est déjà un mécanisme similaire à celui du contre-ténor, c’est sa voix de tête. Bien sûr, elle est plus étendue que celle du contre-ténor et pour mixer, dans les graves, les femmes utilisent souvent leur voix de poitrine alors que le contre-ténor aura plus de mal à développer un passage homogène, mais certains y arrivent, comme Gérard Lesne ou Dominique Visse. J’assume donc complètement mon choix.
Dans la fable de Rinuccini, Eurydice est un personnage fantomatique et inconsistant, qui ne fait que deux brèves apparitions. C’est Orphée le protagoniste et donc le premier héros de l’histoire de l’opéra. Pourquoi Eurydice donne-t-elle son nom à l’ouvrage ?
Caccini utilise le livret que celui que Peri a mis en musique pour le mariage de Marie de Médicis avec Henri de Navarre. Il intitule donc sa fable Euridice en hommage à Marie, devant qui l’œuvre a été donnée à la Cour de Florence, alors qu’Henri se battait en Espagne. C’est aussi en hommage à la future reine que Rinuccini écrit une fin heureuse où Eurydice peut revenir à la vie sans aucune condition, à la différence de la version de Monteverdi. Ce dernier développe la complicité de Pluton et Proserpine, or chez Peri et Caccini, il y a un vrai plaidoyer d’Orphée auprès de Pluton. On voit ici le tour de force rhétorique du texte qui permet à Orphée de convaincre le roi des Enfers de lui rendre Eurydice. Proserpine n’intervient que par une petite phrase très touchante qui fait encore plus douter Pluton. Caron intervient alors et lui rappelle que son frère, Jupiter, fait ce qu’il veut sur terre, alors lui aussi peut envisager une exception à ses propres lois.
Ce lieto fine n’en reste pas moins totalement étranger au mythe d’Orphée…
Effectivement, on aurait peut-être une musique plus intéressante à la fin, mais l’essentiel de l’œuvre se passe dans le premier acte, qui se décline en trois tableaux dans lesquels les Nymphes et les Bergers ont un rôle essentiel. Ce qui est très intéressant, c’est que durant toute la préparation du mariage, alors qu’ils se disent : « on est heureux, on n’a jamais connu un couple d’amants pareils… », les teintes restent sombres – c’est du sol mineur surtout, il y a même du do mineur, du ré mineur…
Comme un pressentiment du drame ?
C’est peut-être un pressentiment. Pour Frédéric Dussenne, avec qui je travaillais sur l’Euridice au Studio Opéra des Flandres, il pourrait s’agir d’une métaphore de la situation politique et religieuse en France. On sort de la Saint Barthélemy, Henry de Navarre vient de se convertir et pour consolider cette conversion aux yeux du peuple, il faut un mariage avec une famille catholique, Marie de Médicis est libre et on ne peut rêver mieux. Cela pourrait expliquer cette sorte d’angoisse latente tant que le mariage n’a pas été célébré. On veut conjurer cette angoisse et se convaincre qu’on est heureux, que tout va bien, mais tout danger n’est pas écarté. Dans le récit de la Messagère, les moments parfois les plus dramatiques sont parfois écrits sur des accords majeurs, ce que chante Orphée aussi, il y a donc comme des contradictions. Une autre explication, complémentaire, réside dans le phénomène de l’oxymore, omniprésent dans l’œuvre : cet art très baroque qui consiste à opposer deux idées contradictoires mais qui sont toutes les deux vraies. On trouve des expressions comme les « lieti orrori », les horreurs joyeuses, Orphée appelle Eurydice « O cara vita, o cara morte ».
Et Caccini traduirait donc musicalement ces paradoxes ?
Oui, par exemple quand Orphée chante « dolenti », c’est sur un accord majeur, soit pour traduire cette ambiguïté du malheur qui n’est pas total. Dans un des chœurs à la fin du premier acte, Eurydice est morte, les bergers sont fort tristes, mais, subitement, ils retrouvent l’espoir, parce que la Nature meurt pour mieux renaître, chaque année, donc un bonheur naîtra peut-être de leur douleur, ce que Caccini évoque par un air très brillant et vivant, en sol majeur, au milieu de leur désolation, lequel sera aussitôt interrompu par une nymphe qui exprime en sol mineur quelque chose de beaucoup plus dramatique.
A l’image de Caccini, vous chantez en vous accompagnant vous-même au théorbe. Etait-ce une pratique courante à l’époque ?
Oui, aussi bien en Italie qu’en France.
Pourquoi les baroqueux ne le font-ils pas ?
Il y en a, comme Marco Horvat, qui joue aussi du théorbe et du lirone…
Oui, mais cela reste exceptionnel, alors qu’il y a pas mal d’instrumentistes qui jouent de plusieurs instruments, les chanteurs se limitent en général à la voix.
Aujourd’hui, quand on fait du chant, on a quatre cents ans de répertoire qui s’ouvrent à nous. A l’époque, les chanteurs ne faisaient que de la musique contemporaine. Et la musique se prêtait particulièrement bien à s’accompagner soi-même. C’est beaucoup de travail et certains voient d’un œil inquiet le fait que je fasse plusieurs choses, craignant que je me disperse. Or, si je me concentre sur cette époque, c’est pour comprendre comment fonctionne sa musique, et notamment le principe de la basse continue. Comprendre la basse continue quand on est un chanteur constitue un plus de même que pour un continuiste le fait de comprendre le chant. Comprendre l’utilité d’un instrument de continuo quand on joue d’autres instruments est également important. Jouer du clavecin et de la harpe m’aide à comprendre ce que le théorbe leur apporte et vice-versa. C’est dans cette optique que j’essaie de voir large, mais je ne me considère pas comme un luthiste ni comme un claveciniste. Je suis chanteur et continuiste, avant tout.
Vous pourriez vous accompagner au clavecin ?
Je le fais, dans le cadre d’un opéra par exemple, à la harpe aussi.
Vous chantez le rôle d’Orphée en vous accompagnant au luth, vous dirigez votre propre ensemble, alors que vous n’avez que 23 ans, mais vous vous intéressiez déjà à cet opéra à 12 ans ! Comment avez-vous attrapé le virus de la musique ancienne ?
J’ai découvert la musique ancienne à onze ans, en commençant le chant. J’avais commencé à faire de la musique vers l’âge de six ans, un peu par hasard, avec la guitare, puis j’ai fait du piano et de la flûte traversière.
Vous avez tout de suite aimé la musique classique ?
Oui, enfin assez vite. Pour être précis, j’ai commencé la basse continue si on veut en accompagnant les veillées de scouts à la guitare folk [Rires]. J’ai eu pas mal de chances, parce que mes parents ne sont pas du tout musiciens et pas spécialement mélomanes, or il y avait une académie de musique près de chez nous et ils ont voulu que leurs enfants se frottent à la musique comme à d’autres disciplines artistiques. Ils ne m’ont jamais poussé ni freiné. A onze ans, je me suis réveillé un jour et je me suis dit que j’avais envie de faire du chant, allez savoir pourquoi ! Mon premier cours portait sur les airs allemands de Haendel, quelque chose d’horriblement difficile pour un débutant, puis ce fut un motet de Vivaldi et enfin un air de Bach. Donc le suicide ! [Rires]
Cela ne vous a pas découragé ?
Non parce que j’ai eu un coup de foudre pour le Stabat Mater de Pergolesi. J’en ai chanté des extraits, comme soprano. Ce sont les enregistrements qui m’ont surtout fait découvrir la musique ancienne. Comme je devais chanter les airs allemands de Haendel, je les ai cherchés en disque et c’est ainsi que j’ai découvert Emma Kirkby, dans une très belle version avec le London Baroque. Et avant-hier je les ai rencontrés pour des projets ! J’ai fait la même chose pour le Stabat Mater de Pergolesi, j’ai écouté toutes les versions, et à l’époque, il y en avait déjà près de 45, allant de Mirella Freni et Teresa Berganza à Emma Kirkby et James Bowman, en passant par René Jacobs et Sebastian Hennig. C’est vraiment comme ça que j’ai découvert les différents courants et les interprètes, qui ont éveillé beaucoup de choses en moi.
Vous avez travaillé notamment avec Gérard Lesne, Christophe Rousset, Marc Minkowski, Sigiswald Kuijken, mais surtout avec Christina Pluhar. C’est une question d’affinités, d’opportunité ?
C’est elle qui m’a, en quelque sorte, fait découvrir une seconde fois le répertoire italien du XVIIe, avec entre autres Sances, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. C’est avec elle que j’ai eu mon premier cours de théorbe, que j’avais commencé en autodidacte. C’est elle qui m’a également encouragé à m’accompagner en chantant. J’étudie aussi la harpe avec Christina Pluhar …
Vous consacrez tout un programme de concert à Sances (1600-1679)3. Mis à part son Stabat Mater remis à l’honneur par Philippe Jaroussky ou Carlos Mena, c’est là encore un compositeur peu couru …
Et pourtant sa musique est extrêmement séduisante sur le plan mélodique et harmonique, très classique sur le plan de la structure, très lisse, elle peut s’écouter des heures sans lasser. Sa musique sacrée n’est pas du tout austère, mais très animée. On a, par exemple, à la fin d’un motet, une sorte de passacaille qui évoque le duo final du Couronnement de Poppée et qui se conclut avec un alléluia sur une bergamasque. On ne peut pas imaginer plus festif et folk. J’ai essayé de brosser un portrait le plus complet possible de Sances, tant profane que sacré. C’est un terrain encore quasiment vierge.
L’une des filles de Caccini, Francesca, nous a également laissé un opéra, La liberazione di Ruggiero dall’Isola d’Alcina, qui regorge de beautés sur le plan vocal. Une autre étape dans votre exploration du Seicento ?
Elle a déjà été remontée et enregistrée, mais un jour, oui, pourquoi pas ? J’ai d’autres idées en réserve [Rires !]. Il y a aussi ce projet avec Emma Kirkby. Elle me fascine depuis toujours. Lorsqu’elle a commencé sa carrière en 1971, elle a pleinement assumé le fait d’être différente des autres chanteuses. Humainement, elle est incroyable. J’ai eu la chance de la rencontrer avec Charles Medlam, directeur du London Baroque. Ils se produiront le 18 avril au Bijlock, à Gand, dans un concert autour de Haendel à Rome. La veille, Scherzi Musicali donnera aussi un concert avec la participation d’Emma Kirkby et du London Baroque sur la thématique de la musique à Rome avant Haendel. Et ils m’ont demandé de diriger ce concert ! [Rires] Je leur ai dit « Vous êtes sûrs ? C’est un peu le monde à l’envers ». C’est une occasion extraordinaire pour nous de travailler avec des artistes qui ont une telle expérience.
Propos recueillis par Bernard Schreuders
Bruxelles, 2 octobre 2008
Giulio CACCINI, L’Euridice. Orfeo : Nicolas Achten, baryton ; Euridice : Céline Vieslet, soprano ; Tragedia, Dafne : Magid El-Bushra, contre-ténor ; Ninfa, Venere : Marie de Roy, soprano ; Ninfa, Proserpina : Laurence Renson, mezzo-soprano ; Arcetro, Caronte : Reinoud Van Mechelen, ténor ; Tirsi, Aminta, Plutone : Olivier Berten, baryton. Sara Ridy, harpe triple ; Eriko Semba, basse de viole, lirone ; Simon Linné, luth, théorbe, guitare ; Francesco Corti, clavecin, orgue ; Nicolas Achten, théorbe et direction. Enregistré en janvier 2008 RICERCAR RIC 269.
(1) Principal recueil de musique vocale de Caccini dont la préface est considérée comme le premier véritable traité de chant.
(2) Auteur de La Rappresentazione di Anima e di Corpo, premier ouvrage dramatique en style représentatif, mais sur un sujet religieux.
(3) L’agenda complet de l’ensemble Scherzi Musicali est consultable sur le site www.scherzimusicali.be.