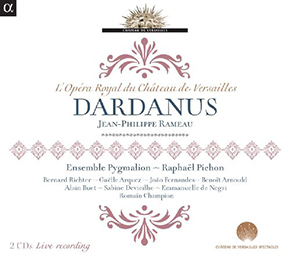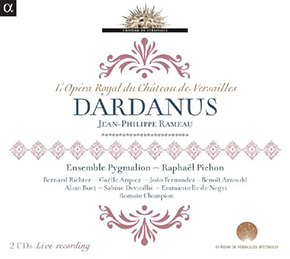Créé le 19 novembre 1739, soit en pleine querelle des lullystes et des ramistes, Dardanus ne pouvait qu’exacerber les passions, les uns admirant une partition luxuriante et les autres fustigeant son déficit dramatique. Les partisans du Dijonnais ont beau charger ses librettistes – pour la plupart médiocres et La Bruère ne déroge pas à la règle –, le compositeur a également sa part de responsabilité, y compris dans le choix de ses collaborateurs. Chez Rameau, le musicien prend toujours le pas sur l’homme de théâtre, défaut rédhibitoire au royaume de la tragédie. Si le compositeur apparaît comme « le loyal serviteur d’une maîtresse [le livret] indigne de lui », observe Cuthbert Girdlestone à propos de Dardanus, c’est parce qu’il « s’intéresse aux aspects descriptifs et expressifs de son texte, non à son architecture », « son sens de l’organisation », explique le musicologue, « ne fut jamais assez robuste pour lui faire critiquer une intrigue comme un tout dramatique ».
Néanmoins, même si l’argument demeure inchangé et donc « passablement absurde » (Girdlestone), pour la reprise de l’ouvrage en 1744, Rameau refond les trois derniers actes en évacuant presque entièrement le surnaturel et en privilégiant l’action ainsi que la psychologie des protagonistes. Anténor affronte scrupules et remords et Dardanus, les affres du désespoir. Les deux versions de l’opéra se révèlent profondément dissemblables et toute synthèse, impossible. En 1998, Marc Minkowski optait pour l’abondance, selon ses propres termes, en retenant la première (ARCHIV), mais empruntait à la seconde son « bruit de guerre » et nous révélait surtout l’extraordinaire monologue de Dardanus, « Lieux funestes ». Bien qu’Alpha annonce la mouture de 1744, entreprise particulièrement louable la veille du tricentenaire, Raphaël Pichon s’autorise plusieurs coupures, plus ou moins mineures, et conserve le magnifique air d’Iphise « Ô jour affreux », ce dont nous ne nous plaindrons pas.
Brillants et stylés, le chœur et l’orchestre de l’Ensemble Pygmalion revêtent leurs plus beaux atours, mais cette première mondiale, enregistrée en public à l’Opéra de Versailles les 14 et 16 février 2012, bénéficie-t-elle pour autant de « toute l’énergie d’une représentation « live » » ainsi que le promet l’éditeur ? Si Raphaël Pichon sait exalter la verve rythmique des Tambourins, de la symphonie guerrière ou de la chaconne conclusive, en revanche, il n’imprime aucune tension au drame et abandonne trop souvent les chanteurs à eux-mêmes. Emblématique de cette lecture privée de chef et de vision, « Lieux funestes » manque cruellement de souffle et de grandeur, Pygmalion émoussant d’emblée les saisissants frottements harmoniques du prélude et survolant cette page pourtant plus symphonique que lyrique où la voix n’est qu’un instrument parmi d’autres. Dardanus brut de décoffrage mais aux accents touchants (finale de l’acte II), Bernard Richter doit surtout lutter avec une tessiture trop élevée qui lui arrache de douloureux aigus sur, amère ironie, « le moindre des maux ». Rival mieux chantant, l’Anténor de Benoît Arnould demeure par contre sur son quant-à-soi et s’efface devant l’éloquence d’Alain Buet (Teucer), dont la présence au texte compense une trame désormais élimée. Couleur idoine, noblesse de ton, seule l’Iphise de Gaëlle Arquez investit pleinement son personnage et tire son épingle du jeu au sein d’une distribution qui aligne les mauvaises pioches, de l’irritant contre-emploi de Sabine Devieilhe, Vénus livide et puérile, aux incantations laborieuses de João Fernandez (Isménor).