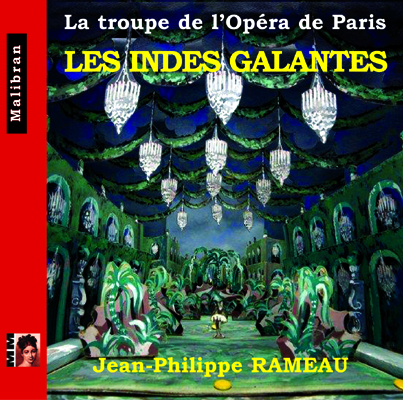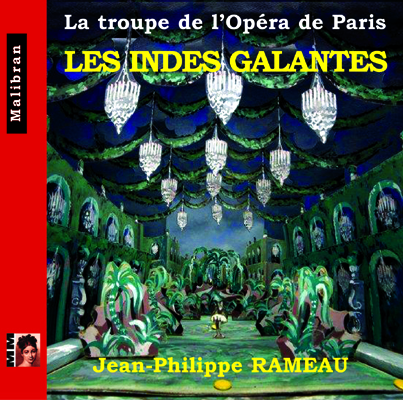Quand on leur demande ce qui s’est passé de plus important dans l’interprétation de la musique au cours du dernier demi-siècle, beaucoup de mélomanes répondraient : la révolution baroqueuse. Comment ne pas leur donner raison en écoutant ce témoignage ô combien précieux, l’enregistrement des Indes galantes telles qu’on les donna à Paris de juin 1952 à janvier 1965 ? Le plus souvent devant des salles combles, le Palais Garnier en offrit 286 représentations, en mobilisant toute sa troupe dans sa diversité. Evidemment, personne n’était alors spécialiste de ce répertoire, et l’on vit défiler les participants les plus inattendus : Denise Duval en Zaïre, Alain Vanzo en Tacmas, Mady Mesplé en Fatime ! José Luccioni ou Guy Chauvet en Adario, Nicolaï Gedda en Damon !! De toute manière, la plupart des spectateurs se déplaçaient non pour la musique, mais pour assister à un divertissement fastueux digne des opérettes du Châtelet. Si la partition ne sort pas trop estropiée de la « révision » de Paul Dukas et Henri Busser – les coupes sont moins graves qu’on aurait pu le craindre et donnent une image pas si incomplète de l’œuvre, malgré un acte des Fleurs assez raccourci –, le plus dur à avaler est l’orchestration épaisse qui se substitue au continuo. Quant à l’interprétation, il vaut mieux tout de suite laisser au vestiaire les habitudes acquises au cours des trois dernières décennies pour tenter d’écouter avec le moins de préjugés possibles.
Les choses commencent pourtant plutôt mal : l’orchestre dirigé par Louis Fourestier étonne nos oreilles « historiquement informées », et l’ouverture sonne comme une mécanique grippée, comme un de ces pastiches grand-siècle commis dans les années 1930 ou 50, dans le goût du Si Versailles m’était conté de Sacha Guitry. Le Prologue réserve d’autres surprises pas toujours agréables. Alors qu’Hébé était « son » rôle, qu’elle ne céda qu’occasionnellement à Renée Doria ou à Nadine Sautereau, Christiane Castelli devait être dans un très mauvais jour ; la vocalisation est poussive, et la chanteuse paraît s’être proprement fourvoyée avec plus d’un aigu faux dans son premier air. Bellone étant une déesse, il semblait hors de question de laisser un homme chanter ce rôle, comme Rameau l’avait pourtant voulu. Ce soir-là, c’est Rita Gorr, qui l’interpréta assez rarement (c’était le plus souvent Hélène Bouvier ou Denise Scharley). Malgré toutes les qualités de ces dames, ce n’est pas pour leur voix que le rôle est écrit. Enfin, comme on pouvait s’y attendre, l’Amour de Paulette Chalanda est une petite voix très pointue. Le chœur a tendance à crier, et pas toujours très en rythme. Horreur supplémentaire : ce que le présentateur radio appelle « l’indispensable commentaire littéraire » en vers, concocté par le septuagénaire René Fauchois, librettiste de la Pénélope de Fauré, et déclamé par un récitant et une récitante avec l’inimitable ton gourmé des voix de feu la RTF.
Heureusement, les quatre entrées sont beaucoup mieux traitées, et donnent à entendre de grandes voix, certes peu habituées à cette musique mais dotées d’une diction française superlative. Jacqueline Brumaire et Suzanne Sarroca campent toutes deux de très nobles héroïnes, au dramatisme affirmé. On a rarement l’occasion d’entendre en Huascar un grand baryton d’école française comme René Bianco. Si les tempos sont parfois très lents, peut-être pour faciliter la tâche à des voix peu rompues à l’agilité (la basse Georges Vaillant dans Osman, par exemple), toute la fête du soleil est rondement menée. On découvre aussi que Jean Giraudeau et Raymond Amade étaient assez acceptables dans les rôles de haute-contre à la française, mais l’on n’en dira pas autant de Raphaël Romagnoni, nettement moins agréable à écouter. On remarque la pureté de timbre de Jeanne Guihard, dont la courte carrière semble s’être ensuite terminée au Canada. Avec Henri Legay, Janine Micheau, Geori Boué et son époux Roger Bourdin, on se trouve transporté dans le monde de l’opéra-comique, ce qui n’est pas gênant pour les deux dernières entrées, où le galant l’emporte nettement sur l’héroïque. On se prend à imaginer que tout pourrait donc se terminer beaucoup mieux que cela n’a commencé, quand survient hélas le grand tripatouillage final, sur lequel il vaut mieux tirer un voile pudique (la sublime chaconne est passée à la trappe, au profit d’un invraisemblable reprise du chœur sur la musique de « La gloire nous appelle », avec des paroles nouvelles censées chanter l’amour plutôt que la guerre). Indubitablement, ce disque est un témoignage précieux, mais il risque d’avoir pour plus d’un auditeur un goût de « Plus jamais ça ».