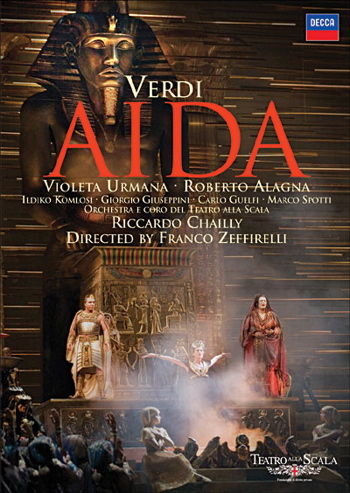|
......
|
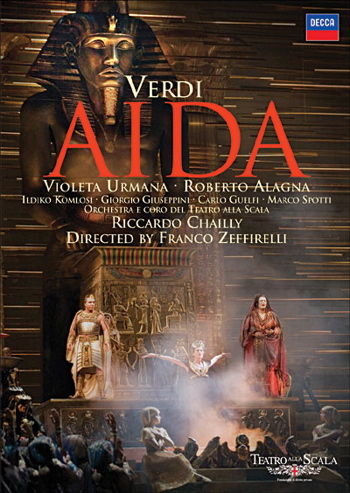
Giuseppe Verdi (1813-1901)
AÏDA
Opéra en 4 actes
livret d’Antonio Ghislanzoni
d’après un scénario d’Auguste Mariette
Aïda : Violeta Urmana
Amnéris : Ildiko Komlosi
Radamès : Roberto Alagna
Amonasro : Carlo Guelfi
Ramfis : Giorgio Giuseppini
Le Roi : Marco Spotti
Un messager : Antonello Ceron
Une prêtresse : Sae Kyung Rim
Ballet : Luciana Savignano, Roberto Bolle et Myrna Kamara,
et les élèves de l’Academia Teatro alla Scala
Milan, Teatro alla Sala
Orchestre, chœurs et ballet de la Scala
Direction : Riccardo Chailly
Décors et mise en scène : Franco Zeffirelli
Costumes : Maurizio Millenotti
Représentation enregistrée en public à la Scala de Milan
le 7 décembre 2006
sous la direction de Patrizia Carmine, pour la RAI
Menu en anglais, sous-titres en six langues
Edité par Decca
PAL-Secam 16:9 toutes zones
Durée : 158’

Aïda chez les flous
Nous sommes le 7 décembre, fête de Saint Ambroise, le
saint patron de Milan, et traditionnel jour de l’ouverture de la
saison à la Scala, soirée dénommée la
Prima. En cet an de grâce 2006 avait été choisi
pour cette grande messe l’opéra Aïda,
qui n’avait pas été représenté
à la Scala depuis 20 ans (depuis 40 ans à
l’Opéra de Paris !). C’est donc
l’événement
« pipeul » où il faut être vu,
et même les hommes (et femmes) politiques ne s’y sont pas
trompés.
Zeffirelli,
à 83 ans, est lui aussi de retour à la Scala où il
a mis en scène sa première Aïda voici 43 ans.
L’œuvre est restée l’un de ses opéras
fétiches ; il en explore tous les méandres, non au
travers de réadaptations au goût du jour, mais dans des
approches classiques, et sur des espaces scéniques
extrêmement divers. Parmi les plus récentes, à
Bussetto en 2001 (édité en DVD avec en bonus un interview
de Zeffirelli fort intéressant), sur une toute petite
scène proche des dimensions de celle de la création
à l’Opéra du Caire. Puis aux arènes de
Vérone de 2002 à 2006, sur l’une des plus grandes
scènes existantes. Enfin à la Scala fin 2006, dans un
cadre plus traditionnel, mais qui permet de réutiliser les
accessoires de Vérone (il n’y a pas de petites
économies, et le « lit hathorique » de
Toutankhamon est de retour avec son paravent à papyrus). Ces
deux dernières productions sont très proches, à
l’exception des costumes, plus classiques dans la production de
la Scala, et se veulent profondément
« italiennes », en opposition avec toutes les
transpositions que l’on a pu voir ces dernières
années. Le décor est fait en grande partie, comme
à Vérone, de barres métalliques
horizontales : ça brille, ça fait riche et kitch,
ça brouille aussi un peu la vue, surtout sur le petit
écran. Mais côté mal aux yeux, on aura mieux tout
à l’heure.
Violetta Urmana est
Aïda. Enfin, l’est-elle vraiment ? La voix somptueuse
de cette grande cantatrice, qui chante sur les plus grandes
scènes notamment tous les grands rôles verdiens,
n’est pas en cause : elle se joue de toutes les
difficultés, et triomphe là où ses rivales
trébuchent. Mais, outre un physique d’Azucena, elle nous
offre une interprétation monolithique, restant en permanence
dans le registre du tragique et de la douleur. Femme soumise aux
événements et aux personnes, elle semble n’avoir
aucun libre arbitre, elle subit, elle est le jouet
d’événements qui s’acharnent sur elle. A cent
lieux de l’Aïda de Nina Stemme à Zurich,
qui jouait une femme maîtresse de son destin, elle nous gratifie
d’une interprétation monolithique parfois émouvante
mais qui, sans être vraiment ennuyeuse, n’est quand
même guère excitante.
Ildiko Komlosi,
cantatrice hongroise, est une flamboyante Amnéris, à la
voix chaude et au jeu scénique assuré. Premier prix du
concours Pavarotti en 1986, elle a abordé Amnéris
à la fin des années 1980, mais a certainement plus
souvent chanté Le Château de Barbe Bleue, Ariane à Naxos, Le Chevalier à la Rose, Carmen et Werther,
que l’héroïne des bords du Nil. Ses dons
scéniques lui ont permis de triompher dans
l’Amnéris complexe de Bob Wilson, à Bruxelles
(captée sur DVD) puis à Covent Garden. Participer
à la Prima 2006 de la Scala et à son édition sur
DVD est une consécration méritée. Car si le jeu un
peu trop minaudant des deux premiers actes de l’opéra
s’accorde plutôt bien à sa caractérisation
vocale, elle atteint au 4e acte à une sobriété
exemplaire : une telle évolution psychologique du
personnage est suffisamment rare pour être soulignée.
Roberto Alagna
essaie de nouveau d’être Radamès. Que dire de plus
que lors de ses prestations à Orange ? Sinon qu’il ne
démérite pas vraiment à côté des
trois autres vedettes. Mais Radamès ne paraît pas fait
pour lui, ou lui n’est pas fait pour Radamès, ce qui
revient au même : comme toujours, il y a bien sûr des
moments sublimes vocalement, mais toutes ses capacités semblent
être tournées vers le chant, au point que le personnage
n’existe pas un seul instant (ah, ce bras et cette main gauches
omniprésents et répétitifs auxquels il demande de
tout exprimer, alors que le bras droit reste quasi paralysé,
sauf pour le lever avec l’autre). Le duo du Nil avec Aïda
est à cet égard un modèle du genre : on
dirait deux étrangers, la confrontation amoureuse n’a pas
lieu, de fait ils ne se regardent pour ainsi dire jamais. Tout cela
n’a rien à voir avec des problèmes de santé,
car ce n’est pas nouveau : la voix est souvent belle, mais
elle est technique, elle vient des cordes vocales, elle ne vient ni des
tripes, ni du cœur, ni du cerveau, encore moins de
l’âme. Cette absence totale
d’intériorité, cette sorte de vide intellectuel
sont accompagnés de problèmes que l’on
déplore : justesse parfois approximative, style
défaillant – ou plutôt absence de style –,
technique incertaine (quelques notes dangereusement ouvertes), ralentis
inacceptables… Et puis l’acteur est médiocre (je me
plante là et je chante), bref il manque à monsieur Alagna
un coach (un personnage, ça se construit, sinon c’est du
théâtre amateur), et un bon chef de chant qui lui redonne
confiance dans ce rôle et lui rappelle les ficelles belcantistes
qui lui sont attachées, susceptibles de faire vibrer les foules.
Ici, pas de clameurs de joie du public, au contraire même un
« hou » conservé par Decca au salut final,
et auquel la vedette répond avec décontraction. A
côté de tout cela, on note que le chanteur termine –
et fort bien – l’air de Radamès sur la phrase finale
grave, rarement donnée au point qu’elle a disparu de
plusieurs éditions actuelles de la partition.
Nous avons donc, globalement, trois grands chanteurs auxquels s’ajoute Carlo Guelfi
en Amonasro, vieux routier à travers le monde de ce type de
rôle verdien ; les autres protagonistes sont d’un
excellent niveau vocal, hormis – comme souvent – un
messager médiocre et une grande prêtresse qui chante faux.
Mais il ne se dégage de tout cela aucun véritable
enthousiasme. Le chef n’est lui non plus pas en cause, car sa
direction est tout à fait excellente, avec des tempi bien
pensés ; il nous gratifie même à la fin du 3e acte,
de finesses musicales avec notamment des silences intéressants
du point de vue dramatique.
Enfin, les danseurs méritent aussi, pour une fois, d’être cités, et ceci à des titres différents. Luciana Savignano,
danseuse étoile de la Scala depuis 1975, fait-elle ce
qu’on lui dit de faire ou fait-elle ce qu’elle a envie de
faire ? Toujours est-il qu’elle est en décalage
constant, sinon en contradiction avec l’action. Toujours le
fameux antinomisme opéra/danse… Mais peut-être,
émaciée, décharnée même,
représente-t-elle la mort qui plane ? Roberto Bolle,
danseur étoile de la Scala, est lui le playboy italien de
service tout auréolé de son action humanitaire dans le
cadre de l’UNICEF. Il intervient ici dans des ballets africains
tribaux plutôt ridicules ; mais peu importe ce qu’il
danse et pourquoi : espèce de Tarzan super musclé,
en string à coquille et huilé façon Folies
Bergères, il plaît visiblement autant aux dames
qu’aux messieurs, car pour une fois ce ballet indigent
n’est pas sifflé ! Quant à
l’Américaine Myrna Kamara,
elle s’est fait une curieuse spécialité de ce
ballet qu’elle danse chaque année aux Arènes de
Vérone depuis 1994, sans visiblement trop comprendre ce qui se
passe…
Alors, avec tous ces ingrédients qui sont loin
d’être de mauvaise qualité, pourquoi la mayonnaise
ne prend-elle pas ? Il y a à mon sens trois raisons. Tout
d’abord, le classicisme des décors est « limite
ringard », et l’on n’est plus habitué
à une imagerie antiquisante saint-sulpicienne, guimauve et sucre
d’orge, qui passait peut-être encore à Vérone
avec la distance, peut-être aussi sur place à la Scala,
mais pas sur le petit écran. Ensuite, la mise en scène
est d’une autre époque ; ça commence mal
dès le début, avec le duo Ramfis-Radamès qui se
déroule au milieu de figurants coiffés du
némès, la coiffe pharaonique, et qui ont l’air de
se demander ce qu’ils font là, à côté
de gardes bleus (hommage à Klein ?) ; et, pour un ou deux
moments d’exception (le ballet des esclaves nubiens dans les
appartements d’Amnéris dansé par des enfants,
drôle et enlevé, excellent retour à la tradition,
et la scène de la trahison de Radamès), le reste, trop
statique, paraît sans intérêt. Enfin et surtout, la
qualité de la captation est d’une médiocrité
affligeante. Ça commence mal dès le prélude,
joué sur des reflets d’eau et effets de flou brouillant
les images et rendant la distribution à la limite du lisible
(mal aux yeux garanti). Les effets d’eau miroitante (le
Nil ?), de flous « artistiques » (???), de
fondus enchaînés et d’images
« flash » se poursuivent tout au long de
l’opéra, aux passages d’une scène à
l’autre, et sont vraiment insupportables (mal à la
tête garantie), avec en plus, pour faire bonne mesure, des
cadrages approximatifs : on peut quand même faire actuel
sans faire n’importe quoi ! Mais, grâce aux dieux
égyptiens, les choses s’arrangent dans le second DVD, car
les 3e et 4e actes sont si peu éclairés qu’on
n’y voit quasiment rien : c’est d’un
reposant !
Le livret qui accompagne les deux DVD (deux actes par DVD), est
totalement creux (le nom de Mariette n’est même pas
cité, alors qu’il apparaît maintenant
systématiquement à travers le monde comme auteur de
l’argument). Y est reproduit une espèce de compte rendu de
la soirée dont on appréciera l’originalité
(« On ne peut pas s’approcher à cause des
cordons de policiers »), avec une connotation totalement
laudative (« La Scala y a consacré un budget qui
suffirait à bien d’autres théâtres pour une
saison entière », et « C’est le
genre d’événement qui ne pouvait se produire
qu’à la Scala »), dans une traduction
très approximative, allant du charabia (« Les grands
tableaux étaient impeccablement organisés, et les
échanges intimes exécutés dans le style italien
à larges touches ») aux faux sens (« Le
spectacle de Zeffirelli n’était guère que le reflet
de l’argent assis dans les loges », et
« Même les ballets semblaient bien en
place »). C’est peut-être le livret le plus nul
qu’il m’ait été donné de lire !
Et en plus il est en trois langues d’une égale
qualité !
Enfin, aujourd’hui, on n’est plus guère
habitué aux DVD sans des documents complémentaires. Ici,
pas le moindre bonus, rien… Et pourtant, un chouette bonus que
l’on a tous vu sur Internet et à la
télévision était tout trouvé, je vous le
laisse deviner…
Donc, en résumé, un DVD non indispensable, sauf bien sûr pour les aficionados de telle ou telle vedette tête d’affiche.
Jean-Marcel HUMBERT
Commander ce DVD sur www.amazon.fr

|
|
|