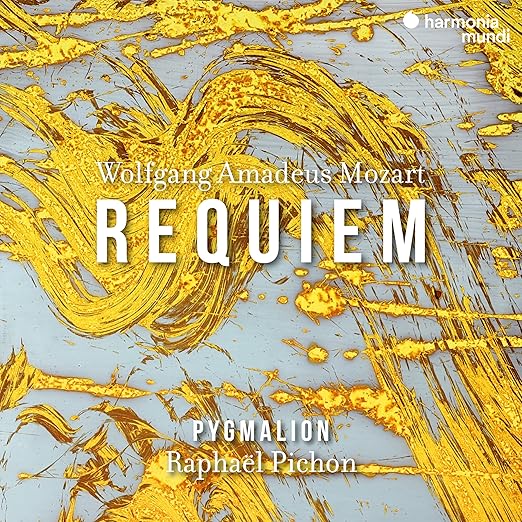Voilà un disque d’une intrigante splendeur. On pourrait entrer d’abord dans le détail de sa conception, à la fois érudite et intelligente. Mais telle n’est pas la priorité. Il faut d’abord s’interroger sur ce qu’il nous révèle du Requiem de Mozart, et que d’autres versions n’avaient pas fait entendre. Mieux, il faut tenter de comprendre pourquoi on ressort de cette audition bouleversé, alors même que jamais Raphaël Pichon ne verse dans la lecture funèbre, et encore moins tragique, de l’œuvre. Cette messe des morts, tombeau de Mozart lui-même, ne ressemble pas à ces anges de pierre qui versent des larmes dans les cimetières de Vienne. Tout ici est lumière. Et même, à rebours d’une méditation sur les derniers instants du compositeur, tout est enfance. Car entre les étapes du Requiem sont insérées des esquisses de jeunesse, comme des souvenirs matriciels, ou des résonances, comme ce Miserere mei K.90 d’un Mozart de quinze ans, ce Solfeggio K392 anticipant la Messe en ut, ou cette adaptation de l’adagio de la Gran Partita. Ces pages venues de loin nimbent le Requiem de tout autre chose qu’un pressentiment de la fin : la mort ici n’est que la compagne de la vie même, et ce qu’elle a de menaçant ou de sombre est comme combattu par un regain de vie. Cela ne veut pas dire que Raphaël Pichon abrase le Requiem de sa charge funèbre, mais il fait entendre dans le chant, et surtout dans le chœur, la conjuration des forces de la vie, luttant contre la peur, contre l’angoisse de la mort.
Comment réussit-il cette alchimie bouleversante qui de la vie et de la mort nous fait entendre l’avers et le revers ? Comment transmet-il dans le Requiem une foi dans la vie qui ne se sépare pas de la mort ni ne la renie ? Je ne sais pas. Une chose est certaine : sa lecture nous fait nous approcher de manière infiniment sensible du génie même de Mozart, dont le chef rappelle si justement qu’il vivait chaque jour dans la présence familière de la mort sans que sa joie de vivre en fût altérée – au contraire. Le secret de Raphaël Pichon est certainement d’abord dans la couleur même qu’il donne à ce Requiem : la luminosité du chœur, la clarté des plans vocaux, quelque chose dans l’expression des chanteurs (chœurs et solistes) qui irrésistiblement regarde du côté de l’opéra (mais de l’opéra selon Mozart, qui est mélange d’affects contraires), et un geste orchestral ample, aérien parfois, réfutant toute raideur, toute lourdeur, cherchant le lyrisme et le mouvement, un geste proprement « dansant », rappelant le travail accompli à Aix avec Castellucci, tout cela compose une approche d’une vitalité profonde dont la discographie ne donne nul exemple. Le disque s’ouvre et se ferme par un plain-chant soulignant l’enracinement du Requiem dans une tradition, mais l’efflorescence qui s’ensuit atteste la liberté absolue de Mozart à l’ égard de cette tradition. Contraste, là aussi saisissant, quand d’autres interprétations (baroques ou romantiques) ont tenté de faire de Mozart soit l’héritier respectueux d’un langage et d’une rhétorique reçue (on entend cela chez Bernius, mais aussi chez Herreweghe ou même Harnoncourt), ou le précurseur d’un romantisme tumultueux (de Bruno Walter à Thielemann). Les échos – ou éclats – de pièces anciennes nous dit que ce Requiem fut une maturation intime, personnelle. Süssmayr, assure Pichon, en fut le gardien vigilant et sous sa plume parfois maladroite, c’est bien le visage de Mozart qu’on retrouve. En ce sens, nous accédons par ce disque non seulement à une vision nouvelle de l’œuvre, mais aussi à sa fabrique : nous entrons dans la tête de Mozart, ou mieux, dans son cœur.