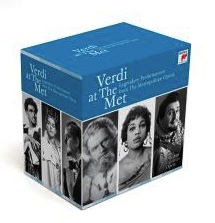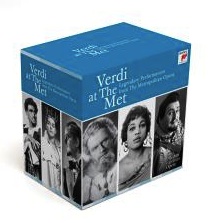Bis repetita. Après le coffret Wagner at the MET, une réussite magistrale saluée comme il se doit, Sony Classical réédite l’exploit en proposant cette fois une sélection d’enregistrements verdiens légendaires issus des archives du MET. Tout comme pour le coffret Wagner, on rendra pour commencer un hommage appuyé aux équipes de Sony Classical, qui livrent avec ce magnifique objet une contribution essentielle à la connaissance du chant verdien.
Rien du contenu de ce coffret n’est inconnu, les dix enregistrements qu’il renferme ayant déjà été publiés sous différents labels plus ou moins officiels. Pas de nouveauté, donc, mais mieux que ça : une renaissance et une mise en cohérence. La renaissance se manifeste par une plus-value sonore époustouflante qui bénéficie d’abord aux enregistrements les plus anciens (La Traviata, Otello), que l’on redécouvre avec un confort d’écoute très appréciable: nette réduction des bruits de surface et autres distorsions, et, au final, l’impression troublante d’avoir Rosa Ponselle ou Giovanni Martinelli en face de soi, avec une présence et une immédiateté inconnues jusque-là.
La mise en cohérence, c’est précisément le parti pris éditorial de ce coffret : témoigner de plus de trois décennies d’évolution du chant verdien sur la scène du MET, les enregistrements s’étalant de 1935 (La Traviata) à 1967 (Aïda), depuis Rosa Ponselle, qui fit ses débuts in loco en 1918 avec Caruso dans La Force du Destin, jusqu’à Leontyne Price, qui fit ses adieux au MET en 1985. Un pont est ainsi très intelligemment jeté entre le passé le plus légendaire et l’époque contemporaine (ils ne sont pas rares ceux qui, aujourd’hui, ont eu la chance d’entendre en scène Price, Bumbry ou Bergonzi).
Il faut dire qu’entre le MET et Verdi, c’est une vieille histoire. Trois opéras de Verdi figuraient au programme de sa saison inaugurale, en 1883-1884 : Rigoletto, Le Trouvère et La Traviata. Cette « tradition italienne » au MET doit beaucoup à la personnalité de Giulio Gatti-Casazza, qui en fut le manager autoritaire et génial de 1908 à 1935, après avoir tenu entre ses mains les rênes de La Scala de Milan, d’où il fit venir, notamment, Arturo Toscanini.
Comme pour le coffret Wagner, on saluera la pertinence artistique du choix des enregistrements. Pour chaque œuvre, le choix de la version est incontestable. Si l’on devait s’autoriser un seul regret, c’est de ne pas trouver dans ce coffret d’enregistrement de Don Carlo (une représentation de novembre 1950 avec Björling, Siepi et Merrill existe, et ne déparerait pas l’ensemble), d’Ernani (idem: l’enregistrement de décembre 1956, sous la baguette survoltée de Dimitri Mitropoulos aurait toute sa place ici) et du Trouvère (une soirée Bergonzi/Stella/Bastianini/Simionato existe).
Ce coffret accède-t-il pour autant au même statut que son homologue wagnérien? Ce n’est pas sûr. Là encore, un rapide détour par l’histoire s’impose. Le chant verdien – et c’est heureux – n’a pas eu à subir pendant les années 30 et 40 les convulsions de l’Histoire aussi directement que le chant wagnérien. Pour ce dernier, on l’a vu, pendant une grosse dizaine d’années, Rome n’était plus dans Rome, mais quelque part le long de Broadway, entre la 39e et la 45e rues. Rien de tel avec le chant verdien. Les scènes italiennes ont, dans l’ensemble, continué à fonctionner de manière quasi-normale sous le régime mussolinien, qui veillait d’ailleurs à ce que ce soit le cas. Les principaux sociétaires de la scène verdienne ont ainsi pu continuer à s’y produire, sans être -sauf exceptions – inquiétés par le régime. On rappellera, de manière schématique, que le chant verdien s’est développé durant la première moitié du XXe siècle autour de plusieurs foyers : l’école italienne, bien sûr, qui longtemps tint le haut du pavé, forte de la pureté des origines, le foyer allemand (surtout à partir des années 30: on écoutera Schlussnus, Rosvaenge, Seinemeyer et quelques autres pour s’en persuader), mais aussi un foyer américain, essentiellement au MET, et dont ce coffret propose un reflet magistral. Ce qui est proposé ici ne prétend donc pas résumer le chant verdien, mais illustre une de ses facettes, certainement pas la moins intéressante.
Qui veut parfaire sa connaissance de l’histoire du chant verdien, notamment sur la période allant des années 30 aux années 50 devra donc, à côté de ce coffret, aller a minima chercher des témoignages des représentants de l’école italienne, dont on se contentera de citer ici les principaux représentants: Giannina Arangi-Lombardi, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile, Giuseppe de Luca, Titta Ruffo, Tancredi Pasero, Claudia Muzzio, Nazzareno de Angelis, Francesco Merli, Giacomo Lauri-Volpi ou Riccardo Stracciari.
Les chanteurs italiens sont certes représentés ici, mais sont minoritaires: Giovanni Martinelli en Otello, Cesare Siepi et Zaccaria, Carlo Bergonzi en Radamès, pour les rôles principaux, auxquels il faut ajouter Giuseppe di Stefano en Fenton ainsi qu’Eugenio Fernandi en Ismaele et Giuseppe Valdengo en Ford et en Paolo.
Assez logiquement, les chanteurs américains (d’origine ou d’adoption) se taillent donc la part du lion: Rosa Ponselle, Lawrence Tibbett (2 fois), Zinka Milanov (2 fois), Leonard Warren (5 fois!), Richard Tucker, Jerome Hines (3 fois), Cornell MacNeil, Robert Merrill, Leontyne Price, Grace Bumbry, pour ne citer que les principales têtes d’affiche. Faut-il absolument essayer de trouver des points communs à ces individualités vocales pour faire émerger ce que pourraient être les caractéristiques d’une école américaine du chant verdien ? L’exercice est périlleux et, d’une certaine manière, assez stérile. On se contentera donc de relever, chez la plupart de ces immenses artistes, une tendance à chanter « au premier degré », straight on, pourrait-on dire, en mettant au premier plan la splendeur vocale, sans s’embarrasser de sous-entendus. On ira chercher chez d’autres la pureté stylistique (cf. liste supra) et les raffinements psychologiques pour se délecter d’une opulence vocale le plus souvent grisante et diablement efficace, sans bouder son plaisir.
Le premier des enregistrements dans l’ordre chronologique place la barre très haut, en proposant une Traviata de janvier 1935. Le rôle titre est confié à Rosa Ponselle, dont c’est le seul témoignage dans une intégrale d’opéra. On entre de plein pied dans la légende. Le chant incroyablement moderne de Ponselle évoque immédiatement celui de Maria Callas, qui ne perdait d’ailleurs jamais une occasion de rappeler ce qu’elle lui devait. Ponselle doit assurément être considérée comme sa plus glorieuse annonciatrice, par le métal vocal et l’investissement dramatique. C’est saisissant, notamment à l’acte III (les défis techniques du « Sempre libera » la prennent un peu de court). Autour d’elle, on placera au même pinacle le Germont de Lawrence Tibbett, splendide de voix et de présence: sa scène avec Violetta au II est un des sommets du chant verdien enregistré. L’Alfredo de Frederick Jagel, sans se situer au même niveau, ne dépareille pas l’ensemble.
On reste dans la légende avec l’Otello de février 1940, qui permet d’apprécier l’incarnation du Maure par un de ses plus fameux titulaires, le ténor Giovanni Martinelli. Alors âgé de 55 ans (il avait fait ses débuts au MET en 1913, pour devenir très vitre le successeur en titre de Caruso), il n’est plus vraiment dans son printemps, mais la voix, très claire au regard de ce que l’on a l’habitude d’entendre dans le rôle, reste d’un métal impressionnant, et l’engagement est insolent. Il a pour partenaires la Desdemone d’Elisabeth Rethberg, au chant d’école, liquide de timbre comme bien peu, et suprêmement musicienne (même si captée, elle aussi, au crépuscule de sa carrière) et surtout le Iago majuscule de Lawrence Tibbett, peut être le plus convaincant de la discographie, splendide et inquiétant, terrifiant de perfection. On n’omettra pas de saluer la direction énergique et efficace d’Ettore Panizza, qui ne fut pas pour rien assistant de Toscanini, et contribue au succès de l’ensemble (il dirige également La Traviata). On tient là assurément un des jalons majeurs de la discographie de l’œuvre.
L’enregistrement du Bal masqué, capté en décembre 1940, contient des merveilles, mais ne peut prétendre aux mêmes honneurs que les deux précédents. A l’actif, on placera sans hésiter le Riccardo de Jussi Björling : le ténor suédois en livre une incarnation racée, aristocratique, servie par un timbre adamantin. Tout juste pourra t-on lui reprocher une certaine froideur : « Ma se m’è forza perderti » le trouve plus en situation que « E scherzo od’è follia ». En Amelia, Zinka Milanov frappe par l’opulence de ses moyens, alors inentamés (elle a 34 ans) et par son chant « toutes voiles dehors ». L’incarnation reste un brin primaire, mais reconnaissons que cela fonctionne. Autour du couple maudit, on baisse de plusieurs crans : le Renato d’Alexander Sved n’est que sonore, Bruna Castagna n’a pas le grave du rôle d’Ulrica (elle doit transposer le sol grave de « Re dell’abisso »), et l’Oscar de Stella Andreva est aimablement acidulé. Heureusement, on retrouve de nouveau à la baguette l’énergique maestro Panizza.
Le Rigoletto capté le 29 décembre 1945 voit l’entrée en lice du baryton Leonard Warren, successeur attitré de Lawrence Tibbett sur la scène du MET (Tibbett la quittera définitivement en 1950). De ses débuts en Paolo dans Simon Boccanegra en 1939 à sa mort tragique sur scène, pendant une représentation de La Force du Destin, le 4 mars 1960, Leonard Warren a foulé la scène du MET plus de 650 fois. Particulièrement aimé du public, il reste dans les mémoires pour ses moyens vocaux exceptionnels (notamment dans l’aigu, on le vérifie ici) et par son timbre à la chaleur immédiatement reconnaissable : un timbre d’ombre plus que de lumière. Son incarnation du bouffon marque par sa splendeur vocale mais aussi par l’humanité qu’elle dégage : un grand moment d’opéra. Par bonheur, cette représentation le trouve bien entouré : Jussi Björling est un Duc étincelant, froid et cynique. La Gilda de Bidú Sayão appartient clairement à l’avant-Callas, mais elle parvient à émouvoir, et vaut de toute façon bien mieux que les crypto-Olympia alla Lily Pons régulièrement abonnées au rôle à cette époque. Dommage que l’ensemble soit un peu gâté par la direction brouillonne de Cesare Sodero.
Le Falstaff du 26 février 1949 figure également parmi les incontestables réussites de ce coffret, d’abord grâce à la direction magistrale de Fritz Reiner : c’est prodigieux de précision, de fini, électrisant, ébouriffant tout en étant grinçant. On pense plus d’une fois à Toscanini. Et la distribution suit ! Warren est à son affaire. Il plane sur son Pancione une ombre de mélancolie qui le rend diablement attachant. Di Stefano et Albanese en Fenton et Nanetta, c’est du luxe. On saluera avec émotion Regina Resnik encore soprano en Alice, tandis qu’en Quickly, Cloe Elmo est impayable : le public s’amuse beaucoup et nous avec. Encore une très belle soirée.
On reste au même niveau, quoique dans un registre différent, avec le Simon Boccanegra capté en janvier 1950. On tient là aussi un jalon indispensable de la (maigre) discographie, une version que tout amoureux de cette œuvre magistrale doit absolument connaître. Le Doge de Leonard Warren appartient à juste titre à la légende : comme son Rigoletto, il conquiert l’auditeur par l’opulence de ses moyens et l’humanité de son incarnation (écouter, pour s’en persuader, sa supplication « E vo gridando pace, e vo gridando amor », à la fin de l’acte I). Il a pour partenaire en Amelia une Astrid Varnay inattendue dans ce répertoire, et qui stupéfie : on découvre avec ravissement que cet instrument vocal hors du commun que l’on croyait abonné au répertoire wagnérien se plie à merveille à l’écriture verdienne. On retrouve ici des allègements tout simplement prodigieux, et une plastique dans la conduite de la ligne qui laissent rêveur : un absolu coup de cœur ! Le Fiesco du Hongrois Mihály Székely, qui n’a pas eu sur les scènes occidentales la carrière qu’il méritait pour cause de guerre froide, est parmi les meilleurs que l’on connaisse. Quant à Richard Tucker, après un duo au I qui semble le cueillir à froid, il se ressaisit pour camper un Adorno très engagé.
Avec La Force du Destin, on redescend vers ce qu’il faut bien appeler de la routine, certes de très belle facture, mais routine quand même. D’abord, l’œuvre est coupée au-delà de ce qui est décent : elle tient en 2 heures et demi, soit une bonne heure de musique à la trappe… C’est ainsi que presque tout le rôle de Preziosilla disparaît : la prestation quelconque de Mildred Miller atténue toutefois les regrets. Cela suffit à disqualifier cet enregistrement, d’autant que « ce qui reste » n’est pas exempt de reproches : pour un Carlo exemplaire (quoi qu’un peu bougon) de Warren et un Guardiano en situation de Hines, on a droit à un Alvaro sincère mais rudimentaire (Richard Tucker), à une Leonora avant tout soucieuse de produire des décibels et de multiplier les clins d’œil vocaux à son public (Zinka Milanov) et à un Melitone rapidement oubliable (Gerhard Pechner). La baguette bien raide de Fritz Siedry n’arrange pas les choses : pour une authentique soirée verdienne, on repassera.
On regagne les sommets avec le Macbeth de février 1959, fort bien dirigé par Erich Leinsdorf. On connaît l’histoire : c’est Callas qui devait chanter Lady Macbeth, mais sa mésentente avec Rudolf Bing prit une tournure telle que le projet capota. Bing alla chercher Leonie Rysanek, qui peut difficilement passer pour un second choix. On pourrait gloser à l’envie sur la compatibilité de cette immense voix avec le répertoire italien. Voilà quoi qu’il en soit une incarnation, certes pas la plus idiomatique (on ne s’étendra pas sur les vocalises de « Or tutti sorgete » et du Brindisi), mais basée sur des moyens vocaux hors du commun (dans le haut medium et l’aigu), et une indéniable présence dramatique. Le Macbeth de Leonard Warren fut immensément acclamé à l’occasion de ces représentations, et à l’écoute on comprend pourquoi. Tout est superbe, les moyens sont intacts (jusqu’au la aigu impérial à la fin de « Pieta, rispetto amore ») et l’incarnation est celle d’un seigneur : c’en est presque trop pour le personnage falot qu’a voulu Verdi. Un bonheur ne venant jamais seul, on a avec Carlo Bergonzi sans doute le meilleur Macduff de la discographie, une leçon de style et de classe qui fait regretter que Verdi ne lui ait pas écrit plus de musique.
On retrouve Leonie Rysanek dans le Nabucco de décembre 1960. Là encore, la voix impressionne, mais la rencontre avec le personnage est moins évidente que dans le cas de Lady Macbeth. L’écriture plus belcantiste du rôle d’Abigaille y est sans doute pour quelque chose. Pour le reste, on retiendra la direction inspirée de Thomas Schippers, le Zaccaria superlatif et idiomatique de Cesare Siepi, mais aussi le Nabucco très convaincant de Cornell MacNeil (superbe « Dio di Giuda », chanté sur le souffle, tout en nuances), et l’on regrettera, une fois encore, des coupures qui défigurent l’œuvre : la philologie n’était manifestement pas la préoccupation première des équipes du MET.
Le coffret se clôt beauté avec une magnifique Aïda captée en février 1967 et qui renferme trois prestations majuscules. L’Aïda de Leontyne Price, très présente dans la discographie, appartient à la légende du chant verdien, et l’on vérifie ici que ce n’est que justice : sa voix de miel, d’une souplesse enchanteresse, captée ici dans son printemps le plus radieux, y fait des merveilles (l’air du Nil !). Elle a pour partenaire l’Amneris irrésistible de Grace Bumbry, qui réussit à la surclasser dans l’insolence vocale, c’est dire ! Après tant d’Amneris matrones, voici enfin une vraie rivale pour Aïda : dramatiquement, c’est loin d’être anodin. Quant à l’objet de leur rivalité, le Radamès de Carlo Bergonzi, il frise la perfection par la tenue impeccable de son chant au style irréprochable. Voilà certes un général davantage porté sur l’élégie que sur la vaillance, mais quelle leçon de chant (cela commence par un diminuendo à la fin de « Celeste Aïda » qui manque très mal se terminer, mais la manière dont Bergonzi se rattrape mériterait d’être enseignée dans toutes les écoles de chant). L’Amonasro robuste de Robert Merrill n’est en rien indigne et il sait se montrer plus qu’efficace à l’acte du Nil. Fouettée par la direction de Thomas Schippers, cette soirée est véritablement grisante.
Remercions donc une fois encore Sony Classical pour offrir aux mélomanes de si beaux produits, qui contribuent à éclairer d’un jour flatteur l’histoire du chant, à travers la part éminente qu’y prit le Metropolitan Opera de New York. Pour Wagner comme pour Verdi, on retournera régulièrement, sans nostalgie mais avec gratitude, se ressourcer à l’écoute de ces témoignages des « grands anciens » pour mieux apprécier ceux qui leur ont succédé: « Torniamo all’antico, e sara un progresso » avait dit Verdi.