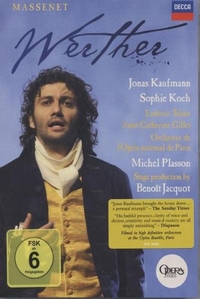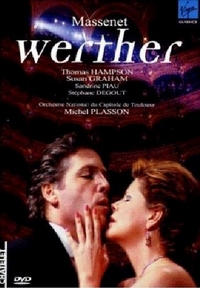Le jeu de la comparaison des différentes versions de Werther est un peu faussé car l’un de ces DVD fait d’ores et déjà figure de référence, même si l’on peut rêver d’une mise en scène autrement plus inventive ou d’une direction un peu plus alerte. A cette vidéographie s’ajoute le Werther pour baryton, mais uniquement en version de concert.
|
|
TDK (2005) |
Arthaus (2008) |
Decca (2010) |
Virgin (2006) |
|---|---|---|---|---|
|
Werther |
Marcelo Alvarez |
Keith Ikaia-Purdy |
Jonas Kaufmann |
T. Hampson |
|
Charlotte |
Elina Garanča |
Silvia Hablowetz |
Sophie Koch |
S. Graham |
|
Sophie |
Ileana Tonca |
Ina Schlingensiepen |
A.-C. Gillet |
S. Piau |
|
Albert |
Adrian Eröd |
Armin Kolarczyk |
Ludovic Tézier |
S. Degout |
|
Le Bailli |
Alfred Šramek |
Tero Hannula |
Alain Vernhes |
R. Schirrer |
|
Schmidt |
Peter Jelosits |
Andreas Heideker |
Andreas Jäggi |
F. Piolino |
|
Johann |
Marcus Pelz |
Mika Kares |
Christian Tréguier |
L. Alvaro |
|
Orchestre |
Wiener Staatsoper |
Badische Staatskapelle |
Opéra de Paris |
Capitole de Toulouse |
|
Direction musicale |
Philippe Jordan |
Daniel Carlberg |
Michel Plasson |
M. Plasson |
|
Mise en scène |
Andrei Serban |
Robert Tannenbaum |
Benoît Jacquot |
|
A Vienne, tout se déroule autour d’un arbre gigantesque, équipé de passerelles : le premier acte se déroule en été, les enfants sont en maillot de bain, Werther et Charlotte discutent sur une balancelle de jardin ; le deuxième est automnal, et le troisième se situe bien sûr « à la Noël ». Mais finalement, cet arbre ne sert pas à grand-chose, et Serban se sent obligé d’installer à l’avant-scène tout un fatras d’objets fifties, comme si on était dans un intérieur bourgeois et non en plein air. A Karlsruhe, pendant l’ouverture, on assiste à un enterrement – celui de la mère de Charlotte, peut-être –, au pied d’un poteau télégraphique, sur une scène envahie par le givre. Le premier tableau se déroule dans la grisaille beigeasse d’un salon sordide où les enfants s’ennuient, cependant que le bailli leur fait répéter leur cantique, litron à la main, devant un téléviseur allumé. Loin de couper des tartines à ses petits frères et sœurs, Charlotte leur distribue leur goûter dans des sacs en papier brun. A droite, un carré de pelouse artificielle sur lequel Werther chantera son « O Nature » en serrant dans ses bras un pot de géraniums. Au deuxième acte, une église fuchsia et une bâtisse vert cru se découpent sur un ciel saumon : ce n’est plus Derrick, c’est Wozzeck. Pour le dernier acte, on revient au décor de l’ouverture, et l’on comprend rétrospectivement que tout le spectacle n’était qu’un long flashback ; l’inhumation initiale était celle de Werther, qui se contente ici de sortir de scène au lieu de mourir dans les bras de Charlotte. A Paris, les décors laissent assez peu de place à la nature : quelques pans de mur, un parapet, puis un intérieur bourgeois assez dépouillé, avant la chambrette de Werther qui glisse vers l’avant-scène pour permettre de mieux suivre l’agonie du héros. Heureusement, quelques mouvements de caméra inédits (la scène vue d’au-dessus, les chanteurs émergeant des coulisses) viennent un peu animer tout cela.
Werther
Keith Ikaia-Purdy se révèle aussi piètre acteur que mauvais chanteur : voix raide, comme étranglée, timbre désagréable, chant toujours en force, qui ignore la nuance et les demi-teintes, très loin du style français. Même si on comprend une bonne partie de ce qu’il chante, l’articulation lui pose des problèmes dès qu’elle s’accélère, avec un « J’aurais sur sa poitrine » affreux, dont certaines phrases dégoulinent en un glissando du plus mauvais effet. C’est l’un de ces hurleurs auxquels ont recours les festivals pour remplir de son les lieux les plus improbables. Dans ses derniers moments, un projecteur vert l’éclaire par en dessous, et Werther devient Shrek, à moins que ce ne soit Hulk. Marcelo Alvarez, lui, sait ce que chanter piano veut dire, il maîtrise le français (« J’aurais sur ma poitrine » est pris à un rythme effréné) et le style de Massenet, et l’on comprend qu’à son insu Charlotte l’écoute fascinée pendant l’Hymne à la Nature. Dommage qu’à un chant d’une telle délicatesse et d’un tel raffinement il n’unisse pas un physique de héros romantique : légèrement bedonnant, il ressemble à Tino Rossi avec son sous-pull jaune et son blazer bleu marine. On est loin de la crinière de rock-star de Jonas Kauffmann et de son costume mi-xviiie siècle, mi-moderne : gilet jaune et veste bleue, certes, mais pantalon et non culotte. Ce Werther-là ne choquerait pas si on le croisait dans la rue. Diction quasi impeccable, timbre viril et chaud, décidément il a tout, l’animal.
Charlotte
Grande – elle domine son Werther d’une tête – longiligne, blonde, Silvia Hablowetz a une belle voix de mezzo, mais son texte n’est que rarement intelligible. Une fois mariée, elle se métamorphose en dame patronnesse très convaincante, avec chignon, tailleur, rang de perles. Desperate housewife bouleversante au troisième acte, elle ressemble à une malade mentale dans sa cellule écrasée par une gigantesque Vierge espagnole ; l’air des Lettres fait froid dans le dos. Elina Garanča, en revanche, est trop coquette, trop consciente de sa beauté pour convaincre en Charlotte. Sœur de Tippi Hedren ou de Kim Novak par sa blondeur toute hitchcockienne, elle pourrait bien comploter de tuer Albert en un crime presque parfait, surtout lorsqu’elle brandit son coupe-papier dans l’air des Lettres. Quand la mise en scène fait de l’air des Larmes un air des Cartes, on se dit qu’on a affaire à une Carmen et non à une Charlotte. La voix est somptueuse, mais ne parvient pas à émouvoir, sans doute plus à l’aise dans la véhémence que dans la déploration. Tout le contraire de Sophie Koch qui, vibrante, chantant comme elle respire, s’impose d’emblée comme la Charlotte de sa génération, avec cette réserve passionnée qui convient parfaitement à l’héroïne.
Sophie
Comment faire de Sophie autre chose qu’une cruche ? Tous les metteurs en scène sont confrontés au problème. A Karlsruhe, c’est une Sophie paraplégique qu’on découvre dès le lever du rideau, avec béquilles et attelles aux jambes. On ne doit pas se moquer des handicapés, or Sophie est handicapée, donc… Syllogisme imparable. En plus, en contradiction constante avec la musique primesautière qui accompagne chacune de ses apparitions, cette Sophie-là fait la gueule : on ne saurait mieux tordre le cou à la bécasse. Sa voix a plus de corps que ce qu’on entend d’ordinaire dans le rôle, mais on ne comprend rien à ce qu’elle chante et le premier aigu de « Du gai soleil » n’est pas très agréable à entendre. A Vienne, Sophie est une ado délurée en pantalon rose, qui se prend pour une pompom-girl et qui tape du pied quand Werther refuse de danser avec elle le premier twist, pardon, « le premier menuet ». Sans avoir besoin de pareils subterfuges, Anne-Catherine Gillet est tout sauf une oie blanche : avec sa voix claire, sans aucune acidité dans l’aigu, elle est un modèle de diction pour toutes les Sophie.
Et les autres
A Karlsruhe, on se demande vraiment ce que Charlotte trouve à Werther : son Albert chante bien, il est élégant, élancé…Adrian Eröd, l’Albert viennois au français parfait, est un peu ridicule (il se recoiffe devant un miroir de poche en chantant « Elle m’aime, elle pense à moi »), et il a autant de sex-appeal qu’un Ministre de l’Intérieur ; il rôde en fond de scène durant tout le dernier, acte, tel Golaud méditant son crime. Ludovic Tézier campe un mari plus bonnet-de-nuit qu’il n’est permis, avec un timbre somptueux, toutefois. Cet Albert-là n’a rien de risible (Tézier est un excellent Werther dans la version pour baryton), mais il dégage tout l’ennui qui convient.
Si Alain Vernhes est un adorable Bailli bon-enfant, Tero Hannula est très convaincant dans son personnage de veuf à la dérive, tout aussi alcoolique que Johann et Schmidt. Quant au titulaire viennois, il passe inaperçu.
On reconnaît les grandes maisons d’opéra à la qualité de leur comprimari. A Karlsruhe, Johann et Schmidt sont dès le départ avinés au dernier degré, ce qui ne saurait cependant excuser leur malcanto. A Vienne, le niveau est infiniment meilleur, avec quand même trop de H dans « un mari modèle ». Christian Tréguier, excellent Bailli sur d’autres scènes, était déjà Johann dans l’éphémère production de Jürgen Rose ; Andreas Jäggi, son compagnon de beuverie, nous épargne les aigus poussés et déplaisants de bien d’autres titulaires.
La direction musicale
Sous la baguette alerte et incisive, de Daniel Carlberg, l’orchestre de la Badische Staatskapelle sonne diaphane, transparent, dégraissé. Des abîmes insondables s’ouvrent, et jamais la musique de Werther n’aura autant sonné comme celle de La Dame de Pique. A Vienne, l’orchestre vibre comme un grand orgue et, Philippe Jordan maîtrise un océan tantôt déchaîné, tantôt paisible. C’est vraiment l’opéra dans lequel Massenet a le mieux écrit pour l’orchestre. Avec ses tempi étirés à l’extrême, la direction lentissime de Michel Plasson met les chanteurs à l’épreuve et rend interminable l’agonie de Werther.
Version baryton
Un DVD immortalise la version arrangée en 1902 par Massenet à la demande du baryton Mattia Battistini pour une série de représentations données à Saint-Pétersbourg. Systématiquement dépouillée de ses aigus, la ligne du chant du héros y adopte un profil des plus étranges. On aimerait mieux y entendre Ludovic Tézier que Thomas Hampson, qui pousse le personnage jusqu’à la brutalité. En avril 2004, date de ce concert, Susan Graham était encore une très bonne Charlotte, heureusement moins mûre et moins molle qu’à la Bastille cinq ans après. Sandrine Piau n’est que partiellement intelligible, et le tout jeune Stéphane Degout est le plus touchant des Albert. Plasson n’avait alors « que » soixante et un ans : sa direction paraît bien plus alerte qu’en 2010 à la Bastille.
Kitsch
Pour les amateurs de kitsch, signalons la version en italien et en – mauvais – play-back, tournée en 1955 dans les studios de la RAI (disponible en DVD d’import anglais), avec Leyla Gencer et Juan Oncina, avec l’orchestre de la RAI de Milan dirigé par Alfredo Simonetto. Auprès d’un Werther qui roule des yeux, une « Carlotta » au faux air d’Olivia de Havilland dans Autant en emporte le vent multiplie les simagrées à la Tebaldi, dans un décor qui sent le carton-pâte à cent mètres. Malgré un son un peu fluctuant, ce Werther « di Giulio Massenet » reste très écoutable pour ses voix mais difficilement regardable.
Conclusion
La production de Karlsruhe (Arthaus) soumet l’œuvre à un électro-choc salutaire, mais est desservie par un protagoniste à fuir comme la peste. A Vienne, avec un Werther proche de l’idéal, la transposition achoppe sur l’écueil que Serban voulait éviter : pour échapper au côté « vieille perruque », elle s’encombre de toute une bimbeloterie 1950, alors qu’à Paris, par le dépouillement de sa mise en scène, Benoît Jacquot touche à l’intemporel sans jamais faire obstacle ni à la musique, ni à l’émotion, le tout avec des interprètes d’exception. On vous le disait bien, les jeux sont faits, et sans doute pour longtemps encore…