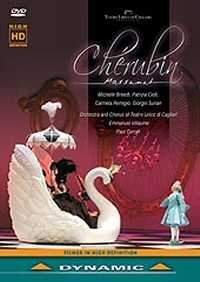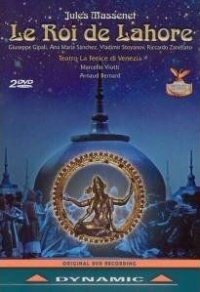Pas de Navarraise en DVD, ce serait trop beau, mais deux opéras « espagnols » de Massenet, pour lesquels il n’existe qu’une seule captation vidéo disponible. Toutes deux viennent d’Italie : signe du dynamisme des salles lyriques de la péninsule, ou plutôt des producteurs de DVD ? A ces deux titres isolés on ajoutera ici, pour faire bonne mesure, une autre rareté de Massenet, avec un DVD également en provenance d’Italie : Le Roi de Lahore.
Don Quichotte (Bongiovanni 2008)
Don Quichotte
Giacomo Prestia
Sancho Pança
Alessandro Corbelli
Dulcinée
Laura Polverelli
Pedro
Marie Devellereau
Garcias
Tullia Mancinelli
Rodriguez
Cesare Ruta
Juan
Gianluca Sorrentino
Orchestre
Teatro Verdi de Trieste
Direction musicale
Dwight Bennet
Mise en scène
Federico Tiezzi
Cette mise en scène élégante, parfois un peu froide, joue la carte du théâtre dans le théâtre. Un grand rideau rouge s’ouvre en fond de scène, une plate-forme surplombée d’une guirlande électrique délimite une scène au milieu de la scène. Assis sur des gradins, les choristes en tenues de l’entre-deux-guerres assistent à l’action comme on irait au guignol. Après les divers épisodes, dont de nombreux ballets, la mort de Quichotte est montée avec le dépouillement qui convient, avec un décor réduit à un arbre, au centre d’un petit carré de lumière.
Alessandro Corbelli chante avec verve dans un français tout à fait idiomatique, comme l’avait déjà montré son excellent Sulpice dans La Fille du Régiment avec Natalie Dessay). On n’en dira pas autant de Giacomo Prestia, à la voix un peu grisâtre, même si le couple Quichotte-Pança fonctionne, avec la différence nécessaire entre les deux timbres. Laura Polverelli est une Dulcinée jeune et élancée, superbement servie par la mise en scène et par les costumes (tour à tour Espagnole d’opérette, vamp années 1930 ou Infante de Vélasquez) ; elle séduit par la beauté de son timbre, mais ne semble guère soucieuse de traduire cette mélancolie qui fait la richesse du personnage.
Malgré une diffusion télévisée dans les deux cas, l’Opéra de Paris n’a jamais envisagé une publication de son médiocre Don Quichotte (production de Gilbert Deflo, avec Samuel Ramey et Jean-Philippe Lafont) et les adieux de José Van Dam à la Monnaie n’ont pas encore fait l’objet d’un DVD : la commercialisation de l’un ou de l’autre pourrait changer la donne, mais il faudra encore attendre…
Chérubin (Dynamic 2006)
Chérubin
Michelle Breedt
L’Ensoleillad
Patrizia Ciofi
Nina
Carmela Remigio
Le Philosophe
Giorgio Surian
La Comtesse
Teresa di Bari
La Baronne
Alessandra Palomba
Le Comte
Nicola Ebau
Le Baron
Riccardo Novaro
Le Duc
Bruno Lazzaretti
Orchestre
Teatro Lirico, Cagliari
Direction musicale
Emmanuel Villaume
Mise en scène
Paul Curran
Grâce à la personnalité de mezzos comme Frederica von Stade ou Susan Graham, Chérubin connaît depuis les années 1990 un retour en grâce. Reflet d’une récente production sarde, ce DVD offre dans un amusant décor tout de guingois un univers de pure fantaisie, loin de toute tentation réaliste. Le Siècle des Lumières, déjà revu par Massenet à travers un filtre Belle Epoque, est ici comme revisité par Erté, avec des costumes dignes d’une revue des Folies-Bergères : dans ce dix-huitième siècle pour rire, l’habit à la française et la robe à panier adoptent des formes exagérées, des couleurs et des matières extravagantes, les paysans qui dansent ont des moutons à roulettes et les bergères en perruque Marie-Antoinette descendent du Hameau de la Reine.
Michelle Breedt a la voix du rôle, et se tire fort bien des nombreux passages déclamés. On a connu à l’opéra des travestis nettement plus androgynes, mais la culotte ne lui messied point. Dans le rôle de la ballerine Ensoleillad, Patrizia Ciofi n’est pas Zizi Jeanmaire mais elle exécute sans peine son court numéro dansé, conduite et portée par ses boys flamencos. Et surtout, vocalement, elle s’impose dès ses premières notes, par le brio de ses aigus, par la qualité de son français. Carmela Remigio est charmante mais on ne comprend d’abord presque rien à son gazouillis. De sa voix solide qu’on n’a pas l’habitude d’entendre dans un registre comique, Giorgio Surian défend le rôle du Philosophe ; son timbre un peu scrogneugneu convient bien à ce personnage de barbon bienfaisant, et c’est peut-être celui des chanteurs que l’on comprend le mieux. Des comparses et du chœur, il ne faut pas attendre un français exemplaire ; tous ces gens-là chantent correctement, c’est le plus qu’on puisse leur demander.
Le Roi de Lahore (Dynamic 2006)
Alim
Giuseppe Gipali
Sitâ
Ana María Sánchez
Scindia
Vladimir Stoyanov
Indra
Federico Sacchi
Kaled
Cristina Sogmaister
Timour
Riccardo Zanellato
Orchestre
Fenice de Venise
Direction musicale
Marcello Viotti
Mise en scène
Arnaud Bernard
Le Roi de Lahore ne compte pas vraiment parmi les chefs-d’œuvre de Massenet, mais marqua son entrée à l’Opéra de Paris et, à ce titre, mérite l’intérêt. Le compositeur y tâtonne encore, avec d’indéniables réussites, de moments d’une grande beauté, mais aussi des passages laborieux (les grands ensembles avec chœur sont assez peu inspirés). Quelques années auparavant, le festival de Saint-Etienne avait littéralement ressuscité cette œuvre, en recréant à partir de fragments épars une partition d’orchestre exploitable, avec l’aide d’une équipe de musicologues. Hélas, personne n’eut l’idée, en 1999, d’enregistrer ou de filmer une distribution infiniment plus idiomatique que celle de Venise (Michèle Lagrange, Luca Lombardo et Jean-Marc Ivaldi), dirigée par Patrick Fournillier ! Il faut donc se contenter de la production du Théâtre de la Fenice.
A première vue, on croit avoir affaire à une mise en scène des plus classiques, avec de jolis décors orientaux (au IVe acte, un grand moucharabieh dissimulant une reprise du Palais des Vents de Jaipur) et de jolis costumes évoquant les miniatures mogholes. Il ne manque pas un turban, pas une babouche, mais Arnaud Bernard tient à bien montrer qu’il n’est pas dupe. Sous cette Inde de pacotille se cache forcément le XIXe siècle : sous les stoupas, l’usine. D’où l’apparition incongrue d’un piston de locomotive au Ier acte, sans doute pour justifier la seule véritable audace de cette production : le paradis d’Indra se confond avec l’Occident moderne, l’Europe des années 1880, et le IIIe acte a pour décor une verrière qui rappelle, en beaucoup moins élaboré, celle où Jorge Lavelli situait son Faust. Le ballet devient une soirée costumée, un bal blanc avec corsets et robes à tournure pour les dames, queue de pie pour les messieurs. Le résultat est joli sans être inoubliable.
A un physique encombrant – les gros plans sont sans pitié –, Ana Maria Sanchez associe une voix très pure et une prononciation très acceptable, même si, dans l’aigu forte, les consonnes s’évanouissent, remplacées par un vibrato peu agréable. La voix de Giuseppe Gipali, qui souffre d’un sérieux déficit sonore, est étouffée dans les ensembles. La couleur de timbre du baryton bulgare Vladimir Stoyanov correspond parfaitement à Scindia, et il articule le français plutôt mieux que le reste de la distribution, le prix de la plus mauvaise prononciation revenant au Timour de Riccardo Zanellato.