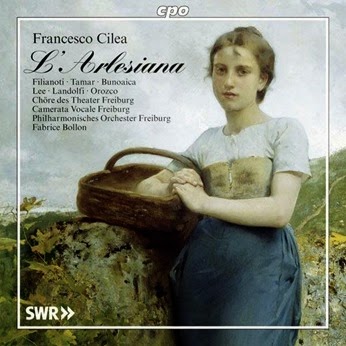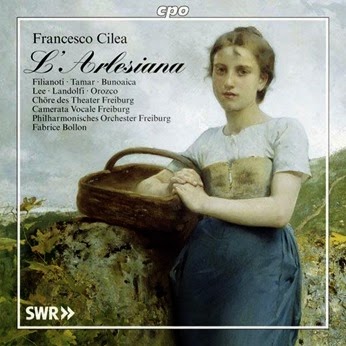Malgré des musiques souvent charmeuses, des orchestrations la plupart du temps riches et raffinées, des livrets qui, comparés à certains classiques du répertoire, se tiennent plutôt bien, les chefs-d’œuvre du vérisme italien ne bénéficient pas d’une discographie à la hauteur de leur intérêt historique et musical. A part Cavalleria rusticana de Mascagni et Paillasse de Leoncavallo, c’est même un peu le désert de la Crau… A l’instar de ses deux compatriotes, dont on gagnerait à entendre plus souvent d’autres ouvrages (que l’on songe seulement aux merveilleuses Bohème et Zazà de Leoncavallo par exemple), Cilea semble se réduire aujourd’hui à Adrienne Lecouvreur. Son Arlésienne, tirée des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet, a pourtant tous les ingrédients pour « cartonner » sur scène : rôles en or pour ténor, soprano et baryton, vrai drame bien ficelé et ni plus ni moins vraisemblable que la plupart de ce qui se faisait à l’époque. Après un enregistrement (excellent, mais en mono) au début des années 50, avec Tagliavini, Tassinari et Silvestri, il avait fallu attendre 2006 pour que le festival de Montpellier-Radio France propose une nouvelle lecture discographique par une captation de concert. Le label allemand CPO a, quant à lui, opté pour de véritables sessions de studio pour rendre justice à cet ouvrage, profitant de l’engouement du ténor italien Giuseppe Filianoti pour le rôle de Federico : le livret de présentation nous apprend qu’il a en effet retrouvé un air original perdu depuis les nombreuses retouches et révisions effectuées par Cilea sur l’ouvrage tout au long de sa vie, air ici replacé au dernier acte. Car si la version originale remonte à 1896, il faudra attendre 1938 pour que Cilea lui donne sa forme définitive, en trois actes (au lieu des quatre originaux, ce qui implique nombre de coupures), mais augmentéd’un Prélude et d’un bel Intermezzo ouvrant le IIIe acte.
Disons-le d’emblée : le présent enregistrement bénéficie d’une distribution remarquable et homogène. La Rosa Mamai d’Iano Tamar, avec son soprano sombre, sa poignante mélancolie, semble l’incarnation idéale du personnage de cette mère torturée par les mésaventures de son fils. Son air final, « Esser madre è un inferno », est pour une fois autre chose qu’un simple air de récital propre à mettre en valeur la voix de l’artiste. Vécu de bout en bout, son personnage en devient presque le pilier essentiel du drame qui se joue à nos oreilles. Autre réussite incontestable, le Baldassare de Francesco Landolfi. Certes, la voix n’a pas le charme ravageur de Paolo Silvestri dans la version de 1954, mais quelle allure, quelle présence ! Dès sa première scène, avec son sol dièse aigu, il impose cette figure tutélaire (le vieux berger sage, qui raconte aux jeunes gens des légendes qui devraient les mettre en garde – mais comme de bien entendu, il prêche dans le désert) et dans le superbe duo de l’acte II avec Federico, il volerait presque la vedette à Filianoti. Même la Vivetta de Mirela Bunoaica touche par son adéquation au personnage, frêle et fragile, tendre et compréhensive – et avec ce petit souffle sur le timbre qui n’est pas sans rappeler une certaine Cotrubas !
Reste le cas du Federico de Filianoti. Est-ce parce que, pour ce rôle, dans le célèbre « lamento » du moins, les références les plus prestigieuses ne manquent pas, de Gigli à Pavarotti en passant par Bjoerling et Di Stefano ? Le fait est que si l’artiste emporte l’adhésion par son engagement, par l’émotion, la mélancolie qu’il insuffle à la moindre phrase, les moments plus dramatiques le montrent en revanche à la limite de ses moyens (un rôle créé, rappelons-le, par Caruso). Dans les forte et les aigus, le souffle s’est sensiblement raidi, le vibrato n’a plus le naturel d’antan. Méforme passagère ou évolution normale après une carrière déjà bien remplie, et avec des rôles parfois un peu trop lourds ? Le fait est que, sans démériter toutefois, le ténor italien semble un peu en retrait par rapport à ses collègues.
La direction de Fabrice Bollon, à la tête d’un Philharmonique de Fribourg étincelant, souple, tendre, énergique, n’a pas le côté un peu unidimensionnel des deux intégrales précédentes dont nous parlions plus haut. Le dialogue qu’il instaure entre l’orchestre et ses solistes vocaux est un modèle de lyrisme ; il porte de bout en bout l’ouvrage avec un enthousiasme communicatif. Un nom à suivre.