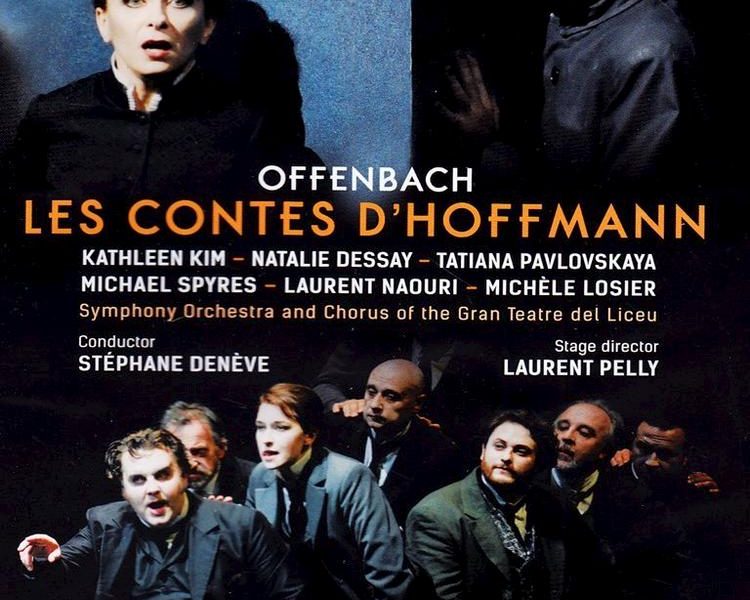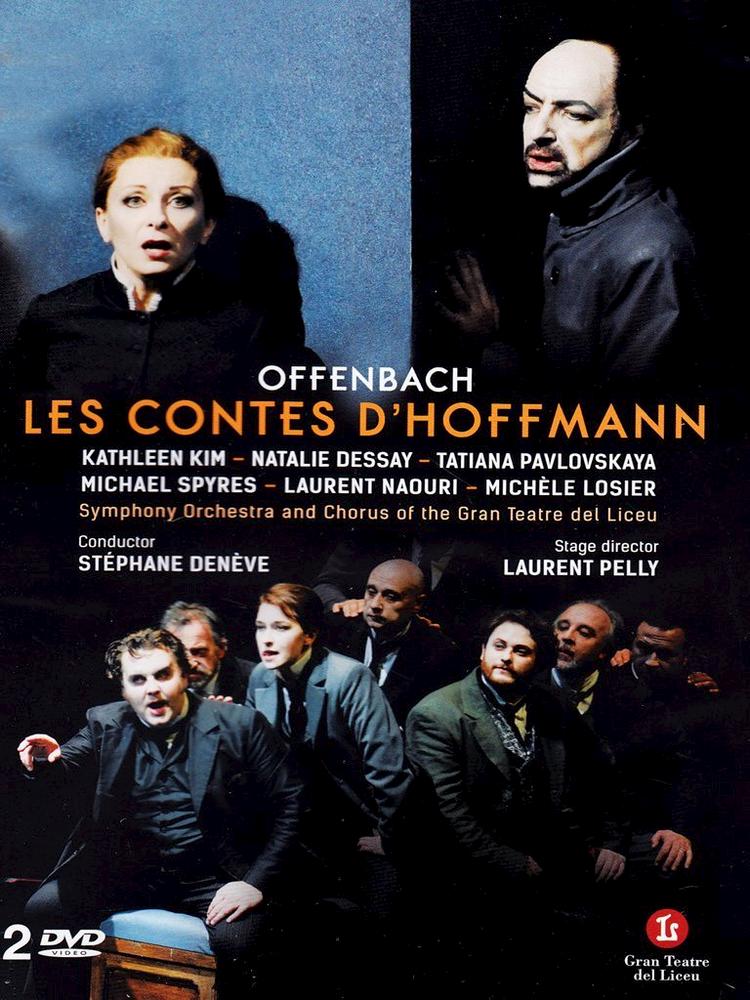Longtemps Natalie Dessay caressa le projet d’incarner les trois héroïnes des Contes d’Hoffmann, Olympia ne lui suffisant plus. Pourtant, elle dut y renoncer : on sait que, pour la version de concert donnée à Paris, c’est finalement Sonia Yoncheva qui se chargea du triple rôle. Et pour la reprise barcelonaise de la production de Laurent Pelly créée en 2003 à l’Opéra de Lyon – où elle vient de revenir pour les fêtes de fin d’année –, elle fit le choix apparemment paradoxal d’incarner non plus l’automate mais l’artiste, Antonia, deux autres chanteuses ayant été embauchées pour être les autres versions de l’éternel féminin selon Barbier et Carré (sans compter celle qui chante Stella, ici gratifiée d’un air). Au cours de ses nombreuses éditions, ce spectacle a souvent eu une seule interprète pour les trois femmes, ce en quoi il correspondait à la volonté initiale d’Offenbach : on pense notamment à Patrizia Ciofi ou à Mireille Delunsch. Au Liceu, tandis qu’un seul chanteur cumule tous les « méchants », et un autre tous les valets ridicules, il faut accepter trois femmes là où dans l’idéal il ne devrait y en avoir qu’une. C’est d’autant plus dommage que, par ailleurs, Stéphane Denève dirige, avec raison et fort bien, une partition qui intègre les plus récentes découvertes de Jean-Christophe Keck pour aboutir à la version la plus proche possible des intentions du compositeur. Scindée en deux DVD, cette captation procure une impression mitigée, avec une scission qui correspond à peu près à la coupure du spectacle à moitié. Lorsqu’on découvre le prologue et le premier acte, on se réjouit de retrouver Laurent Pelly au mieux de sa forme : visuellement, on se situe dans le dernier tiers du XIXe siècle, soit l’époque de la création de l’œuvre, et les étudiants sont plutôt les membres bourgeois de quelque club ou cercle masculin. Des étudiants, il y en a en revanche dans l’acte d’Olympia, qui nous transporte dans le cours de physique dispensé par un savant contemporain de Charcot ou de Pasteur. On est fasciné par le décor véritablement diabolique qu’a conçu Chantal Thomas, dont les transformations constantes, sous les éclairages très maîtrisés de Joël Adam, contribuent à créer l’atmosphère fantastique idoine. Portée par un appareil impressionnant qui lui permet des déplacements en tous sens, de long en large comme de bas en haut, Olympia reste un automate sans basculer dans le délire que s’autorisent à ce moment certains metteurs en scène. Avec le deuxième DVD, l’enthousiasme baisse d’un cran : l’acte d’Antonia donne encore lieu à quelques effets réussis, avec un Miracle-Nosferatu et un décor encore assez frappant, mais – comme presque toujours dans Les Contes d’Hoffmann – l’acte de Venise marque le nadir théâtral et musical du spectacle, l’épilogue ne relevant pas vraiment le niveau. Alors qu’on pensait jusque-là assister à l’enterrement définitif de la version Choudens, l’acte de Giulietta s’avère totalement informe, criblé de dialogues envahissants, et le final retrouvé ne fait pas oublier le superbe et totalement apocryphe septuor de jadis. Quant à la mise en scène de cette deuxième moitié, la froideur de l’atmosphère générale ne permet pas de mettre en valeur un morceau aussi magnifique que l’air de Nicklausse « Vois sous l’archet frémissant », qui semble ici comme escamoté, et la réduction de la mère d’Antonia à une vidéo projetée en négatif sur le fond du décor prive ce moment d’un peu de sa dimension inquiétante.
La distribution vocale confirme hélas cette sensation de déclin vers la fin de l’œuvre. La chanteuse slave qui interprète Giulietta s’exprime dans un français caricatural, et l’on est ravi que cette version ne lui laisse aucun air à chanter en solo. Kathleen Kim est une Olympia sans charme particulier mais précise dans sa vocalisation, ce qui est en somme ce qu’on attend principalement d’une marionnette. Natalie Dessay campe une Antonia touchante, mais « Elle a fui, la tourterelle » montre cruellement tout ce qu’il lui manque en termes de largeur vocale pour prétendre à de tels rôles. La distribution féminine est dominée par le Nicklausse de Michèle Losier : timbre chaud, diction incisive, présence scénique, voilà une mezzo sur qui il faudra compter à l’avenir. Parmi les confrères de ces dames, on passera rapidement sur le Spanlanzani, qui n’a ici pratiquement rien à chanter, et l’on a connu Francisco Vas plus inspiré que dans les quatre valets. L’ennui de renoncer à Choudens, c’est qu’il faut aussi en passer par de nombreux dialogues parlés, pierre d’achoppement pour la plupart des chanteurs étrangers. Le français de Carlos Chausson est suffisamment bon pour rendre son Crespel très acceptable, mais là où il y a miracle à proprement parler, c’est dans la diction de Michael Spyres, auprès duquel un Nicolaï Gedda semble avoir toujours baragouiné. Le ténor américain compense amplement des aigus pas toujours éclatants par un investissement scénique hors pair. Il est heureux que Barcelone ait pu compter sur un pareil Hoffmann, car Laurent Naouri est un acteur exceptionnel dans le quadruple rôle des méchants : plus baryton que basse, il n’en a pas moins « de l’esprit comme un diable » et « triomphe par la peur ». Une version nécessaire pour cet Hoffmann et ce Lindorf-Coppélius-Miracle-Dapertutto, et surtout pour connaître la « nouvelle partition » des Contes d’Hoffmann, même si Choudens n’a sans doute pas encore dit son dernier mot.
____