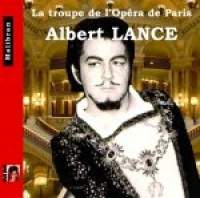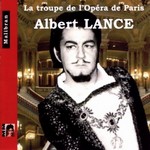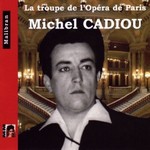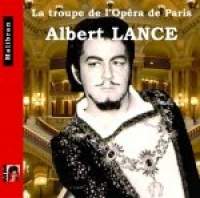Quelques mois après la parution d’un ouvrage consacré à l’âge d’or du chant français (voir compte rendu), la firme Malibran crée une série de disques consacrés aux membres de la troupe de l’Opéra de Paris. Les premiers volumes sont consacrés à des ténors, dont deux sont décédés cette année. Outre les personnalités ainsi honorées, on redécouvre au passage à quels sommets s’élevait alors ladite troupe, quand on entend, même pour quelques répliques, l’exceptionnelle Charlotte de Régine Crespin, ou la stupéfiante Carmen de Jane Rhodes. Avec des chanteurs comme Albert Lance, Hérodiade de Massenet est une œuvre qui avait pleinement sa place au répertoire. Ce ténor d’origine australienne était un Faust sans doute moins raffiné que son collègue Alain Vanzo, mais quelle flamme, quelle fougue, quel élan dans son Werther ! Voilà un chanteur qui semblait se donner à fond dans chaque incarnation, accompagné par un orchestre qui n’est nullement en reste dans ce domaine. Il est également un excellent Hoffmann, même si son chant se situe loin des scrupules musicologiques qui dominent notre époque (l’air de la Fleur est couronné par un aigu donné à pleins poumons…). Les enregistrements sont bien antérieurs à la suppression de la troupe par Rolf Liebermann, mais si Albert Lance chantait encore en 1973 comme il chantait en 1963, son renvoi relève du plus parfait scandale, car il n’avait rien à envier aux artistes « de classe internationale » qui supplantèrent à peu près tous les chanteurs hexagonaux à partir de 1973. Il est d’ailleurs dommage que la plaquette soit si avare en informations, au moins sur la date des différentes prises, qui permettrait de justifier certaines évolutions de la voix, de la qualité de la prononciation, etc. La qualité sonore est parfois très aléatoire, mais c’est le prix à payer pour entendre ces chanteurs négligés par les studios d’enregistrement. De ce point de vue, le très large extrait du Bal masqué est parfois à la limite du supportable, mais sa valeur de témoignage est telle qu’il faut se forcer à l’écouter jusqu’au bout, pour entendre l’Ulrica de la grande Denise Scharley, l’Oscar de Mady Mesplé, et le fort beau Riccardo d’Albert Lance, très à l’aise en italien.
Egalement décédé en 2013, Georges Liccioni était un ténor d’un tout autre genre, doté de moyens bien différents, même si l’on retrouve sur le disque qui lui est consacré quelques-uns des mêmes passages obligés, comme l’air de Roméo ou la cavatine de Faust, l’air de la Fleur avec le même aigu claironné ou « Le ciel luisait d’étoiles » de Tosca (en français, forcément). Les premières plages du disque laissent une impression mitigée : malgré une diction incomparable qui fait aujourd’hui rêver, une certaine nasalité du timbre et certaines syllabes un peu pincées rendent ce chant un peu désuet. L’on ne trouve pas chez Liccioni l’infinie subtilité de nuances qu’un Vanzo déployait en Nadir ou en Gérald de Lakmé. Il est pourtant évident que cet art du chant-là est bien préférable à ce dont nous sommes aujourd’hui contraints de nous contenter, en ces temps de pénurie. Et surtout, au bout de quelques plages, tout change : le Mylio est extrêmement convaincant, tout comme son Faust et son superbe Don Carlos, et peut-être cela tient-il au fait qu’il semble s’agir de prises live. On a néanmoins un peu de mal à l’imaginer en baryténor rossinien, comme le suggère la plaquette d’accompagnement, d’autant que son italien n’est pas des plus idiomatiques. Son Alfredo pâtit notamment de tempos bien trop lents qui font ressembler « De’ miei bollenti spiriti » à une berceuse. L’air de Leopold de La Juive nous montre un Georges Liccioni d’une aisance souveraine dans le falsetto, et une rareté, un air tiré de la Colomba d’Henri Büsser (1921) vient opportunément nous rappeler que la création programmée pour mars prochain à l’Opéra de Marseille n’est pas la première adaptation lyrique du roman de Mérimée.
Michel Cadiou, lui, est encore de ce monde, et son répertoire est nettement moins lourd (les dernières plages du disque sont même consacrées à l’opérette). Roland Mancini le présente comme un précurseur possible des Rockwell Blake et autres Juan Diego Florez, parce qu’il excellait dans Boieldieu et Donizetti où il pouvait utiliser un remarquable suraigu. La voix est-elle néanmoins vraiment celle qu’on attend dans La Favorite ? Il est permis de la trouver trop légère même pour le Gérald de Lakmé. Son Des Grieux est vraiment trop suave, même pour le Songe, et les aigus sont parfois très ouverts. On l’aura compris, il s’agit aussi d’une affaire de style, qui paraît aujourd’hui bien daté. Difficilement acceptable en duc de Mantoue (et quelle exécrable version française !), l’interprète semble plus à sa place dans la fameuse romance de Maître Pathelin, ou surtout dans Les Cloches de Corneville, et dans le très savoureux duo « Sans femme, l’homme n’est rien », tiré de la rarissime opérette de Lecocq Les Cent Vierges.