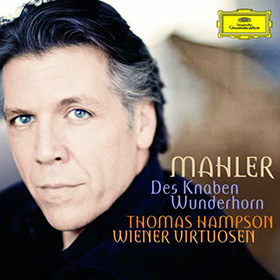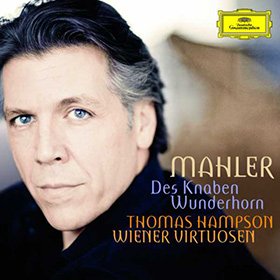Depuis la Renaissance, lorsque les compositeurs se sont attelés à la mise en musique d’un texte poétique, ils ont pris d’infinies précautions : il était entendu que le musicien restait en retrait derrière le poète et que ses apparitions incidentes n’étaient tolérées que dans le strict respect de cette préséance. Et puis Wagner est arrivé, composant ses propres vers, et subjuguant le poème sous la loi musicale. Dès lors, rien n’a plus été comme avant : la voix chantée s’insère dans un tissu musical ample et autonome où s’entremêlent toutes les voix musicales, égales en dignité.
C’est dans cette optique qu’il faut écouter le Knaben Wunderhorn : le matériau poétique populaire que Mahler prend pour support n’est pas — grande première dans la musique germanique — retravaillé par Goethe ou Herder. Mahler prend ces textes anonymes tels qu’Arnim et Brentano les ont édités, avec leurs imperfections métriques, leurs intonations campagnardes, et leurs rimes balourdes. On y parle simplement d’amour, de ménage, de garnison, de piété, de malheur, de mort et de résurrection.
Et sur ces motifs éternels Mahler, dans une ample et complexe évocation musicale, surimprime la Vienne immobile et féodale de 1880. Une Vienne excessive et contradictoire, où l’escarpin de la valse rappelle sans cesse le sabot crotté du ländler, où le raffinement urbain corrompt des âmes qui ne rêvent qu’innocence et Natur, où défile quotidiennement une armée oisive de désert des Tartares à l’héroïsme velléitaire et intermittent, où l’uniforme écarlate et blanc engonce le petit bourgeois de province, qui, dans son patois rustique, étouffe sous une discipline militaire et un code d’honneur incompatibles avec ses aspirations autant qu’avec sa classe sociale, et se désole, grossier et empoté qu’il est, de ne pas séduire la fille du marchand de nouveautés. Tout cela a été raconté mille fois : Kropatsch, Leutnant Burda, Radestkymarsch, Leutnant Gustl…
Toute cette Vienne qui prête autant à rire qu’à pleurer, tout à la fois grossière et sophistiquée, sincère et ironique, Mahler l’a concentrée dans son Knaben Wunderhorn, parce qu’elle est l’effet et que les vers sont la cause : la naïve simplicité des vers du XVIIe ou du XVIIIe siècle aboutit simultanément à la Grobheit, la gaucherie épaisse, et à la Künstelei, raffinement artiste, de la Vienne de 1880, et l’une et l’autre s’entretissent sans qu’on les puisse désintriquer.
Mahler n’illustre donc pas chaque poème un par un : il enserre chacun d’un long pan d’un même tissu viennois où se retrouvent, en proportions variables, les trois temps du ländler ou de la valse, la topique militaire (cuivres et fifres, timbales, caisse claire, et tempo de marche), la mort (rythmes pointés de marche funèbre), l’art (violoneux de village ou orchestrateur habile à moduler dans les tonalités éloignées). Les trois premières notes de « Rheinlegendchen », à elles seules, concentrent, avec leurs timbre plaintif de cordes, leur harmonisation en mouvement contraire et leur repos sur la sensible, toute cette mélancolie viennoise : la Vienne de Mahler est fragile et écartelée, non pas comme l’Allemagne de Brahms qui s’appuie sur les fondations sures de toniques énergiques, mais comme ces chansonnettes à qui l’on veut faire porter une charge plus lourde que ce qu’elles peuvent vraiment souffrir.
C’est tout cela que l’on entend dans ce Knaben Wunderhorn pour petit ensemble et baryton. Les Wiener Virtuosen, solistes du Philharmonique de Vienne, portent avec incroyablement de tact chaque intention, chaque couleur, et leur sens de l’accentuation est d’une délicatesse infinie. Les cordes y sonnent d’une expressivité à la fois grêle et tendre, les cuivres enflent comme des baudruches en de soudaines bouffées de forfanterie, et les bois savent admirablement composer les timbres frustes et fêlés du chalumeau de pâtre. Cette pâte sonore incroyablement subtile et diverse donne, en fin de compte, une belle impression d’unité d’atmosphère, qui, au lieu de décevoir, se renforce sans cesse à la réécoute, surtout lorsque l’on se rend compte qu’ils se risquent à travailler les matières sonores les plus difficiles qui soient : l’aigre, l’âpre, l’astringent, le tannique, auxquels ils confèrent une magnifique nécessité esthétique.
Thomas Hampson, porté par l’expressivité de l’orchestre, choisit la réserve : il a raison. Il n’abuse pas des effets d’émission (tout juste dans « Verlorne Müh’ ! ») et veille à ne pas s’éloigner trop du sobre dépouillement qu’imposent « das himmlische Leben » et « Urlicht », au terme du cheminement. La voix ne pèse jamais, ponctue les vers avec naturel, et semble comme suspendue dans les longues vocalises. Cette légèreté, de scansion comme d’émission, contribue à insérer la voix dans les fils multicolores du petit orchestre, parmi le violon, le cor, ou le hautbois. Il en résulte une suprême élégance, celle des grands interprètes d’autrefois, qui se souciaient davantage de vérité que de joliesse, et qui, puisant dans leur haute culture autant que dans leur grande âme, savaient puissamment peindre l’ambiguïté des sentiments mêlés.
Hugues Schmitt