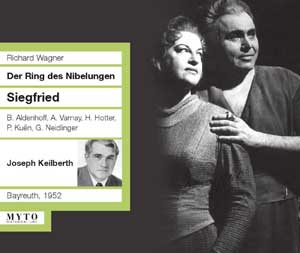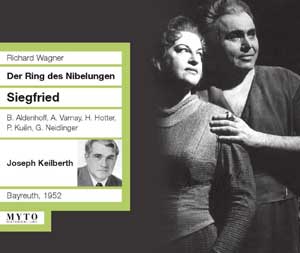Le 29 juillet 1951, le « Nouveau Bayreuth » ouvre ses portes avec la Symphonie n°9 de Beethoven dirigée par Wilhelm Furtwängler. Officiellement, c’en est fini de ce que Thomas Mann appelait le « Théâtre de cour d’Hitler ». Officieusement, les (ex-)nazis, les Altwagnerianer, sont toujours là, furieux des mises en scènes de Wieland Wagner, débarrassées du réalisme des productions d’antan aux relents nationalistes. Le travail du petit-fils du maître repose en grande partie sur les idées d’Adolphe Appia (1862-1928), décorateur et metteur en scène suisse qui avait publié en 1895 La mise en scène du drame wagnérien, opuscule rejeté par Cosima, veuve du compositeur, qui règne alors en maître absolu sur la Colline verte. Celle-ci note, au sujet des écrits d’Appia : « Tout ce qui est juste dans sa brochure est superflu, parce que correspondant aux données de la partition, le reste est faux jusqu’à l’enfantillage (1)». Plus clairvoyant que sa grand-mère, Wieland y puise son inspiration.
Mais le Neubayreuth, c’est aussi une avalanche de grands noms de l’histoire du chant. A la réouverture, Wolfgang Windgassen fait ses débuts dans le « temple » avec Parsifal et le public assiste aux prises de rôles de Martha Mödl (Kundry), Leonie Rysanek (Sieglinde), Astrid Varnay (Brünnhilde) ou encore Elisabeth Schwarzkopf (Eva et Woglinde). A la tête de l’orchestre, Hans Knappertsbusch et Herbert von Karajan font des merveilles. Décidément, en dehors de toute considération politique, il fut un temps où le pèlerinage de Bayreuth n’était pas vain. La Colline, qui joue aujourd’hui sur le mythe du lieu, n’est même plus l’ombre de cette époque. Mais revenons au « Nouveau Bayreuth », an II (1952), date de l’enregistrement qui nous occupe, où Joseph Keilberth prend les rennes de la Tétralogie, qu’il conservera jusqu’en 1956, en alternance avec Krauss et « Kna », l’ennemi juré. Plusieurs exécutions de ces Ring sont enregistrées, dont celui de 1955 qui fait figure de « référence » dans le discographie de Keilberth (Testament). Trois ans plus tôt, la réussite était déjà non négligeable.
La captation de ce Siegfried étant tombée dans le domaine public, elle a fait l’objet de plusieurs rééditions, que ce soit en tant que deuxième journée du Ring intégral (Archipel, Arlecchino, Cantus Classic, Golden Melodram) ou comme épisode séparé (Arlecchino, Cantus Classic). C’est aujourd’hui au tour du label Myto de la publier, revenant sur cette Tétralogie en quatre coffrets séparés dont l’habillement se réduit au strict minimum. Seuls les détails de la distribution et l’ordre des plages nous sont donnés, sans aucun texte de présentation ni minutage et, bien évidemment, sans reproduction ni traduction du texte chanté. C’est là la condition pour proposer un enregistrement au prix très doux (quoi que le minutage n’eût pas coûté plus cher).
Soulignons pour commencer le Wotan–Voyageur de Hans Hotter qui fait, cette année-là, sa première apparition dans le rôle à Bayreuth. Hotter, en dieu profondément humain, va chercher le contenu théâtral de son rôle au plus profond du texte et transforme en or tout ce qu’il touche, illuminant le début du troisième acte de sa prestation magistrale. Le Siegfried de Bernd Aldenhoff semble parfois un rien trop « mature » pour le personnage du jeune héros qu’il interprète mais on a vite fait d’oublier ce détail pour céder au charme de son charisme vocal. Si Paul Kuën manque deux ou trois notes graves, il n’est pas moins un Mime parfaitement campé, au juste tempérament dramatique. Impossible de rester insensible à l’électrisante Brünnhilde d’Astrid Varnay, qui conquiert dès ses premiers mots (Heil dir, Sonne ! Hail dir, Licht !).Une entrée amenée de mains de maître par le chef, faut-il le souligner. La prise de son, live, de 1952 ne flatte pas le Fafner de Kurt Böhm et il faut tendre l’oreille pour comprendre Rita Streich en « Voix d’oiseau ». Il en va malheureusement de même pour l’Erda de Mélanie Bugarinovic pourtant impressionnante de charisme et de profondeur. Ce plateau vocal est remarquable d’homogénéité. Tous semblent regarder dans la même direction et démythifier l’œuvre pour tirer de ces dieux, héros, gnome ou dragon ce qu’ils ont de plus humain.
Il reste à commenter la prestation de Keilberth, magistrale leçon de direction wagnérienne d’un grand chef d’opéra qui met son expérience straussienne au service de la musique de l’auteur du Ring. Keilberth semble tailler finement son accompagnement dans le roc, allégeant la texture orchestrale autant qu’il est possible de le faire tout en conservant des couleurs sombres et un sens dramatique aiguisé. Et Keilberth de laisser l’orchestre s’embraser lorsqu’il le faut, malgré une légère baisse de tension au milieu du deuxième acte. Mais il est surtout un chef qui, plutôt que de forger un écrin à ses chanteurs (comme le faisait Karajan par exemple), se met à leur niveau pour respirer avec eux. En découle une fluidité formidable permise par une vision d’ensemble de la partition. On oublie vite ses classiques – Böhm (Philips, live), Solti (Decca, studio), Karajan (DGG, studio)- pour se laisser transporter par cette narration magnifique. On commente la pénurie de chanteurs wagnériens depuis des décennies mais le problème ne s’y résume pas. Car même si, au long de sa carrière, Keilberth n’a pas toujours été exemplaire, voire auteur de ratages manifestes, quel chef est aujourd’hui capable d’une vision aussi fine, intelligente et racée de Wagner ? Barenboïm et ses effets téléphonés ? Thielemann, dépositaire auto-proclamé d’une mythique tradition germanique, qui tente de transformer cette musique en lourde soupe saxonne ? Rattle qui va on ne sait où, mais qui y va ? Certainement pas… Combien de temps encore les wagnérophiles devront-ils regarder dans le rétroviseur ?
Nicolas Derny
(1) Cité dans A. Appia, Œuvres complètes, Lausanne, L’Age d’homme, 1991, vol . 4 p. 259