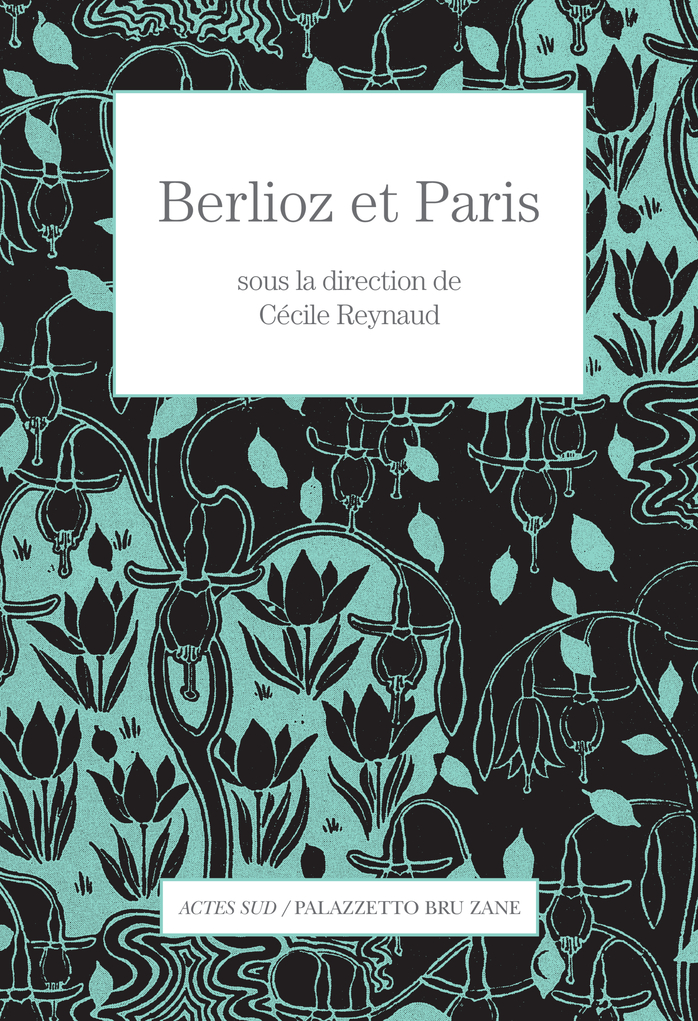En décembre 2019, un colloque international organisé par Cécile Reynaud interrogeait la relation entretenue par Berlioz avec Paris, à savoir la place occupée dans la carrière du compositeur par une ville alors en pleine mutation. Berlioz, qui l’habita de 1821 jusqu’à sa mort en 1869, fut le témoin privilégié de cette transformation due à une croissance rapide de la population. Le nombre de Parisiens doubla en un demi-siècle, de 1801 à 1851, pour dépasser le million en 1846.
Les actes de ce colloque donnent lieu aujourd’hui à une publication, sous la direction de la même Cécile Reynaud, dans la collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane. Comme à chaque fois, il s’agit d’une somme destinée d’abord aux chercheurs, aux inconditionnels du bouillant Hector mais aussi aux amoureux de la ville qui n’était pas encore lumière.
C’est en marchant sur les brisées du compositeur de La Damnation de Faust que le lecteur est invité à parcourir le Paris du XIXe siècle, des salles de concert à l’Institut de France en passant par l’église des Invalides où fut créé sa Grande Messe des morts le 5 décembre 1837 (avec Gilbert Duprez en soliste et rien moins que 300 exécutants).
Classés par chapitre, les angles de vue varient comme autant de panoramas sur la personnalité et l’œuvre du musicien le plus statufié de France – et le premier à Paris, en 1886 au centre du square qui porte désormais son nom dans le 9e arrondissement.
Berlioz et les salons, Berlioz et l’association des artistes musiciens, Berlioz et les expositions, Berlioz et la révolution industrielle, Berlioz et l’administration des théâtres parisiens nous rappellent le bouillonnement culturel de la capitale de la France sous la Restauration jusqu’au Second Empire. « Il n’y au monde que Paris ; c’est une ville électrique qui attire et repousse successivement » écrit le compositeur à son père en 1846. Immergé dans ce chaudron artistique, le jeune Hector abandonne ses études de médecine pour s’essayer à la composition musicale. L’échec de Benvenuto Cellini à l’Opéra en 1838 déporte sa carrière de la scène vers le concert, sans cependant entamer ce qu’Etienne Jardin, l’un des auteurs, appelle son « rêve de monumentalité ».
Feuilletoniste dès 1823 dans Le Corsaire, puis de 1835 à 1863 au Journal des débats et à La Revue et Gazette musicale de Paris, le littérateur n’a rien à envier au musicien. Le regard critique qu’il porte sur la musique de ses contemporains lui vaut quelques inimitiés, qui auront à cœur de lui rendre la monnaie de sa pièce le moment venu. « La presse parisienne ne fut pas tendre pour Berlioz de son vivant » rappelle Nizam Kettaneh dans son étude sur le combat esthétique que se livrèrent par journal interposé Ernest Reyer et Paul Scudo, ce dernier écrivant tout de go lors de la création de Benvenuto Cellini : « M. Berlioz a le génie de la destruction ; il trouve moyen d’en finir en une fois avec la mélodie et le rythme, et d’anéantir l’un par l’autre ces deux éléments essentiels de toute musique. ». Ce à quoi Reyer répliquera plus tard « Il y a vingt-cinq ans que Berlioz lutte contre les amateurs et les faiseurs d’ariette. Il n’aime pas ce qu’il appelle très spirituellement le genre parisien ; il le traque partout où il le rencontre, et le rencontre partout. […] Il faut avouer que l’injustice dont on a si largement usé à son égard pourrait bien servir d’excuse à ses accès de mauvaise humeur ».
L’ouvrage se termine là où s’achève toute vie : au cimetière, en l’occurrence celui de Montmartre. Ici repose aujourd’hui Berlioz, en attendant l’hypothétique transfert de ses cendres à la seule « place qui scellerait enfin une totale reconnaissance de la nature supérieure de son génie » : le Panthéon.