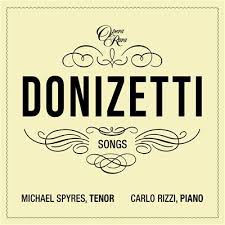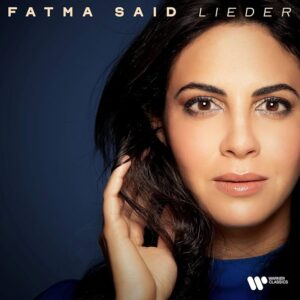C’est de Vienne, par téléphone, que le brillant chef suisse nous a accordé un entretien. Simple, affable (comme le sont les plus grands), s’exprimant toujours dans un très bon français malgré son départ de Paris depuis 2020, Philippe Jordan s’est confié sur son métier, sur le concert du dimanche 2 mars à Monte-Carlo et sur Pierre Boulez, à qui l’édition 2025 du Printemps des Arts est dédiée. En tout cas, le fils d’Armin Jordan finira cet été 2025 ses cinq saisons au Staatsoper pour se consacrer au répertoire symphonique en tant que chef invité (pour deux saisons en free-lance), après des années presque uniquement dédiées au répertoire lyrique dans la capitale autrichienne – et ce, avant de prendre avec enthousiasme la tête de l’Orchestre national de France en 2027. Il se dit en effet « très pressé, très excité » de débuter ce nouveau chapitre dans sa carrière.
Au-delà de l’hommage à Pierre Boulez, quelle a été votre source d’inspiration pour ce concert-prélude au festival ?
Avec Cecilia Bartoli (directrice de l’Opéra de Monte-Carlo, NDLR)et l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, nous nous sommes décidés très tôt pour le deuxième acte de Tristan puis quelques semaines plus tard, avec Bruno Mantovani (compositeur et directeur artistique du Printemps des Arts, NDLR), nous nous sommes mis d’accord pour l’Adagio de la dixième symphonie (inachevée) de Mahler. Deux oeuvres que chérissait Pierre Boulez en effet, et des compositeurs qui sont au coeur de mon travail. Voilà donc un répertoire que je connais bien, que l’orchestre connaît aussi avec par exemple Marek Janowski, qui a beaucoup travaillé avec eux Wagner (dans les années 2000, NDLR). Plus intimement, je dois dire que je me réjouis de diriger un orchestre avec lequel mon père a enregistré Parsifal il y a maintenant plus de quarante ans.
Que représente Pierre Boulez, chef et compositeur auquel le festival rend hommage, pour vous et pour notre temps ?
Pierre Boulez tient une place énorme et pas seulement en France. Dans l’avenir nous verrons si la musique contemporaine est toujours jouée, et si elle a de la valeur, mais en attendant, on aime les œuvres de Boulez et on leur reconnaît de la grandeur. C’est la postérité qui décide. Cependant Pierre Boulez a de plus en plus d’importance, me semble-t-il, dans le monde musical depuis sa disparition. Assistant de Daniel Barenboim, j’ai quasiment fait mes premiers pas avec ce compositeur, il y a vingt ans. De plus, pendant mes années à l’Opéra de Paris, j’ai été très touché par le fait qu’il soit souvent venu (et pas seulement aux premières du Ring). Il s’est toujours intéressé au répertoire de l’Opéra (je me souviens d’une de ses visites pour un Don Giovanni) et à la vie musicale jusqu’à sa mort. Il m’a même fait visiter l’IRCAM et nous avons beaucoup parlé. Nous partagions évidemment la musique de Wagner. En tant que chef, je ressens une immense admiration pour le chef Boulez.
Quelle émotion ou message particuliers voudriez-vous communiquer lors de ce concert du dimanche 2 mars ?
Je voudrais faire entendre à quel point ces deux œuvres sont révolutionnaires. La dixième symphonie de Gustav Mahler est inachevée mais à analyser la partie entièrement composée, on s’aperçoit qu’il va beaucoup plus loin que dans sa neuvième. On ne sait quel territoire il aurait atteint s’il avait vécu, dont l’atonalité, avec cet accord dissonant à la fin de l’adagio traité avec beaucoup d’émotion. Comme chez Richard Wagner, son écriture musicale relève de l’intellect et influence l’émotion, et vice-versa. Lors de ce concert, je penserai à Boulez, grand chef wagnérien qui aimait cet adagio mahlérien. C’est tout à fait un programme en son honneur.
Les chanteurs invités pour le deuxième acte de Tristan (Anja Kampe, Andreas Schager, Ekaterina Gubanova, Georg Zeppenfeld) ont été choisis par vous ?
Avec les membres de la direction de l’Opéra de Monte-Carlo, j’ai évidemment voulu ces chanteurs, qui appartiennent à ma famille quelque part, ma famille wagnérienne. Je les ai souvent dirigés, dans Tristan, Parsifal et autres opéras wagnériens à Berlin, à Paris et à Vienne. C’était une évidence.
Avez-vous un rituel ou une préparation particulière avant un concert, peut-être en tant que chef invité ?
Le même qu’en tant que directeur musical : il faut bien travailler et dormir l’après-midi du jour J en espérant qu’on aura l’inspiration le soir (rires).
Que ressentez-vous quand vous dirigez une fois de plus le deuxième acte de Tristan und Isolde par exemple ?
Ce qui est extraordinaire avec les opéras de Wagner, c’est que nous vivons à chaque nouvelle représentation une expérience neuve. Je découvre toujours un nouveau détail, une nouvelle vibration, je fais toujours une nouvelle découverte que ce soit dans la partition, ou dans l’émotion du moment, tout dépend du moment de notre vie ou de la soirée. Certes, c’est la même chose avec chaque compositeur mais c’est beaucoup plus vrai avec Richard Wagner. Ses œuvres tissent une relation spécifique au temps, Tristan tout particulièrement. Quelque chose a lieu entre la musique, le public et les musiciens, qui alors forment une communauté.
Quel chef voulez-vous être ? Un guide, un médiateur, un interprète ?
Je me vois comme un musicien. Et dans ce métier de musicien, sans doute un médiateur. Quel beau mot ! Il me faut accorder toutes les parties ensemble, l’œuvre, les musiciens et le public, pour servir la plus haute valeur de la musique. Ce qui importe, comme l’a dit Daniel Barenboim, c’est la réalisation, non l’interprétation. La touche personnelle existe mais elle compte peu. Il s’agit plutôt de répondre le mieux possible aux questions que pose l’œuvre.
C’est un grand moment spirituel qui attend le public le 2 mars ?
Absolument. Les thèmes de l’amour et de la mort se répondent comme en un miroir. La nostalgie de la mort chez Tristan répond à la grande méditation sur cette même mort dans l’Adagio de la dixième symphonie. Une méditation non dépressive, toute spirituelle – quoique chez Tristan, cela est empreint de tristesse comme son nom le dit. Ces œuvres définitivement nous parlent de retrouver d’autres dimensions, inconnues, dont on pressent qu’elles existent.
Vous finirez votre mandat au Staatsoper de Vienne cette année avec une reprise de votre cycle des opéras de Mozart, n’est-ce pas ?
Tout à fait. Cette exploration du cycle da Ponte/Mozart a été le pilier central de mon mandat. J’ai pu travailler pendant cinq années avec un ensemble permanent, avec les mêmes vingt personnes dont un metteur en scène, Barrie Kosky. Pour cette dernière saison, il est temps de montrer où nous sommes arrivés au terme de notre long travail.