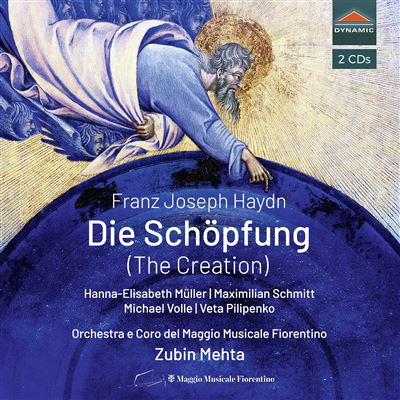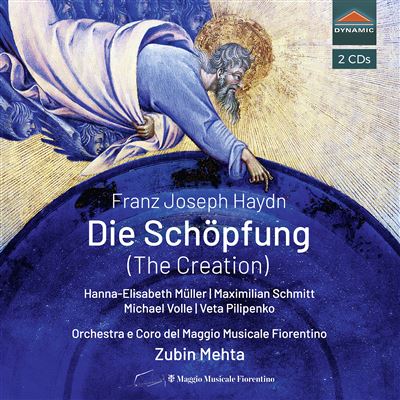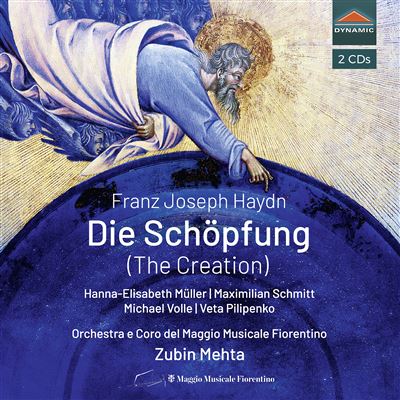Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Zubin Mehta n’avait jamais gravé La Création de Haydn au disque. Malgré une fréquentation assidue de Haydn en concert (on se souvient avec la chair de poule d’une 104e symphonie donnée à Salzbourg avec les Wiener Philharmoniker, où tout semblait danser autour de nous), rien ne permettait de fixer pour la postérité l’idée que le maestro se faisait de cette œuvre mythique entre toutes.
Arrivé au crépuscule d’une carrière de six décennies, le chef, âgé de 85 ans, frappe un grand coup avec cette triple parution CD-DVD-Blu-Ray, enregistrée à Florence, qui s’accompagne d’un autre enregistrement capté à Munich, sous le label de l’orchestre philharmonique local. Le concert de Florence etait supposé commémorer les 50 ans des débuts in loco de Zubin Mehta. La crise sanitaire aurait dû en avoir raison, mais le chef a tenu bon contre vents et marées, et les représentations ont eu lieu, même si c’est sous une forme très contrainte. Signe que Zubin Mehta accorde un prix tout particulier à cette œuvre. Signe aussi que c’est sa conception qui sera au centre de l’attention et des lignes qui vont suivre.
Brisons d’emblée le suspense. Mehta ne tient aucun compte des acquis du mouvement baroque. Pour lui, La Création est une fresque romantique, qui brasse la totalité de nos existences et vise, par son ampleur même, à aider l’auditeur à se situer dans l’univers. Au diable le non vibrato, les cuivres naturels ou les petits effectifs choraux. Sa baguette déclenche les forces telluriques les plus primaires, les grondements du tonnerre, le bruit des astres qui se frottent les uns aux autres, le feulement de Léviathan, les cohortes d’anges qui louent le Seigneur. Un monde en musique naît sous nos yeux, dans une optique panthéiste et dyonisiaque qui n’est pas sans rappeler celle de Leonard Bernstein (Deutsche Grammophon).
Si la conception de l’œuvre séduit au-delà de toute mesure, la réalisation concrète est plus difficile. La faute en incombe d’abord aux conditions de l’enregistrement. Comme le montre la version filmée, les règles sanitaires les plus strictes ont été imposées par les autorités italiennes. Cela signifie des choristes masqués, des instrumentistes à vent encagés dans du plexiglas, et des distances kilométriques entre tout le monde. Obtenir une cohésion dans de telles circonstances relève de la mission impossible. Surtout qu’il faut aussi reconnaitre que la qualité des pupitres de l’orchestre du Mai musical florentin n’est plus tout a fait ce qu’elle était.
Il suffit de réécouter les enregistrements verdiens du même Mehta réalisé dans les années 90 pour réaliser que l’orchestre a perdu en virtuosité pure. Plus d’un départ est brouillon, plus d’un instrumentiste se prend les pieds dans le tapis, et certaines fugues ressemblent à un sauve-qui-peut. Mais le professionnalisme de Mehta permet de faire en sorte que les musiciens arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Sa battue ample et souple est comme un phare dans la tempête : finalement, tout le monde arrive à bon port. Et si la précision est souvent hasardeuse, l’orchestre a conservé son coloris très moëlleux, mélange irrésistible de clarté latine et de fondu germanique, hérité de l’époque glorieuse de Riccardo Muti, sans même remonter jusqu’à Vittorio Gui. Tableau identique pour le chœur du mai musical florentin : on frôle souvent l’accident ( « Stimmt an die Saiten ») mais le corps du son reste toujours homogène, et l’enthousiasme des chanteurs finit par emporter l’adhésion.
Les solistes ne sont pas sur les mêmes sables mouvants. Sans doute plus favorisés par les conditions de la captation, ils offrent des prestations qui marquent, dans des rôles qui ont pourtant été chantés par les plus grands. Ils sont aussi gâtés par la prise de son qui, à rebours du style habituel dans les oratorios, les place au premier rang, avec une vie et une présence bienvenues. Maximilian Schmitt a affirmé son art depuis l’enregistrement de Philippe Herreweghe (Outhere – Phi) : une voix idéalement placée, une ligne souveraine et une puissance comme libérée du carcan qui avait tendance à l’enserrer. Hanna-Elizabeth Müller n’y va pas par quatre chemins : c’est un opéra sacré qu’elle chante ici, et elle déploye sans pudeur un timbre voluptueux à souhait, ne faisant qu’une bouchée des vocalises de Gabriel, et transformant Eve en tentatrice absolue. On avoue ne pas avoir résisté à ses charmes. Encore un cran au-dessus de ses deux partenaires, la prestation de Michael Volle est historique. Pour bien en mesurer la portée, il faut d’abord dire un mot de la partie de Raphael. Elle est la plus importante en durée dans l’oratorio (surtout si on y rajoute Adam, comme c’est souvent le cas), et c’est largement sur elle que repose la narration du récit. Elle est ensuite d’une nature très hybride, puisqu’elle exige une forte capacité de déclamation, mais aussi un attendrissement dans un air comme « Nun scheint im vollen Glanz », où le lyrisme prédomine nettement. Par dessus le marché, la tessiture est un problème presque insoluble, puisque Haydn demande quelques notes très hautes, accessibles aux seuls barytons, tout en descendant très bas dans certains récitatifs. Une ambiguité qui explique que des chanteurs aussi différents que Dietrich Henschel et Kurt Moll se soient illustrés avec brio dans le rôle. Michale Volle parvient à faire la synthèse de toutes ces contradictions : impérial d’autorité dans ses récitatifs, enivrant de lyrisme lorsqu’il s’agit de chanter la gloire du Créateur, et aussi à l’aise dans les aigus que dans les graves, donnant notamment un « Und Gott schuff grosse Wallfische » qui laisse pantois, traversant toutes les régions de la voix humaine avec l’aisance d’un cheval de course. Un tel exploit est d’autant plus surprenant que le chanteur avait dans le passé laissé voir quelques « trous » dans son registre grave.
Pour son chef en transe, son chœur enthousiaste, ses solistes opératiques et son Michael Volle historique, cette version est donc à connaître, même si elle ne bouleverse pas la discographie.