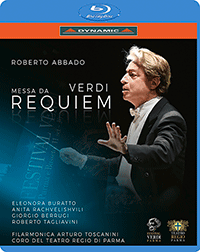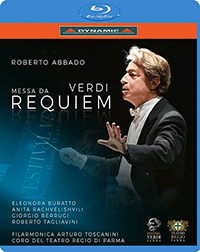Ce 18 septembre 2020, le Festival Verdi de Parme figure parmi ceux dont la courte trêve dans la lutte contre la pandémie a permis la tenue, dans des conditions strictes mais à peu près normale, nonobstant les masques qui demeurent dans l’orchestre, le Filarmonica Arturo Toscanini. La scène tourne le dos à l’élégant et imposant palais ducal du parc éponyme. Le Teatro Regio est à quelques dizaines de mètres, de même que la maison natale de celui qui a donné son nom à l’orchestre.
Cette trêve, que nous espérions tous bien plus durable, n’a pas effacé le traumatisme vécu notamment par l’Emilie-Romagne, qui, comme la Lombardie voisine, a payé un tribut particulièrement lourd en Italie. L’annonce initiale destinée à saluer l’engagement des soignants et des bénévoles est ainsi d’emblée suivie d’une minute de silence pour rendre hommage aux victimes parmesanes de la pandémie, à qui le concert est dédié.
Roberto Abbado est un bon chef de théâtre, même s’il n’a pas le génie de son oncle Claudio. Le visage grave, il ne tire pas pour autant la partition vers ces effets qui ont pu faire dire aux méchantes (et très injustes) langues que son Requiem était le meilleur opéra de Verdi. Les choix de tempi sont plutôt rapides sans ostentation, la déploration digne et sans pathos. La lecture du chef, très concentré, est en effet d’un grand classicisme, sans outrance, mais sans temps mort. Le recueillement y côtoie sans déséquilibre les moments de lutte et de terreur. Il faut dire que l’orchestre connaît cette musique de l’enfant du pays sur le bout des doigts, elle est dans l’ADN des instrumentistes. Ces derniers, par leur unité et leur musicalité, font aussi honneur à l’autre enfant du pays, dont ils portent le nom.
On aime donc particulièrement le soin des cordes à chanter les cantilènes du Recordare, ou encore le velours des premières mesures, tout comme l’accompagnement poétique de l’Ingemisco ou l’introduction de l’Offertoire par les bois ou les violoncelles. On pourrait multiplier les exemples. La cohésion de l’orchestre ne se dément pas davantage dans les fortissimi, puissants sans écraser. Tout juste la direction musicale concède-t-elle un effet en plaçant deux trompettistes de part et d’autre du chœur pour les premiers appels du Tuba mirum. Le Chœur du Teatro Regio, justement, bien préparé par son chef Martino Faggiani, parfaitement en place, brille par son unité et son équilibre.
L’équilibre est aussi l’atout du plateau de solistes réunis pour ce concert. Le ténor Giorgio Berrugi, déploie un timbre chaleureux et son Ingemisco, nuancé porte la douceur de la consolation. Le long visage aux grands yeux mélancoliques de Roberto Tagliavini se fige, comme terrifié, dans le Mors stupebit, que la basse aborde avec une grande retenue mais non sans puissance, comme dans tout le reste de la partition. Puissante, Anita Rachvelishvili ne l’est pas moins. Elle est même impressionnante dans le Liber scriptus, s’autorisant quelque effet un peu poitriné dans les profondeurs du registre bas dont elle usera encore dans le duo du Recordare. C’est d’ailleurs dans ce duo que l’on constate le mieux l’intéressant équilibre des deux voix féminines. Car si Eleonora Buratto accuse çà et là des aigus parfois tendus (Rex tremendae), qui se déploieront finalement bien mieux à la fin du concert, elle est capable de descendre sans ciller dans les graves et ne s’en prive pas dans un Libera me plutôt réussi et même incarné. Un beau plateau, grave et homogène, qui n’est pas pour rien dans la réussite de cette captation – par ailleurs bien enregistrée – qui ne révolutionnera peut-être pas une discographie pléthorique, mais qui saura tenir son rang au pays de Verdi, et qui le devait à ceux à qui ce concert est dédié.