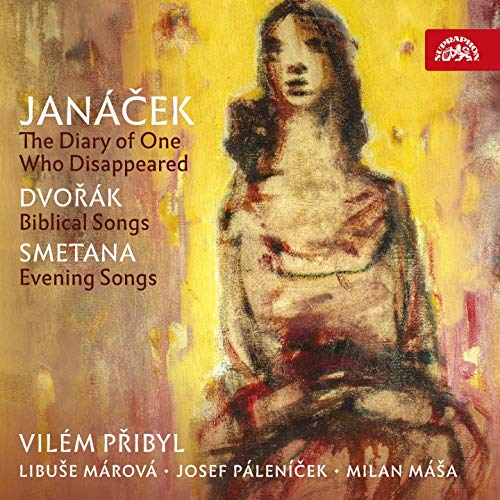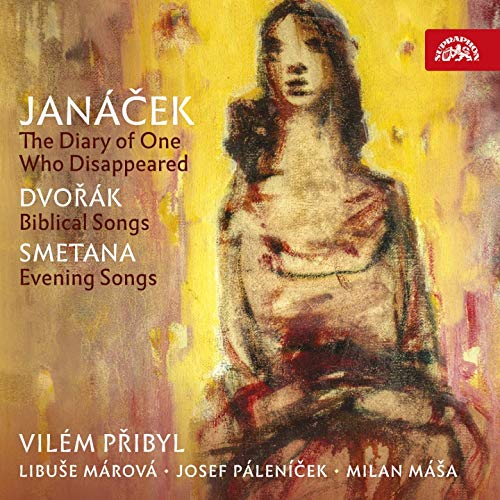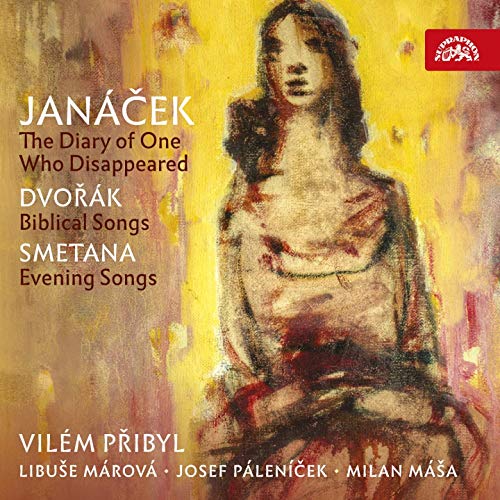Smetana, Dvořák et Janáček sur un même disque, cela paraît logique : trois Tchèques, enfin, plutôt, deux Tchèques et un Morave. Mais quand même, il y a un monde entre la musique des deux premiers et celle du troisième, la modernité creusant comme un abîme entre Dvořák et Janáček alors qu’il s’était écoulé moins d’une quinzaine d’années entre leurs dates de naissance respectives (1841 pour le premier, 1854 pour le second).
Les Chants du soir de Smetana, publiés en 1879, restent ancrés dans une tradition illustrée par d’autres compositeurs du XIXe siècle, dans la mouvance de Schumann ou de Brahms. Cinq mélodies où il est question de voyants et de prophètes, mais aussi d’amour et de couples qui dansent la polka, sur des poèmes de Vitězslav Hálek.
Avec les dix Chants bibliques de Dvořák (1894), on s’affranchit de la forme strophique, l’accompagnement se fait plus inventif, plus frémissant, et la mise en musique s’autorise un maximum de souplesse dans la déclamation de textes tirés des Psaumes. Une première fracture est donc déjà perceptible par rapport à Smetana (lui aussi né une quinzaine d’années avant Dvořák), qu’on serait tenté d’attribuer au wagnérisme, d’autant que le troisième des Chants est précédé d’un court prélude aux harmonies furieusement tristanesques.
Enfin, avec le Journal d’un disparu, Janáček semble s’affranchir de (presque) toutes les contraintes pour construire ce qui n’est ni vraiment une cantate, ni vraiment un opéra miniature, mais une partition inclassable en vingt-deux fragments sur des poèmes signés Ozef Kalda. Composé entre 1917 et 1919, soit avant Katia Kabanova et les derniers chefs-d’œuvre, ce Journal nous éloigne résolument du genre de la mélodie en ce qu’il sollicite tout le lyrisme de son interprète principal, le ténor qui relate sa folle passion pour une gitane (dont on n’entend la voix que dans les fragments 9, 10 et 11). Le fait que le personnage se prénomme Janíček confirme évidemment la lecture autobiographique qui a été donnée de cette œuvre, dans laquelle un Janáček sexagénaire exprime son amour pour Kamila Stösslová, âgée de vingt-six ans.
Pourtant, cette « nouveauté » Supraphon possède une unité, qui tient à l’artiste auquel sont confiées ces trois œuvres. Ce disque est une nouveauté parce qu’il n’existait pas encore sous cette forme, mais il s’agit de rééditions d’enregistrements datant d’il y aura bientôt un demi-siècle, et le ténor qui chante ces trois compositeurs, c’est Vilém Přibyl (1925-1990). Après des débuts professionnels tardifs (à 34 ans), le ténor tchèque fut bientôt propulsé vers une carrière internationale, notamment grâce au rôle de Florestan dans Fidelio qu’il chanta aux côtés des plus grandes de son époque (Régine Crespin, Gwyneth Jones…). Le présent disque est conçu comme une sorte d’hommage à ce grand artiste, dont on est aussitôt saisi par la fermeté d’une voix pleine de solidité virile et par la facilité avec laquelle celle-ci savait s’élancer dans l’aigu. A la toute fin du Journal, Janáček exige deux vigoureux contre-uts, raison pour laquelle on a eu tendance, ces derniers temps, à confier cet emploi à des ténors plutôt légers. Vilém Přibyl était, lui, tout le contraire de ces Evangélistes qui se risquaient à interpréter le Disparu, et c’est preque en heldentenor qu’il aborde le rôle. Le créateur de l’œuvre en 1921, Karel Zavřel, fut brièvement ténor (wagnérien) avant de redevenir le baryton qu’il avait été à ses débuts : autant dire que Janáček ne destinait probablement pas son œuvre à une « petite voix ». Par son idiomatisme et sa sensibilité, l’incarnation de Vilém Přibyl peut faire figure de référence.
D’une génération plus jeune, Libuše Márová fut en son temps une mozartienne admirée, et elle prête un chic inimitable à la gitane. Elève d’Alfred Cortot et d’Albert Roussel, ami de Bohuslav Martinů, le grand Josef Páleníček avait un goût tout particulier pour les œuvres pianistiques de Janáček : il se joue des difficultés dont le compositeur a eu le soin d’émailler sa partition.