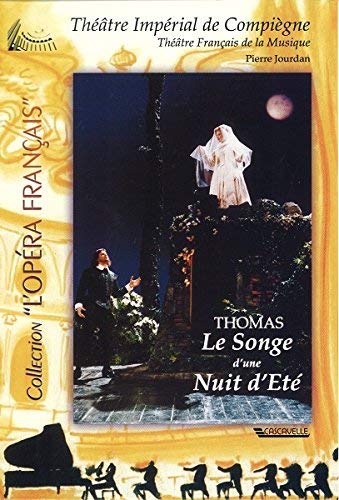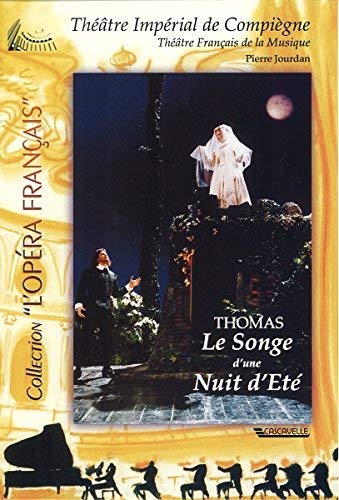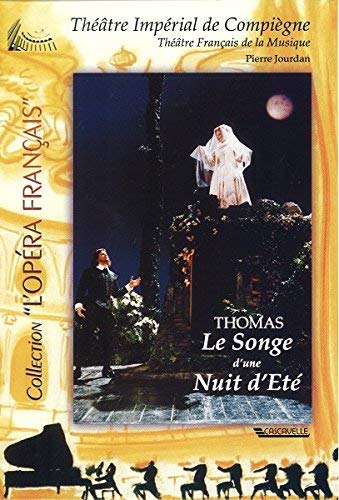« Il y a deux espèces de musique, la bonne et la mauvaise. Et puis il y a la musique d’Ambroise Thomas », a dit un jour Emmanuel Chabrier. Le bon mot a été répété à l’envi, et fait aujourd’hui figure de jugement définitif. Venant d’un wagnérophile au tempérament provocateur, il est pourtant à prendre avec des pincettes et n’est pas sans injustice. Le lyricomane curieux cherchera sans doute à découvrir le compositeur au travers de son titre le plus connu et le plus joué, Mignon. Malheureusement, ce n’est pas nécessairement l’ouvrage le plus accessible au public actuel, qui le juge souvent un peu mièvre. Mais Thomas est aussi l’auteur d’un Hamlet, défendu au disque par Sherril Milnes et Joan Sutherland d’une part, Thomas Hampson et June Anderson d’autre part, et qui fit les beaux soirs du Théâtre de la Monnaie il y a quelques années. Voilà qui n’est pas mal pour une musique vouée aux gémonies. Cet opéra semble d’ailleurs retrouver le chemin des scènes et les spectateurs parisiens auront à leur tour la chance de le redécouvrir salle Favart en décembre, avec les excellents Stéphane Degout et Sabine Devieilhe. Les spectateurs messins ont quant à eux eu la chance d’entendre la rare Françoise de Rimini, dernier opéra du compositeur, également dans une veine dramatique.
Avec Le Songe d’une nuit d’été, Thomas renouvelle son style, faisant mentir ceux qui l’accusaient de n’être qu’un faiseur routinier. Il s’agit ici d’une comédie plaisante au livret étonnant. Le premier acte se passe dans une taverne où la reine Elizabeth a trouvé refuge avec sa suivante Olivia, après s’être égarée. William Shakespeare en personne y est en train de faire la fête avec ses camarades. Elizabeth ne dévoile pas son identité et tente de convaincre le poète, qui n’en a que faire, d’être plus raisonnable. Quand celui-ci est ivre-mort, elle ordonne à Sir John Falstaff, gouverneur de Richmond Palace, de transporter le dramaturge dans le parc voisin. Shakespeare se réveille dans une certaine confusion. La reine a pris l’apparence d’une muse et les sens du jeune homme s’échauffent vite : pour sauver l’honneur d’Elizabeth, sa suivante va jusqu’à se substituer à elle. Cela n’est pas du goût de Latimer, le soupirant d’Olivia, qui se croit trahi. Il provoque Shakespeare en duel. Latimer s’effondre et, croyant l’avoir tué, Shakespeare le jette dans la Tamise. La plus grande confusion règne d’autant qu’Olivia a accidentellement dévoilé l’identité de la reine. De retour à Whitehall Palace, Elizabeth donne l’ordre à Falstaff et à tous les acteurs de l’imbroglio nocturne d’oublier les événements. Ramené devant la reine, Shakespeare redevient ardent, convaincu de son amour. Celle-ci le repousse en lui expliquant que toute l’aventure ne fut que le songe d’une nuit d’été. « Le songe d’une nuit d’été… », répète le dramaturge qui s’imagine déjà attelé à un nouvel ouvrage…. L’apothéose finale associe pour l’éternité le poète national et la Reine d’Angleterre. La musique de Thomas ne se départit pas d’un certain académisme, mais elle est constamment enjouée, un brin savante pour ce genre si léger. L’orchestration est soignée à défaut d’être novatrice (on devra me croire sur parole car le son de cette captation n’est pas à la hauteur du spectacle en salle). Ici, pas de mélodies faciles : l’ouvrage se laisse plus facilement apprivoiser par une seconde écoute, même si la première séduit par son caractère de gaité française typique de cette époque. Le temps passe vite malgré quelques trois heures et quart de musique !
La distribution est une des meilleures réunies par le Théâtre Français de la Musique de Pierre Jourdan. Ghyslaine Raphanel est superbe, offrant sans effort apparent les coloratures de la reine Elizabeth. L’Olivia de Cécile Besnard offre un timbre rond avec de beaux pianisssimi. Dramatiquement juste, Alain Gabriel trouve ici l’un de ses meilleurs emplois. Jean-Philippe Courtis offre un Falstaff bonhomme, tout en rondeur, mais son n’entendra pas cette fois les incroyables trilles de son grand air. Franco Ferrazzi offre une belle voix de ténor léger et sa légère gaucherie scénique convient parfaitement au personnage. La basse Gilles Dubernet, à qui l’on doit également de magnifiques décors très traditionnels (qui rappellent le Falstaff de Franco Zeffirelli) est impeccable vocalement et scéniquement. Michel Swierczewski dirige avec ardeur, métier et amour cette partition surprenante.
La production de Pierre Jourdan est on ne peut plus traditionnelle. Aux décors de Gilles Dubernet déjà cités, s’ajoutent les somptueux costumes de la Royal Skakespeare Company. Tout ici flatte l’oeil et les adeptes des relectures modernes grinceront des dents à juste titre (on est très loin de la production un brin déjantée de Noé, mais aussi de celle de Henry VIII, classique mais très sobre). Le travail de Jourdan est ici essentiellement sur le jeu des acteurs, la fluidité des mouvements. Seule surprise, le clin d’oeil final (dont nous ne dirons pas plus) qui déclenche les applaudissements jusqu’à la conclusion de la musique. Enfin, la captation vidéo est bonne pour l’époque. Ce Songe d’une nuit d’été restera comme l’une des plus belles réussites du Théâtre Français de la Musique pendant cette période passionnante du Théâtre Impérial de Compiègne, éphémère comme les rêves.