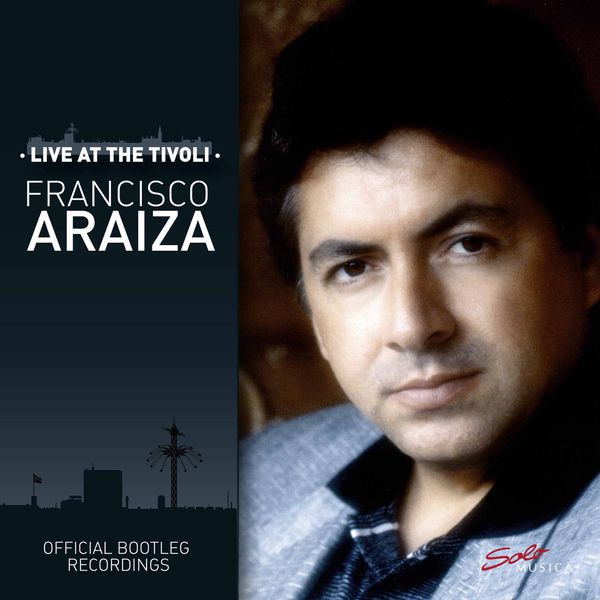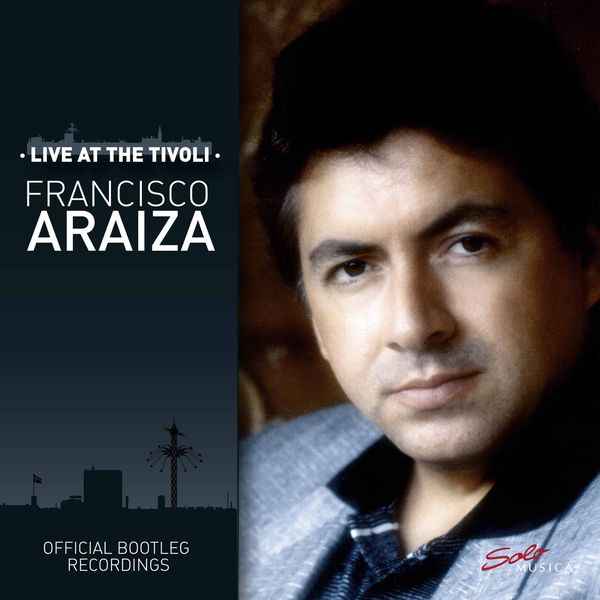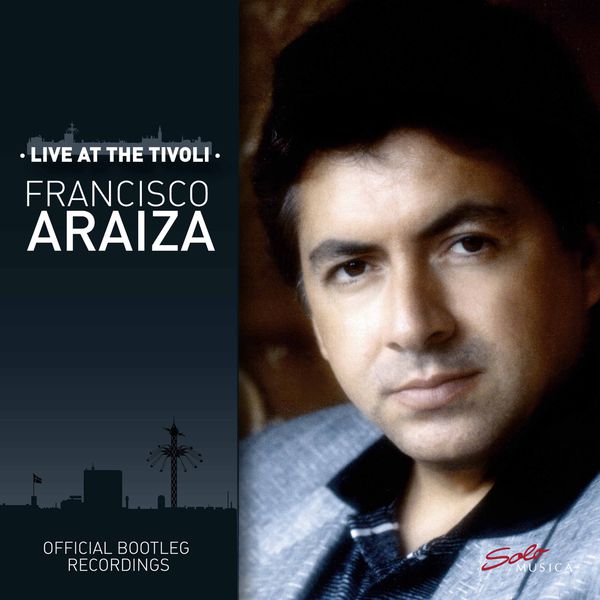Début 2014, une compilation d’enregistrements captés sur le vif ouvrait à Francisco Araiza les portes de notre encyclopédie subjective du ténor. Tel saint Michel Archange combattant le démon, nous balayions alors d’un vaste coup d’épée certains préjugés engendrés par plus de trente années de carrière sur les plus grandes scènes internationales, le premier d’entre eux étant de considérer le ténor mexicain comme un artisan de la Rossini renaissance alors que son parcours doit plus à Mozart qu’à tout autre compositeur. Cette égide mozartienne rejaillit dans un goût prononcé pour le Lied, genre sinon antinomique du moins habituellement peu associé aux chanteurs d’origine latine.
C’est à Karlsruhe qu’Araiza fait ses classes dans les années 1970, continuant de développer une maîtrise de la langue allemande indispensable au genre mélodique avec sans doute déjà à l’époque, un fantasme : Wagner. Passer de Belmonte à Lohengrin n’est pas forcément mission impossible mais le ténor initialement léger doit s’ébouter les ailes pour appréhender une catégorie lyrique dont il lui faudra ensuite continuer de repousser les limites s’il veut poser le pied en terre dramatique. Cette métamorphose n’est pas sans risque. On ne compte plus les chanteurs téméraires tombés trop tôt sur le champ de bataille pour avoir brûlé les étapes.
Tel n’est pas le cas de Francisco Araiza, du moins en ce milieu des années 1980 où sa voix abandonne définitivement les emplois di grazia pour s’ouvrir généreusement à un nouveau répertoire. Deux concerts à Stockholm, considérés par le chanteur lui-même comme les deux meilleures soirées de sa carrière, témoignent de cette évolution. Enregistrés à deux années d’intervalle – 15 aout 1985 et 13 juillet 1987 –, le premier est dirigé par John Frandsen ; le second par Tamas Vetö.
La prise de son désavantageuse ne suffit pas à altérer les sortilèges d’un chant dont la maîtrise du souffle s’impose avec évidence, dès le premier air, « non ho colpa » extrait d’Idomeneo. Importent alors moins les effets belcantistes – le trille absent, la cadence vaguement esquissée – que la lumière bleutée du timbre et le naturel de l’émission. C’est avec une évidence confondante que se dessinent des héros pourtant disparates, présentés dans la version promotionnelle de l’album selon une progression dramatique bienvenue : d’Idamante donc à Andrea Chénier en passant par Des Grieux (Manon de Massenet) en 1985 ; de Nadir (Les Pêcheurs de perles) à Des Grieux (Manon Lescaut de Puccini cette fois) via Pinkerton (Madame Butterfly) et Calaf (Turandot) en 1987 ?
Sept titres seulement ? Dans le CD promotionnel oui, mais l’album, commercialisé uniquement en ligne, offre au total dix-neuf extraits d’opéra qui aident à compléter un panorama que la qualité sonore du témoignage rend hélas dispensable.