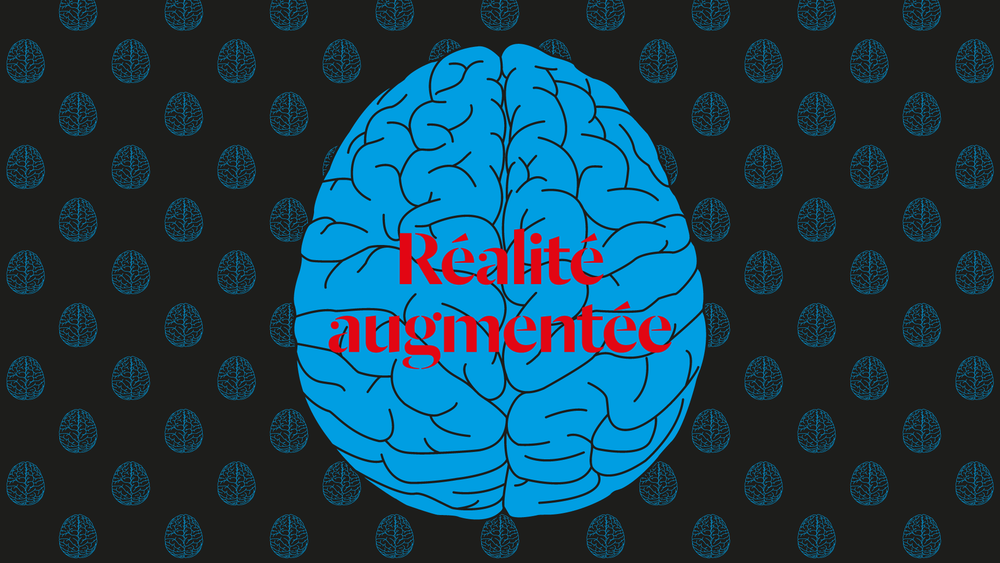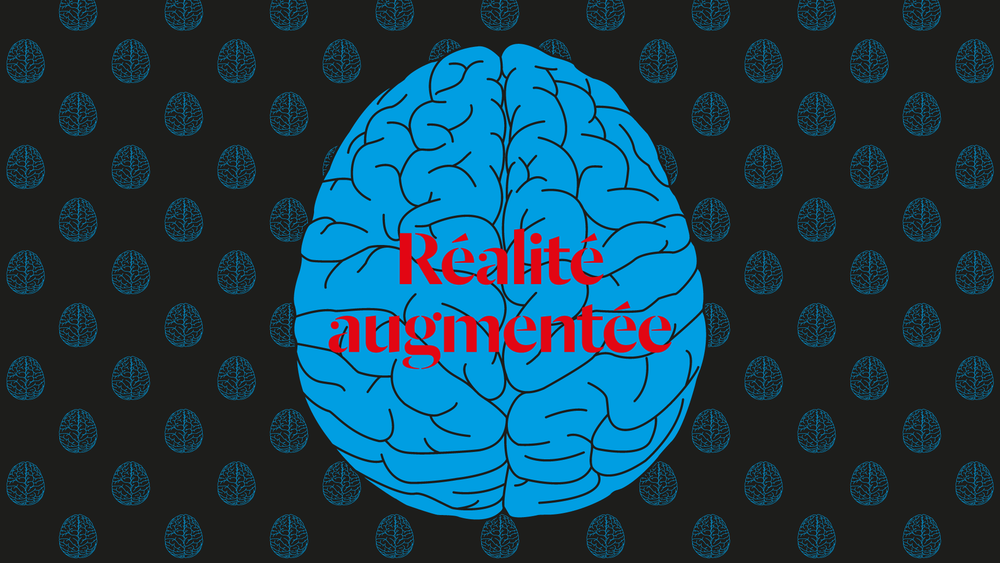« Certes, dans un aussi grand théâtre on peut espacer les spectateurs, mais on ne peut pas proposer rien que des mises en scène à la Bob Wilson, avec des personnages à plusieurs mètres les uns des autres, et comment installer l’orchestre de Parsifal dans la fosse, s’il faut une distance de sécurité entre chaque musicien ? » Plaisanterie douce-amère d’Aviel Cahn présentant la future saison du Grand Théâtre de Genève. Quels spectacles ne resteront-ils prometteurs que sur le papier ? Et lesquels pourront-ils être menés à terme, tels qu’ils furent rêvés.
Incertitude
La conférence de presse donnait une certaine impression d’irréalité, après une fin de saison avortée, la première de l’ex-directeur de l’Opéra des Flandres : Cenerentola annulée (Stefano Montanari/Laurent Pelly), comme celle de Voyage vers l’espoir, création de Christian Jost autour du drame des réfugiés, « presque prête et qu’on pourrait proposer en streaming », et le St François d’Assise de Messiaen, prévu pour le 27 juin, à ce jour toujours maintenu, dans une production de l’artiste plasticien Adel Abdessemed, mais là-encore comment installer l’énorme orchestre voulu par le maitre des oiseaux ?
Le public commençait à suivre (avec une réserve toute genevoise, désappointante après l’audace du public anversois) les options d’Aviel Cahn, sous le signe d’une modernité revendiquée. Il n’empêche : le coronavirus laisse une impression un peu amère d’inachèvement (et une perte estimée entre 1,5 et 3 millions de francs suisses).
Réalité augmentée
« Réalité augmentée », telle est le sous-titre, l’esprit résumé en deux mots de la saison à venir, la plaçant sous le double signe de l’utopie technologique et du fantastique, de l’imaginaire, de l’onirisme, où baignent nombre des oeuvres à l’affiche. Faudra-t-il en proposer des productions simplifiées, car « ce n’est pas l’opulence qui fait un bon spectacle », disait mi-sérieux, mi-grinçant Aviel Cahn, qui pourrait le dire ? L’incertitude plane. Mais sur le papier, elle promet d’être belle, cette saison, plus classique par le choix du répertoire, mais ne reniant pas la fameuse « modernité ».
Minimalisme et touche arty
Turandot ouvrirait donc la saison en septembre, avec la touche arty, désormais la marque de la maison. Dans les « sculptures de lumière » de Time Lab et la mise en scène de Daniel Kramer, on entendra Ingela Brimberg dans le rôle-titre poser les fatales questions à Teodor Ilincai ou Martin Luehle.
Puis Le Messie de Haendel en octobre, par Marc Minkowski et Bob Wilson ouvrira, dans une veine minimaliste et chic, une trilogie sacrée, que complèteront Paulus de Mendelssohn (en concert) et Parsifal.
Ce Parsifal, en mars-avril, mis en scène par Michael Thalheimer dans un esprit expressif et minimaliste (le mot revient décidément comme un leitmotiv…) fera entendre aux alentours de Pâques 2021 de belles voix wagnériennes d’aujourd’hui (Daniel Brenna dans le rôle-titre, Josef Wagner en Amfortas, Mika Kares en Gurnemanz, Justin Hopkins en Titurel, avec Tanja Ariane Baumgartner en Kundry). Au pupitre, Jonathan Nott, le directeur musical de l’Orchestre de la Suisse Romande, qui dirigera aussi Pelléas et Mélisande en janvier, deux ouvrages qui sont, dit-il, le miroir l’un de l’autre.
Le drame de Debussy et Maeterlinck, coproduction avec l’Opéra des Flandres, entremêlera les mouvements de huit danseurs et les voix des protagonistes (Jacques Imbrailo, Mari Eriksmoen et Leigh Melrose), les premiers exprimant les mouvements de l’âme des seconds. Spectacle chorégraphié par Damien Jalet et Sidi Larbi Cherkaoui, très beau, et évidemment minimaliste…
Salut à Voltaire
En revanche, pour les fêtes, Candide de Bernstein, sera placé sous le signe du truculent, du drolatique, du sarcastique, avec une touche de kitsch berlinois, par Barrie Kosky, dans la mise en scène brillante, moitié musical de Broadway, moitié grinçante à la Brecht, qu’il a donnée dans son Komische Oper. Paul Appleby jouant le tendre héros et Claire de Sévigné la frivole Cunégonde, pour honorer Voltaire, qui narguait la cité de Calvin depuis sa thébaïde de Ferney.
Notons encore une Clémence de Titus qu’on nous annonce comme très politique, première mise en scène à l’opéra pour Milo Rau, qui pratique un théâtre très documentaire, mettant en scène des témoignages, et dont les préoccupations actuelles tournent autour du thème de la violence, notamment la violence d’état. On se réjouit d’entendre dans le rôle de Titus le ténor suisse Bernard Richter. L’orchestre sera dirigé par le jeune chef Maxim Emelyanichev.
L’amour, la mort
Autre cheffe issue du monde baroqueux, Emmanuelle Haïm avec son Concert d’Astrée, qui se verra confier Didon et Enée de Purcell. Il s’agira à nouveau de théâtre dansé (par la compagnie Peeping Tom), dans une version « expanded », nous dit-on, puisque l’œuvre est assez courte. A nouveau, une interprète suisse, la magnifique Marie-Claude Chappuis dans le rôle de Didon.
Point commun avec la reine de Carthage, Ia Traviata meurt à la fin, et de façon tout aussi sublime. On verra donc l’héroïne de Verdi s’étioler magnifiquement dans une mise en scène féminine et féministe, « raffinée, sensible, intimiste, sensuelle » de Karin Henkel (chantée par Ekaterina Bakanova ou Francesca Dotto, selon la distribution).
En revanche, comme on le sait, Emilia Marty dans L’Affaire Makropoulos de Janaček, ne meurt jamais. C’est Rachel Harnisch qui l’incarnera dans une mise en scène très cinématographique de Kornél Mundruczó, vue à l’Opéra des Flandres en 2016. Cette histoire fantastique de vie qui ne prendrait jamais fin s’inscrit tout-à-fait dans la thématique « réalité augmentée » de cette saison. « Plus personne ne veut mourir aujourd’hui », disait Aviel Cahn en la présentant. Les grandes œuvres offrent un contrepoint à toutes les époques qu’elle traversent et transcendent…