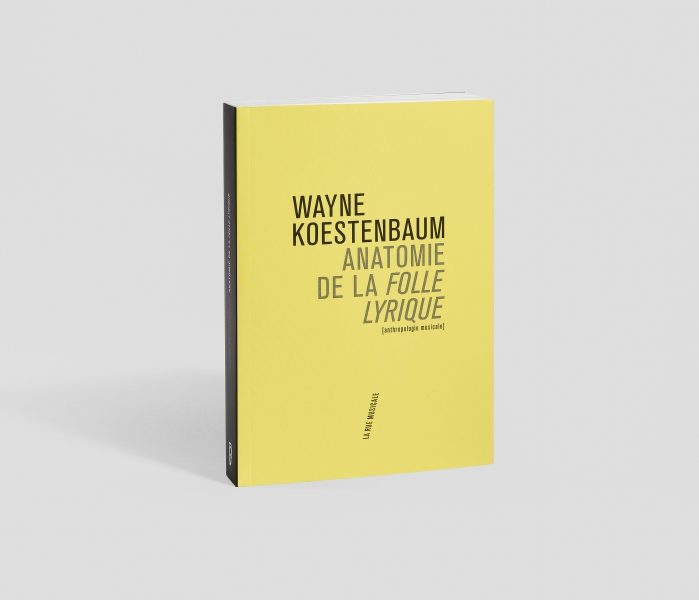Alors que Paris s’apprête à accueillir sa Gay Pride, la traduction en français du livre de Wayne Koestenbaum nous invite à nous pencher sur un aspect particulier de la folie à l’opéra : la folle lyrique.
« Ce livre est plein de ce que je n’ai jamais prétendu être : sociologue, historien, poète, musicologue… », ainsi parlait Wayne Koestenbaum lors de la séance de signature de son ouvrage l’hiver dernier à Paris. Ne venez donc pas à ce volume en espérant une enquête rigoureuse et objective sur les liens qu’entretiennent les gays et les lesbiennes avec l’opéra, ce serait comme ouvrir un texte de Pascal Quignard sur l’Antiquité en s’attendant à du Jacqueline de Romilly. Lorsque parait The Queen’s throat : opera, homosexuality and the mystery of desire en 1993, Wayne Koestenbaum est néanmoins le premier à consacrer une étude d’envergure à ce sujet, et reste le seul lorsque cette traduction française sort. Pour expliquer un tel tabou, il fallait bien plus qu’un ouvrage de recherche, il fallait une œuvre queer pleine de correspondances poétiques et d’observations érigées en symboles. Un ouvrage qui révèle, si ce n’est la sexualité, la folie tapie au fond de chaque vrai fan d’opéra, homosexuel ou pas. A travers de courts fragments très aisés à lire, il laisse ainsi divaguer son imaginaire opératique au gré de ses élans transgressifs. En explorant sa propre personnalité et sexualité à travers le prisme du fan d’opéra, ce livre nous invite à faire de même, à reconnaitre ce qui nous rapproche ou nous éloigne de son auteur. « J’ai épinglé ces indices privés, qui n’ont rien d’universel, à des airs d’opéra qui me mettent en transe (…) Entendez-vous ce que j’entends ? Quand vous écoutez de l’opéra, entendez-vous parler vos désirs les moins approuvés ? » C’est donc une quête psychique à travers notre propre amour du genre, quel que soit le nôtre et son inclination.
Un mot d’abord sur la traduction, très fluide et élégante, de notre collègue Laurent Bury, notamment sur le titre : l’auteur américain tisse tout son texte sur ce que lui évoquent les mots « queen » et « throat », sur ce que ces mots ont de dérangeant et de sensuel. « La gorge de la reine » aurait été un titre abscons, la difficulté a donc habilement été contournée en choisissant les mots « folle » (bien que le terme exclue les lesbiennes qui sont pourtant souvent évoquées par l’auteur) et « anatomie », avec tout ce que le lecteur voudra bien mettre derrière ce mot ! Approchons-nous donc de ce bel organe, sans prétendre pouvoir résumer un objet si touffu.
Le livre s’ouvre sur un portrait des folles lyriques, en commençant par celui de l’auteur : son premier contact raté avec l’opéra, son gout pour les comédies musicales et déjà son approche très décalée. « Avant d’écouter ses acrobaties vocales, j’ai connu Joan Sutherland et l’opéra en tant qu’erreurs de maquillage ». Certes il fait référence aux pochettes de disques mal retouchées, néanmoins, en voyant la photo de la diva en quatrième de couverture, reine de la nuit plus proche de la créature, on comprend vite de quoi il parle. De là, telle une ouverture, toutes les pistes qui seront creusées plus tard sont lancées : le silence du fan, et a fortiori de l’homosexuel honteux et isolé, surcompensé par l’exubérance du chant ; ses différentes attitudes face aux tessitures graves et aigues ; le rapport à son propre corps rejeté par autrui, dénigré par lui-même, humilié par la magnificence lyrique, notamment dans les files d’attentes ou aux places debout ; la manie des listes recensant ses extases (« prophylaxie contre la perte ») ; l’isolement social généré par cet « onanisme de l’oreille » qu’est l’écoute de disques ; l’élection d’une et d’une seule diva à adorer par-dessus toutes, pour en devenir l’ami ou au contraire moins que son ombre, mais en voulant toutefois en être anonymement remarqué lorsqu’il lui crie « brava ! ». Le tout constamment truffés d’anecdotes personnelles ou glanées avec une grande méticulosité dans les mémoires des fans new-yorkais. Ici l’auteur soutient que la folle lyrique est une espèce des années 50, en voie de disparition : « après la libération sexuelle, qui a encore besoin d’opéra ? » Coquetterie aussi élitiste que nostalgique à laquelle nous ne saurions souscrire. Sans convoquer les divas pop apparues bien après Stonewall et qui génèrent tout autant d’adulation, les couloirs de nombreux temples du chant actuels sont la preuve soit que la folle lyrique continue de se reproduire dans un monde déluré, soit que la libération sexuelle est encore très loin d’être achevée. C’est d’ailleurs la critique principale que l’on peut adresser à Wayne Koestenbaum, une certaine tristesse, assez loin des eudémonistes affirmations militantes actuelles. Comme l’auteur le reconnait « Ce livre est une élégie pour la folle lyrique. Je suis une folle lyrique, mais je la pleure aussi. » Et de décrire, en un air du catalogue incitant à craindre les experts, les critiques, tous les types de folles lyriques qu’il faudrait craindre, soi-même inclus (page 56).
Puis c’est la figure du fan enfermé chez soi qui est analysée, et donc de l’homosexuel cloitré dans son désir interdit. En partant de l’univers très normé qu’est la maison, il montre comment l’arrivée des disques dans les foyers a transformé cet art mondain et spectaculaire en art de l’introspection, de façon concomitante avec l’invention du concept d’homosexualité et le déclin de l’art lyrique comme art contemporain. La rêverie se poursuit sur le chanteur incarcéré dans le disque, sa voix, son image, faisant de toute collection un cabinet de nécromancien ; le petit trou, vide existentiel, au centre du disque ; les colonnes de texte bilingues des livrets ; la pénétration du luisant sillon par l’aiguille ; le soin maniaque apporté à ces objets ; la vitesse de défilement qui transforme Caruso en femme ; la haute-fidélité reproductive ; les coupures d’œuvres et les découpages des revues spécialisées. Pour se terminer sur les retransmissions radio du Met, notamment dans les hôpitaux, mis en parallèle avec l’obsession d’Opera News pour « les estropiés, les infirmes, les enfermés, les solitaires pathétiques. »
La troisième partie est sans doute la plus faible : fétichiste des mémoires de divas du début du siècle, l’auteur se délecte de leurs traits communs et construit une éthique de la diva fantasmée que l’on peut vite trouver poussiéreuse ou délicieusement kitsch. Restent de troublantes remarques sur l’utilisation du mot « queer » par ces artistes, le travestissement ou le rapport à la nourriture, l’usage de la vacherie ou leurs attitudes inconsciemment « camp ». Et de brillamment conclure : « Chacun est prisonnier d’une classe, d’une race, d’un genre. Mais contre ces absolus se dresse une foi fervente en l’invention vengeresse de soi-même ; la culture gay a porté à son point de perfection l’art d’imiter une diva – de faire semblant, à l’intérieur d’être divine – pour aider le moi stigmatisé à imaginer qu’il est reçu, cru et adoré. »
En se concentrant sur le culte de Callas, il retrouve les fulgurances du premier chapitre. Callas et ses sons déplaisants qui semblent annoncer les souffrances de son existence ; sa capacité à discipliner sa voix et son physique, tous deux monstrueux, bizarres ; l’absence de frontière entre sa vie privée et sa vie sur scène, entre le placard et la lumière ; la perte tragique de sa voix réduisant la femme à un silence honteux. Callas et son expressivité hors du commun, qui fait de la scène un tribunal pour ses personnages plus réalistes que jamais et semble inviter la folle lyrique à exister avec autant d’éclat.
Le gosier de la reine est une lecture queer de l’art du chant tel que décrit par des manuels qui ne sont lus que par les chanteurs amateurs ayant besoin d’un « guide pratique menant à l’inaccessible ». Ces manuels en apprennent plus sur la société moralisatrice dans laquelle ils ont été écrits que sur le chant lui-même. Ici encore parallèles et coïncidences font émerger des vérités aussi subjectives que troublantes. La gorge comme zone de génération de la voix et de la fellation ; l’apparition simultanée des termes « bel canto » et « homosexuel » dans le vocabulaire en 1860 ; la psychanalyse qui lie castration et identité, comme l’art du chant cherche à reconquérir l’art perdu des castrats, tout en stigmatisant le falsetto émasculant. La condamnation de la dissociation des registres, du vibrato excessif, du trille affecté et donc décadent, efféminé. C’est un grand fatras d’où émergent certains beaux aphorismes, comme par exemple : « Donner forme à une voix ; Donner voix à une sexualité » après un long détour sur le coming out et l’art du souffle.
« L’indicible mariage de la musique et du mot » est sans doute le chapitre le plus révolutionnaire. Il se concentre sur les rapports (forcément louches) entre librettistes et compositeurs, entre paroles et musique, mais si l’on parle ici de mariage indicible, c’est qu’il s’agit déjà d’un mariage pour tous ! et qui plus est, impossible, forcément imparfait, source de drame. Ici le point de départ est Orphée, sujet des premiers opéras, lesquels omettent sciemment son démembrement et son homosexualité, et métaphore du langage cherchant « sa fiancée spectrale dans la musique ». Puis on dérive sur l’invention du récitatif par la Camerata et ses allures de sociétés homophiles. La lutte des genres vient ensuite s’instaurer entre la partition masculine et la représentation féminine : « Si la masculinité de l’opéra dépend de la souveraineté du texte, alors l’oreille, en préférant la musique, perturbe cette masculinité. » En renversant la suprématie théorique du texte sur la musique, du compositeur sur le chanteur, la folle lyrique agit en dissident du sexe et du genre. Platon, Saint Augustin et Nietzsche et toutes « les énergies homophobes présentes dans la culture occidentale désapprouvent l’opéra pour ce qu’il fait le mieux – brouiller la distinction entre mots et musique. » Kierkegaard, lui, voyait dans la faille entre le mot et la musique, une métaphore de sa propre condition existentielle : « à une époque homophobe, nous aimons que l’on chante nos schismes […] afin d’imaginer que notre corps est le théâtre de coups d’Etat qui ébranleront le monde. »
Enfin, le « petit guide des moments queer de l’opéra » est un relevé très subjectif des passages que l’auteur estime queer ou camp sans forcément aborder ou sous-entendre de l’homosexualité. Ces recensions nous touchent d’autant plus que nous aimons beaucoup nous livrer à cet exercice en tant que critique, car elles naissent souvent de l’analyse de ce qu’en font les chanteurs eux-mêmes. La joie délirante de l’entrée d’Elisabeth du Tannhäuser, la valse aussi mélancolique que libidinale et entropique de Juliette chez Gounod, la sublimation du martyre du féminin par la Comtesse chez Mozart et bien d’autres classiques revisités de Purcell jusqu’à Strauss.
Un mot sur les préfaces et la postface pour conclure. La présente édition est préfacée par Olivier Py en un court mais puissant texte qui constitue une parfaite mise en bouche. Jugez plutôt : « Sitôt le rideau tombé [l’hétérosexuel] peut retourner dans le songe bourgeois. Pour [l’homosexuel] le chant ne s’arrête jamais car il l’a identifié à son malheur (…) Loin d’être une nécessité biologique, le monde queer est au contraire une esthétique. » Vous trouverez également à la fin du volume, la préface rédigée par Tony Kushner pour la réédition américaine de 2001 : tout en se défendant d’être une folle lyrique, le célèbre auteur d’Angels in America rends un vibrant hommage au sens retrouvé et à la politique qui irrigue le livre. Devant les vacillements et la tristesse communautaire de Koestenbaum, il fait ce que toute bonne copine folle lyrique doit faire : citer un opéra ! En l’occurrence, Aïda : « Pense qu’un peuple vaincu, au cœur brisé, par toi seul pourra se relever ! » La longue et dense postface enfin est signée par Timothée Picard, universitaire lui aussi, auteur de La Civilisation de l’opéra (Fayard, 2016) et à l’origine de cette nouvelle édition. Après un repérage des apparitions de la folle lyrique dans la culture mainstream, il replace le livre de Koestenbaum au sein d’une riche revue de littérature. Avant lui : les penseurs associant Wagner et l’homoérotisme, Dominique Fernandez et Roland Barthes au sujet du castrat, Susan Sontag et le camp ou Vernon Lee et la lesbienne fan d’opéra. Il résume également les approches psychanalytiques de Paul Robinson et Michel Schneider, centrées sur la quête de l’objet perdu, le genre et la castration. Après lui Mitchell Morris et Sam Abel. Enfin il relate les dernières métamorphoses du sujet : les contre-ténors flamboyants, les opéra à sujet gay, la mouvance barihunks et la polémique qu’elle a suscitée ici-même, ou le silence coupable de certains artistes russes sur les lois homophobes promulguées dans leur pays. Il conclue en soulignant la modernité rajeunissante de la folle lyrique « en prise directe et privilégiée avec l’inquiétante étrangeté de l’opéra lui-même. Elle la maintient vive – et l’opéra avec elle. » Nous vous renvoyons à l’interview qu’il a donnée récemment à Maximilien Hondermack. La folle lyrique vivra*. Vive la folle lyrique !
*la chaine Youtube de Coloraturafan a hélas été supprimée. On trouvait dans cette vidéo sa compilation des meilleures cabalettes pour faire de la musculation et la gym opera queen de contracter ses gros biceps devant la caméra pour terminer. Difficile de ne pas penser au rêve semi-érotique qui conclut l’ouvrage de Koestenbaum (page 395). Un autre bel exemple serait cette vidéo disparue d’un jeune éphèbe en slip interprétant le final de La Sonnambula, en yaourt dans une première vidéo, puis en précisant « this time I learned the lyrics » pour une seconde. Forte récompense à qui retrouvera ce moment de queeritude absolu !