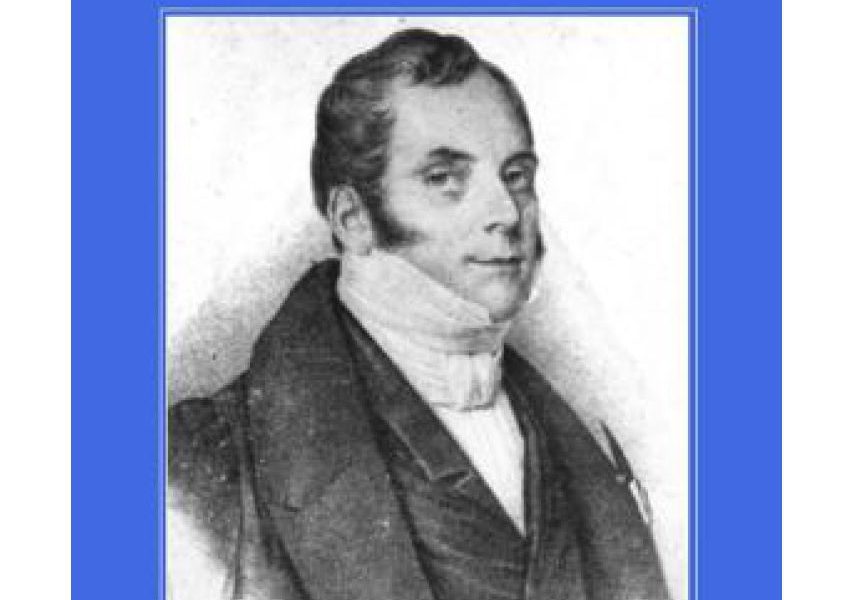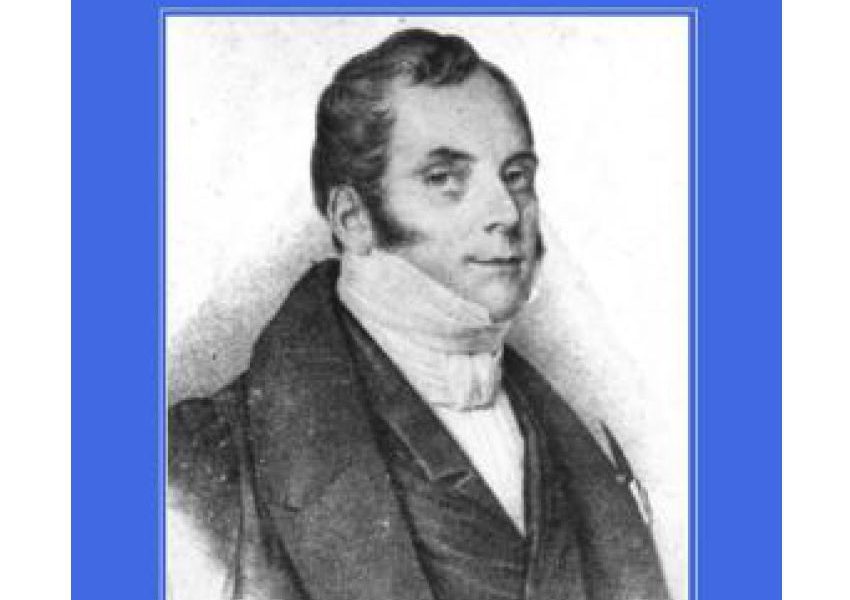Que reste-t-il d’Auber aujourd’hui si ce n’est le nom d’une station du RER et, pour les lecteurs de Forumopera.com, le souvenir de quelques titres rarement représentés ? Il fut pourtant l’un des compositeurs les plus célèbres de son temps, incroyablement prolifique, d’une exceptionnelle longévité, auteur de nombreux succès, estimé de la plupart de ses pairs, de Rossini à Wagner. C’était aussi un homme d’une grande bonté, modeste et plein d’humour. En ce cent-cinquantième anniversaire de sa mort, tentons de réparer cette injustice.
Daniel François Esprit Auber vient au monde du côté de Caen le 29 janvier 1782, dans une diligence. La famille faisait un voyage d’agrément. Cette naissance un peu mouvementée explique-t-elle son horreur des voyages et de la campagne ? Au terme de ses jours, il se refusera ainsi à quitter son Paris adoré, pourtant bombardé par les prussiens. La famille Auber est aisée, du moins à l’origine. Le grand-père normand était monté à Paris et, peintre du Roi, décorait les carrosses de sa majesté Louis XVI. Le père est d’abord officier des chasses royales : son fils lui doit son amour de l’équitation. En 1784, il l’inscrit à la Société académique des Enfants d’Apollon, où l’enfant s’initie à la peinture, au chant et au violon. La Révolution vient mettre un terme à cette situation. Pour nourrir ses quatre enfants, le père ouvre un magasin d’estampes. Il glisse entre les gouttes sanglantes de la Terreur. Sous le Directoire, son échoppe est même un salon fréquenté par des artistes. A seize ans, le jeune Auber joue du piano, du violon, sait chanter et pratique un peu l’italien. Ami de la famille, Jean-Blaise Martin (qui a donné son nom à une tessiture de baryton) lui donne quelques leçons. Dès cette époque, Auber compose, en amateur doué. En 1798, il écrit une première grande scène pour ténor, en italien, « Non s’è più barbaro ». Il y en aura d’autres, un peu dans le style de Piccini ou de Sacchini. Il compose également des quatuors, des concertos pour violoncelle à l’intention d’un soliste célèbre, Jacques-Michel Hurel de Lamare, qui les signera comme s’il en était l’auteur. Alors qu’il n’a pas vingt ans, à l’instigation de son père qui veut qu’il s’initie aux affaires, Auber passe seize mois à Londres : il y acquiert ce sens de la retenue et cette discrétion traditionnellement associés aux Britanniques qui, avec son esprit et sa galanterie, vont devenir les principaux traits de sa personnalité. Enfin, pas tous les Britanniques : Auber se perd un soir dans le brouillard londonnien, et égare même son violon. Après une longue errance, il rentre dans une auberge et reconnait son violon sur le comptoir. Il veut le récupérer mais les bateliers de la Tamise ne l’entendent pas de cette oreille. Pour les convaincre, il est obligé de jouer du violon et émerveille les rudes piliers de bistrot qui le laissent alors s’en aller avec le précieux instrument. En 1805, dans le cadre d’une petite société d’amateurs, il met en musique L’Erreur d’un moment, un ouvrage en un acte sur un livret de Movel pour le compositeur Dezede, dont nous rappelons ici les étonnantes ramifications déjà évoquées en une autre occasion. L’œuvre originale, L’erreur d’un moment ou La Suite de Julie, a été composée par Nicolas Dezède en 1773, un an après une première Julie inspirée de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Les deux livrets sont dus à la plume de Jacques Marie Boutet de Monvel. Probablement bisexuel, Monvel trouva refuge en Suède et devint protégé de Gustave III (lui-même futur inspirateur d’Auber avec Gustave III ou le bal masqué, que nous évoquerons plus loin). L’Erreur d’un moment est donc le premier ouvrage scénique d’Auber. La musique en est vive et légère, mais le compositeur n’a pas encore trouvé le style si particulier qui sera le sien. L’ouverture, élégante et raffinée, se présente comme une sorte de quatuor à cordes. Auber fête ses 25 ans mais n’est toujours qu’un oisif doué sans véritable style propre. En 1806, il retourne à la société des Enfants d’Apollon, mais cette fois comme compositeur. En 1811, son père, qui est convaincu du génie de son fils, consulte Cherubini, alors directeur du Conservatoire. Après avoir analysé sa nouvelle version de Julie, en trois actes, il accepte de le prendre comme élève. Avec son amabilité coutumière, il ajoute : « Votre fils ne manque pas d’imagination, mais il faudrait commencer par oublier tout ce qu’il sait, en supposant qu’il sache quelques chose ». Les leçons dureront trois ans. Il en saura gré à son maître, déclarant « C’est aux bonnes études que j’ai faites chez Cherubini que je dois de fixer rapidement mes idées sur le papier, et de trouver au besoin en une heure aujourd’hui ce qu’il m’arrivait avant de chercher des mois entiers sans le trouver ». En 1812, Auber est donc l’élève de Cherubini et c’est la première fois qu’il étudie sérieusement la musique. Son deuxième opéra-comique, Couvin, ou Jean de Chimay, est donné au château de Chimay. Il est interprété encore une fois par des amateurs, parmi lesquels François Joseph de Riquet de Caraman-Chimay, Comte de Camaran et plus tard Prince de Chimay, et son épouse, l’ancienne merveilleuse, Mme Tallien. Malgré son goût pour les Lumières, celle-ci était d’authentique noblesse espagnole. Quant au comte, il était l’arrière-arrière-petit-fils du constructeur du Canal du Midi. Il jouait aussi du violon. Son fils Joseph est à l’origine de la brasserie de Chimay et subventionna l’établissement des moines trappistes en 1850. Le couple mélomane et mécène accueillera pendant 25 ans les musiciens les plus renommés de l’époque. Les concerts se donnaient dans les salons de son hôtel particulier de la rue de Babylone, ou au Château de Chimay, en Belgique, lequel disposait de son théâtre privé et d’une chapelle. Auber y fit entendre une messe dont l’Agnus fut repris bien plus tard dans La Muette de Portici pour la marche religieuse du premier acte. Couvin est composé sur un livret de Népomucène Lemercier, ancien enfant-prodige, poète et dramaturge paralytique, dont l’histoire littéraire a surtout retenu le prénom, plus facile à mémoriser que le titre de son ouvrage majeur : La Panhypocrisiade ou la comédie infernale du XVIe siècle. La musique comporte déjà quelques traits typiques du musicien qui en réutilisera quelques pages dans des ouvrages ultérieurs. En 1813, Auber reçoit sa première commande officielle : Le Séjour militaire. Ce n’est qu’un vaudeville, composé de quatre airs, d’un trio, de deux ensembles et de beaucoup de dialogues parlés. Méhul et Cherubini déclarent toutefois que « la partition n’était à la vérité qu’un ballon d’essai, mais qu’elle renfermait un gaz qui ne demandait qu’à se développer ». Le compositeur Nicolas Isouard, dit Nicolò, jaloux du jeune concurrent, tente de monter une cabale, que l’expérience du librettiste, Jean-Nicolas Bouilly sait habilement éteindre (dramaturge et librettiste, Jean-Nicolas Bouilly est passé à la postérité comme l’auteur de Léonore, ou l’Amour conjugal, qui inspira le Fidelio de Beethoven. Il était surnommé le poète lacrymal). Au soir de la première, l’acteur Huet s’approche vers le trou du souffleur et lance à la salle : « Messieurs, puisque vous êtes en veine d’indulgence, la pièce que nous avons eu l’honneur d’interpréter devant vous est de monsieur Bouilly. La musique est le premier ouvrage de monsieur Auber ». En Paris puis en province, l’œuvre dépasse rapidement les cents représentations et rapporte 2 040 francs et 80 centimes de droits d’auteur, soit près de 5000 euros actuels. Pendant les six années qui suivent, Auber ne compose aucun ouvrage lyrique et préfère fréquenter les salons où il improvise au piano.
« – Qu’avez-vous fait pendant ces six années ? lui demande un jour Benoît Jouvin, un de ses biographes.
– J’ai fait des visites aux auteurs en crédit, et même à ceux qui ne l’étaient point, toujours mieux accueilli des premiers que des seconds.
– Chaque jour ?
– Chaque jour.
– Et vous me parlez de cela sans amertume ?
– Je vous en parle avec plaisir. C’était le bon temps. Ah ! si j’étais plus jeune, comme j’irai faire la cour à monsieur Victorien Sardou ! »
Mais un épisode dramatique va précipiter son destin : son père arrive au terme de sa vie et il est ruiné. Il convainc son fils de retourner vers le théâtre, seul moyen à l’époque de gagner de l’argent quand on est compositeur. Au décès de son père, les créanciers du marchand d’estampes prennent possession de l’hôtel et de tous les biens de la famille. Auber obtint la permission d’habiter avec sa mère dans une sorte de placard dans l’escalier, avec d’un côté un lit et un piano, de l’autre, séparé par un rideau, un second lit et un fourneau. C’est une misère totale. Mère et fils vivront ainsi jusqu’à la rencontre avec Scribe. Chaque jour Auber quitte son entresol pour rejoindre à pied le village de Passy où réside une de ses connaissances, Eugène de Planard. L’auteur dramatique accueille des artistes dans son salon. Auber les accompagne au piano, jouant la musique des autres. Chaque jour, il sollicite Planard pour un livret, mais celui-ci est un peu refroidi par les critiques de son précédent ouvrage « C’est la musique d’un jeune homme », « Il y a un grand mérite dans la composition de M. Auber, : point de bruit, point de recherche, un chant soutenu, des motifs charmants, de l’esprit scénique et une sagesse inconcevable pour son âge ; la folie, en cette affaire, pour achever d’honorer le carnaval, s’était retirée dans la tête du vieil artiste (Bouilly), la raison dans celle du nouveau ». Précisons que le vieux Bouilly n’a que 50 ans ! Grâce à l’intercession de Madame Planard qui apprécie ce jeune homme bien élevé, Auber obtient le texte tant espéré : Le Testament et les billets doux. Malheureusement, ce livret est totalement indigent et l’ouvrage est retiré de l’affiche du théâtre Feydeau au bout de onze représentations. Se sentant peut-être un peu coupable, Planard propose un nouveau livret : La Bergère châtelaine (1820) sera le premier succès populaire du compositeur (180 représentations en France). Auber a déjà 38 ans. Planard écrit pour lui Emma ou la promesse imprudente (1821 : 766 représentations), un ouvrage qui lui rapporte cette fois seize mille francs. Cette fois ses efforts sont récompensés par des critiques réputés. Castil-Blaze écrira « Oui, messieurs, on commence à chanter à Feydeau ».
Un événement vient alors bouleverser le tranquille microcosme musical français : Rossini vient de s’installer à Paris. Il est considéré à l’époque comme un dieu vivant (sauf par Berlioz bien entendu). Ambroise Thomas décrit ainsi son temps : « Vous ne pouvez pas vous faire une idée du prestige qu’il exerçait sur la jeunesse et de l’engouement dont il était l’objet parmi nous, élèves du Conservatoire (…) Comme aujourd’hui on aspire à faire du Wagner, tous alors nous aspirions à faire du Rossini (…) Tous, nous nous sentions dominés et conquis. Rossini était devenu l’astre dans l’orbite duquel tout un monde gravite ; il resplendissait comme un soleil, et chacun voulait s’échauffer à ses rayons ». Grâce à son ami Michele Carafa, prince de Colubrano, ancien élève lui aussi de Cherubini, compositeur intéressant quoique resté dilettante (encore du travail pour le Palazzetto Bru Zane : il a signé une Jeanne d’Arc à Orléans, Le Valet de Chambre et un Masaniello vraisemblablement sur le même argument que La Muette de Portici), Auber est invité chez Rossini. A sa demande, Rossini chante son « Largo al’fattotum de la cità » en s’accompagnant au piano. Auber est sidéré par cette interprétation vocale qu’il juge supérieure à celle des plus grands interprètes du rôle de Figaro. Il ajoute : « Quand il eut fini, je regardais machinalement les touches d’ivoire : il me semblait les voir fumer ! En rentrant chez moi, j’avais grande envie de jeter mes partitions au feu : cela les réchauffera peut-être.. ».
Le style d’Auber ne change pour autant pas radicalement : il devient plus brillant, plus léger plus vif, se libérant du carcan enseigné par Cherubini (qui, on l’a vu, n’était pas précisément un rigolo) sans perdre de sa distance. Auber ne cherchera jamais à imiter le compositeur italien, tout en intégrant ses formules à son propre discours musical, pendant une certaine période du moins.
Enfin, Auber va rencontrer Scribe. Celui-ci l’a contacté pour lui demander la permission d’utiliser dans un nouvel ouvrage une ronde extraite de La Bergère châtelaine. « Monsieur, Voulez-vous me permettre de placer, dans un vaudeville que j’écris en ce moment, pour le théâtre de Madame, votre ronde si jolie et justement populaire de la Bergère châtelaine ? Je ne vous cacherai pas, monsieur, que je me suis engagé auprès de mon directeur à faire réussir ma pièce, et que j’ai compté pour cela sur votre charmante musique ». Auber répond courtoisement et modestement : « Ma ronde est peu de chose, monsieur, et votre esprit peut se passer de mon faible secours. Mais si, avec la permission que vous me demandez, et dont vous n’avez nul besoin, je pouvais vous prêter la jolie voix et le joli visage de Mme Boulanger, je crois que nous aurions ferions tous les deux une bonne affaire ». Le conseil était bon : la chanteuse, comédienne spirituelle et piquante, ne fut pas pour rien dans le succès de Scribe. Une collaboration de quarante année venait de naitre, qui durera jusqu’à la mort du dramaturge. Scribe fut bien décrié à son époque, comme il peut parfois l’être aujourd’hui, d’ailleurs. Ce stakhanoviste travaillait en équipe et ne s’en cachait pas, un peu à la manière d’un producteur de cinéma à l’âge d’or hollywoodien. Certains vers prêtent à sourire : « Et dans le temple on n’attend plus que vous » (La Muette de Portici). Castil-Blaze (encore lui) raille une versification pas nécessairement adaptée au rythme de la musique « Amis, la matinée est belle » devient pour lui « Amis lamas : Tinée est belle » (toujours dans La Muette de Portici). Ses livrets sont parfois exagérément compliquées, mais il n’en demeure pas moins qu’il savait ficeler une intrigue. Il collaborait aussi en quelque sorte à la composition en indiquant dans le texte des propositions de réminiscences musicales, des leitmotivs avant l’heure. Il n’hésitait pas non plus à aborder les sujets qui fâchent : drames de mœurs au théâtre, guerres de religion à l’opéra… Scribe possède également un talent rare à l’époque, celui de parolier. Il écrit des textes adaptés à une musique préexistante. C’est lui qui réarrangera le Viaggio a Reims de Rossini, ouvrage de circonstance écrit pour le couronnement de Charles X, pour en faire Le Comte Ory sur une intrigue et des vers de son crû, avec le succès que l’on sait. Ce talent est tout à fait adapté à celui d’Auber. Celui-ci compose en effet tout le temps et non pas sur commande. Les mélodies lui viennent pendant ses promenades à cheval (il les note alors sur un bout de papier), au théâtre, à l’académie… Il les façonne dans son esprit. Il les joue ensuite sur son épinette, antique souvenir de sa période de pauvreté, logée au second et dernier étage de son hôtel, sous les combles. Si la musique rend bien sur ce médiocre instrument, c’est qu’elle est bonne pour un orchestre, et il la couche alors sur du papier à musique. La mélodie est ensuite rangée dans l’un des albums qu’il conserve. Quand Auber doit composer un nouvel opéra, il se met d’accord avec Scribe sur le scénario, l’ambiance, la découpe des scènes. Il lui fournit alors des mélodies adaptées puisées dans ses albums. Scribe n’a plus qu’à arranger des vers et, après quelques itérations, l’ouvrage est prêt. Parfois, Auber propose un « monstre » à Scribe, sur lequel il placera des vers de longueur adaptée tandis qu’Auber travaille à la musique. On est loin de l’image romantique du musicien inspiré par un texte grandiose (ce qui n’est pas si courant de toute façon) et plus prêt des méthodes de composition modernes. Les anglo-saxons appellent d’ailleurs lyrics ces textes écrits sur la musique : au début du XXe siècle, l’usage est passée dans l’opérette. Ainsi, Là-Haut ! doit sa musique à Maurice Yvain, son intrigue et ses dialogues à Yves Mirande et Gustave Quinson, ses lyrics à l’excellent Albert Willemetz. Au vrai, l’adéquation parfaite de la musique au texte n’est pas un absolu : ce sont les situations dramatiques qui comptent prioritairement. On retrouve ainsi logiquement des idées musicales des Wesendonck Lieder dans Tristan und Isolde, par exemple. Rappelons aussi le cas archi-connu de Don Carlos (en français) et Don Carlo (en italien). Eboli chante en français « O don fatal, et détesté, présent du Ciel en sa colère » (avec un forte sur « colère ») tandis qu’en italien elle chantera « O don fatale, o don crudel, che in suo furor mi fece il ciel! » avec un forte sur « ciel », dépourvu de signification dramatique. Peu d’auditeurs se soucient de cette intention du compositeur, et son non-respect dans la version italienne n’aura jamais empêché quiconque de dormir, pas même un ayatollah de la partition écrite comme Riccardo Muti. Tout ceci pour dire qu’Auber n’écrit pas de la musique au kilomètre, quand on l’a parfois lu, et que, s’il a un style bien à lui, il n’a pas pour autant de recettes (d’où quelques échecs, d’ailleurs). Ses mélodies orphelines attendent simplement dans leur album le coup de foudre avec un texte qui les sublimera, mais elles n’épousent pas n’importe qui. C’est Auber qui organise le mariage arrangé. L’exemple venait d’ailleurs du dieu lui-même (et en bien pire) : ainsi le génial Rossini reprit sans vergogne le rondo final de La Donna del Lago pour celui de Bianca e Falliero, ou le « Cessa di più resistere » pour ténor du Barbiere di Siviglia pour en faire « Nacqui all’affanno » pour mezzo dans La Cenerentola.
La vie quotidienne d’Auber est réglée comme du papier à musique (évidemment). Il se couche tard et se lève tôt, ne dormant que deux ou trois heures par nuit. Il s’occupe lui-même de sa mère aveugle jusqu’à la fin de ses jours. Il peut recevoir des visites dès 6 heures du matin : cela décourage généralement les importuns ; sinon, il écrit sa musique jusqu’à midi, interrompu dans la matinée par un frugal petit-déjeuner (les domestiques ont droit à la grasse matinée) . Après son déjeuner il se rend au Conservatoire, quand il en devient le directeur en 1842 après la démission de Cherubini, ou bien à l’Institut où il fut élu en 1829. Il remplit les devoirs de sa charge : il écrit des ouvrages de circonstance (cantates, marches, hymnes, pour des cérémonies royales, impériales ou républicaines suivant les changement de régimes) ; il compose des exercices pour les élèves du Conservatoire ; il y applique des réformes, toujours avec modération : séparation des hommes et des femmes, maintien du pensionnat pour éviter les distractions du dehors, organisation de vraies représentations (avec costumes et décors) sur des partitions de Grands Prix de Rome revenus au pays, ceci afin que chacun puisse se familiariser avec le théâtre avant d’avoir à en affronter les difficultés dans la vraie vie… Maître de la Chapelle de la cour (qui comprend 40 choristes et 40 instrumentistes), il prépare les programmes, choisit les interprètes, compose une pièce religieuse à l’occasion : des Litanies de la Sainte Vierge, un Hymne à sainte Cécile… S’il semble sommeiller dans une vaste assemblée, c’est qu’il pense à sa musique. L’après-midi, il pratique l’équitation dans le Bois de Boulogne (sur le tard, il devra se contenter de promenade en calèche, toujours ouvertes). Le soir, il se rend à l’Opéra (il apprécie particulièrement le ballet mais si, au hasard d’un changement de programme, il découvre que l’on joue un des ouvrages, il quitte aussitôt la salle). Il fréquente également la Comédie-Française. Après le spectacle, il rentre à pied chez lui, au 22 de la rue Saint-Georges. Il soupe alors avec ses invités, présentant lui-même les vins et les plats préparés par son fidèle couple de domestiques. Il aime la causerie, mais pas les discussions animées. Il ne cherche pas à convaincre. Peu bavard, il sait lancer un bon mot ou faire fuser un trait particulièrement juste. Il aime s’entourer de gens jeunes. L’homme est élégant, rasé contrairement aux usages de l’époque, de petite taille, bien fait et toujours bien mis. La phrase célèbre de Rossini, « Piccolo musico, ma grande musicista », doit être comprise comme un jeu de mots sur sa taille et non sur ses qualités de musicien comme le laisse penser la traduction française habituelle qui traine partout. Son visage est généralement souriant, son regard intelligent, avec des yeux noirs brillants bien au fond de leur orbite. Il attire la sympathie de tous ceux qui le côtoient. Il ne parle jamais de son art, préférant éviter, par ce silence, tant la désapprobation qu’une flatteuse admiration. Il n’aime ni les éreintements, ni les encensements. Le dîner terminé, il peut continuer à travailler : il réveillera une fois la pauvre Cinti-Damoreau (créatrice du Domino noir) sur le coup de trois heures du matin pour lui soumettre un nouvel air !
Sa vie est exclusivement parisienne : il n’aime ni les voyages (« Scribe m’a fait parcourir, dans ses opéras, tant de pays divers, qu’il est bien naturel qu’aujourd’hui j’aime à me retrouver à Paris » ), ni la campagne où Scribe réside le plus souvent dans une magnifique propriété où il travaille avec ses collaborateurs (« Est-ce assez ennuyeux la campagne ! D’abord, c’est toujours la même chose : un ciel plus ou moins bleu, et des arbres plus ou moins verts… Moi qui vous parle, mon ami, j’y ai passé huit grands jours ; mais on ne m’y reprendra plus ! »). Il affecte une sorte d’indifférence envers son art, n’assiste jamais aux représentations publiques de ses œuvres, et plaisante, avec cette fausse confidence en forme de boutade : « J’ai aimé la musique jusqu’à 30 ans – une vraie passion de jeune homme ! Je l’ai aimée tant qu’elle a été ma maîtresse, mais depuis qu’elle est devenue ma femme… ». Une autre fois, il avoue : « Je n’ai jamais feuilleté une de mes anciennes partitions avec la joie qu’on doit éprouver de revoir des visages qu’on a connus et aimés, et quand cela arrivait, je me disais qu’il y a bien des morceaux que je recommencerais si ma partition était à refaire ». On est loin de la mégalomanie d’un Spontini s’avançant paré de décorations pour diriger une répétition d’un de ses ouvrages et déclarant sans rire « Messieurs, l’ouvrage que nous allons avoir l’honneur de répéter est un chef d’œuvre ».
Signalons au passage que Spontini est également l’auteur d’une » fake news » qui a la vie dure, consistant à prétendre que Meyerbeer n’avait jamais rien composé de sa vie et qu’il se contentait d’acheter des mélodies à des coreligionnaires pour les assembler. Et puisqu’on en est aux anecdotes, voici l’une des plus belles de toutes le concernant.
Spontini se fait faire un costume chez un tailleur.
« – Monsieur Spontini, voulez-vous que la redingote descende jusqu’aux genoux ?
– Plus bas
– Bien. Jusqu’au mollet ?
– Plus bas.
– Alors, jusqu’à la cheville ?
– Plus bas, plus bas, vous dis-je.
– Plus bas, mais c’est impossible monsieur, cela vous gênerait pour marcher.
– Marcher ! Est-ce que je marche … ? ».
La collaboration avec Scribe débute avec Leicester ou le Château de Kenilworth, créé en 1823. Le sujet est très proche de l’Elisabetta al castello di Kenilworth de Gaetano Donizetti (1829). Leur collaboration ne s’arrêtera qu’avec la mort du dramaturge. Vient ensuite La Neige (1823) dont les couplets « Il est plus dangereux de glisser sur la glace que sur le gazon » furent immédiatement populaires (et réadaptés dans Les Mousquetaires au couvent). La partition se teinte d’un vernis rossinien. Suivent Vendôme en Espagne (1823, une pièce de circonstance en collaboration avec Hérold) ; Les Trois genres (1824), Le Concert à la cour, ou la débutante (1824) et Léocadie (1824). En 1825, la création du Maçon est un triomphe populaire et l’ouvrage restera longtemps au répertoire (525 représentations à l’Opéra-comique). Le Timide ou le nouveau séducteur (1826) précède Fiorella (1826). Auber a maintenant 45 ans et va s’illustrer magistralement dans le répertoire dramatique, avec une oeuvre capitale à tous les égards et qui séduira jusqu’à Richard Wagner. La Muette de Portici est créée le 29 février 1828 à l’Opéra. Les cinq actes sont écrits en trois mois. Passée la fièvre de l’inspiration, Auber connaitra quelques mois de lassitude où il ne pourra plus écrire une note. La création est un triomphe. Le succès de La Muette contamine toute l’Europe et Richard Wagner le considère comme un chef d’oeuvre. C’est le début d’une révolution musicale (et même de la Révolution belge) : après elle, il y aura Robert le Diable, La Juive, Les Huguenots, Les Vêpres siciliennes, Don Carlos… Le grand opéra français est né. Auber revient à l’opéra-comique avec La Fiancée (1829) et surtout Fra Diavolo (1830), souvent considéré comme son chef d’œuvre et qui n’aura jamais vraiment quitté le répertoire européen. Le Dieu et la Bayadère (1830) ne renouvelle pas le succès de la Muette, malgré un nouveau rôle dansé pour la Taglioni. Le Philtre est créé en 1831 : l’ouvrage sera réécrit par Donizetti sous le titre de l’Elisir d’amore. Son format est mal adapté à la salle de l’Opéra. On aimerait aujourd’hui pouvoir comparer ces deux variations sur un même thème. A l’Opéra-comique, Auber donne Le Serment ou les faux-monnayeurs (1832). A l’Opéra, Gustave III ou le Bal masqué (1833) est une nouvelle réussite dans le genre dramatique. Le bal final et son galop endiablé, ainsi qu’un décor luxueux au dernier acte, ne sont pas pour rien dans le succès de l’ouvrage. Mais il ne faudrait pas en négliger pour autant la qualité du livret et de la musique. Le premier a été repris à l’identique par Giuseppe Verdi pour Un Ballo in maschera, et on sait le compositeur italien bien sourcilleux dans le choix de ses intrigues dramatiques. La musique d’Auber est également admirable, à condition que l’on compare ce qui est comparable, ce qui est le plus réussi chez Verdi étant souvent ce qui l’est le moins chez Auber et inversement. Auber compose ensuite un trio pour un ouvrage collectif, La Marquise de Brinvilliers (1831) auquel neuf compositeurs ont collaboré. A l’Opéra-comique, Lestocq (1834) est un succès (apprécia là encore de Wagner), bientôt dépassé par le magnifique Cheval de Bronze (1835) qui sera réadapté ultérieurement pour l’Opéra (1857). C’est sans doute l’ouvrage le plus brillant du compositeur chez qui l’influence rossinienne va commencer à reculer. Son ouverture est l’une des plus réussies. Les titres se succèdent : Actéon (1836) , Les Chaperons blancs (1836), L’Ambassadrice (1836), La Fête de Versailles (1837). Nous avons eu l’occasion de résumer certains de ces titres dans nos récensions de l’intégrale symphonique Auber dirigée par Dario Salvi (les autres suivront, espérons-le). Avec Le Domino noir (1837), Auber et Scribe inventent la comédie musicale. L’ouvrage dépasse les 1200 représentations. Le succès du Lac des Fées pâtit de la fatigue de Duprez, « inventeur » du contre-ut, successeur du malheureux Nourrit, et qui ne gardera pas longtemps sa voix : le rôle est un cauchemar de ténor, mais Michael Spyres a su lui rendre pleinement justice … Après le succès de Zanetta (1840), Les Diamants de la Couronne (1841) sont un triomphe plus grand encore, auquel même Berlioz rend hommage. Suivent Le Duc d’Olonne en 1842 (avec le ténor Roger, futur créateur du rôle de Jean dans Le Prophète en 1849), La Part du Diable (1843), La Sirène (1844), et enfin La Barcarolle (1845) qui est un four. Le compositeur semble avoir eu un léger coup de mou après ce premier échec. Il faut attendre 1847 pour le voir revenir avec Les Premiers pas (novembre) puis la délicieuse Haydée (décembre), qui obtient un bon succès. En 1850, il revient à l’opéra avec un sujet biblique, L’Enfant prodigue. C’est un succès, mais son style, toujours aussi vif et brillante, déconcerte la critique face à la puissance dramatique de Meyerbeer ou d’Halévy. Zerline ou la Corbeille d’oranges (1851) est un triomphe, notamment grâce à Marietta Alboni, immense rossinienne, fameuse interprète du Brindisi de Lucrezia Borgia et pour qui Meyerbeer écrivit un nouveau rondo pour une reprise des Huguenots. C’était un peu la Marilyn Horne de l’époque. Marco Spada, n’est pas trop bien accueilli. Un plaisantin le baptise Fra-Marco ou les Diamants de la Sirène. Jenny Bell (1855) est un « succès de saison » mais Manon Lescaut (1856) est une vraie réussite, avec un dernier acte original, sobre et poignant, où le compositeur renouvelle son style. Marco Spada revient à l’Opéra, mais sous forme de ballet. La partition en est revue de fond en comble, et intègre des pages célèbres du compositeur, par exemple de Fra Diavolo. L’ouvrage était encore au répertoire de l’Opéra de Paris il ya quelques années, et une reprise nous changerait des séries de trente-six Bayadère… La Circassienne est créée en 1862. Le lendemain du succès de l’ouvrage, Auber s’attèle à une nouvel ouvrage, La Fiancée du roi de Garbe : « Hélas ! J’ai eu cette imprudence ! ». Il faut dire que le compositeur a fêté ses 80 ans… La mort vient surprendre Scribe qui voulait retravailler un troisième acte dont il n’était pas satisfait. L’ouvrage est créé en 1864. En 1867, Auber donne Le Premier jour de bonheur (175 représentations) puis, en 1869, Rêve d’amour. La destinée de l’ouvrage est interrompue par la Guerre de 1870. Auber n’a pas voulu quitter la ville, par « honneur et reconnaissance ». Il est malade de la vessie. Son cher Paris est en proie aux destructions des prussiens et des communards. Figaro, son vieux cheval, est parti à la découpe. Il revient à la musique de chambre. La tristesse l’envahit. « Il ne faut d’exagération en rien : j’ai trop vécu ». Il doit s’arrêter en plein milieu d’une mesure alors qu’il écrit sur son papier réglé, et s’alite. Il décède le 12 mai 1871, 10 jours avant la « Semaine sanglante ». Son corps est entreposé dans un caveau de l’Eglise de la Trinité. Ses funérailles auront lieu quelques mois plus tard, mais l’heure n’est plus aux commémorations officielles grandioses auxquelles il aurait eu droit en s’éteignant deux ans plus tôt…
La musique d’Auber est de sensibilité romantique, mais toujours avec un léger détachement. Elle n’abuse jamais des formules toutes faites. Sa facilité mélodique est étonnante et certains airs sont tout simplement entêtants. Reynaldo Hahn écrit qu’Auber « dépasse de beaucoup ses prédécesseurs et ses émules par la spontanéité de l’élan mélodique, par l’ingéniosité de l’agencement musical et par une sorte de grâce italienne qui donne du charme à sa gaîté ». Les chœurs ont souvent un rôle important. S’il apprécie les ensembles, Auber n’aime pas les duos, considérant qu’il n’y a qu’un nombre limité de situations (et plutôt dans la comédie) où deux personnages peuvent exprimer leurs propres sentiments sur la même musique. Dans La Muette de Portici, « Amour sacré de la Patrie » fait donc plutôt figure d’exception. Auber n’aime pas les extrêmes, mais les sentiments sans emphase, bien plus justes au fond que les grands élans paroxystiques habituels à l’opéra. Ceci explique sans doute la désaffection progressive du public qui, mithridatisé comme un abonné de Netflix, a besoin d’émotions de plus en plus fortes pour soutenir son intérêt au fil des saisons. L’Abbé Laugier disait de Lully « On ne le dédaigne que parce qu’il est trop connu. Ses beautés, qui dans leur primeur, firent des impressions si vives, ont perdu leur éclat, depuis que la trop grande habitude en a usé le sentiment ; ses chants n’ont perdu aucune de leurs grâces ; il ne leur manque que le mérite de la nouveauté. Ils ont plus trop longtemps pour plaire encore » (cité par Malherbe dans sa biographie d’Auber). Alors qu’il a droit à une demi-douzaine de biographies de son vivant, Auber disparait des champs d’études universitaires français à la fin de la seconde guerre mondiale, ne semblant intéresser que les allemands et les britanniques (on ne peut que conseiller la lecture de l’ouvrage le plus récent, celui de Robert Letellier).
Comme le souligne Charles Malherbe, l’un de ses biographes « Contrairement à Grétry qui s’appelait Modeste et ne l’était guère, Daniel François Esprit Auber eut en effet de l’esprit, beaucoup d’esprit et du meilleur, dans ses propos comme dans sa musique, depuis son entrée dans la carrière jusqu’au terme d’une existence qui dépassa, on le sait, les limites ordinaires de la vie humaine ». Espérons, qu’à l’image de la « Rossini renaissance », des artistes passionnés sauront ressusciter ce style de l’opéra-comique, le dépoussiérer sans le trahir (saluons au passage le travail des Frivolités lyriques). Il ne serait pourtant guère compliqué de monter Gustave III dans une mise en scène prévue pour Un Ballo in maschera, ou Le Philtre dans une production de l’Elisir d’amore. C’est une simple question de volonté et d’audace. C’est sans doute aussi un devoir.