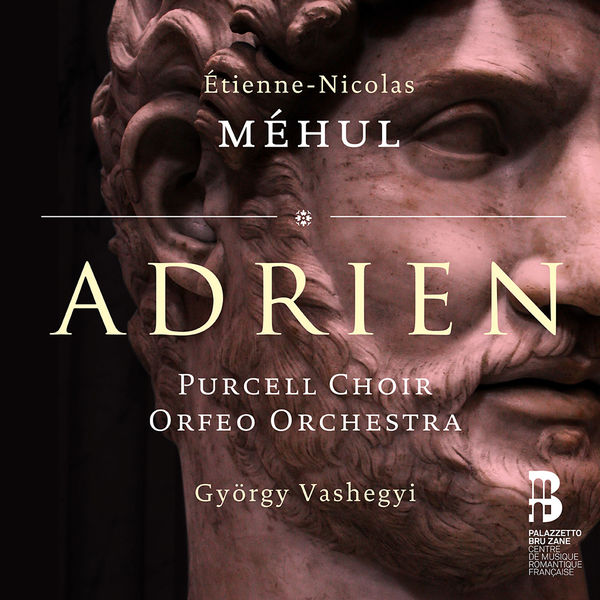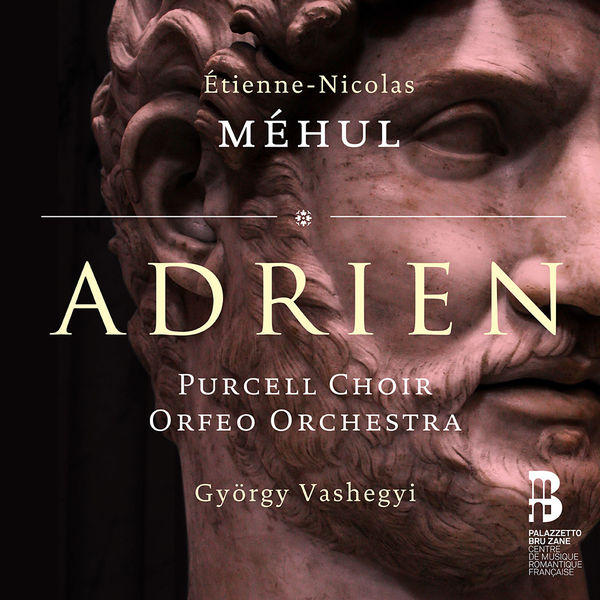On n’échappe pas à l’humeur de son temps. Alors que Jacques-Louis David triomphe dès les années 1780 avec ses toiles évoquant l’histoire romaine, l’opéra français succombe lui aussi à la vogue néo-classique, et l’Adrien de Méhul semble avoir été composé pour offrir un équivalent sonore au Serment des Horaces ou à L’Enlèvement des Sabines. Loin de la mythologie qui servait encore de support aux tragédies lyriques de Gluck, c’est dans l’antiquité historique que l’époque révolutionnaire puise ses sujets. François-Benoît Hoffmann, librettiste à qui Cherubini doit notamment sa Médée, n’est pourtant pas allé chercher bien loin, puisqu’il s’est contenté d’adapter l’intrigue conçue par Métastase dans Adriano in Siria, mise en musique par Pergolèse entre autres. La scène est à Antioche, et l’empereur romain vient de vaincre les Parthes, mais le livret se borne à un méli-mélo amoureux entre Adrien, sa promise Sabine, sa belle captive Emirène et Pharnaspe l’époux de celle-ci ; seul Cosroès, père de la jeune Parthe, est animé par le désir de vengeance. La galanterie l’emporte néanmoins, comme l’avoue Adrien peu avant la fin de l’opéra, « Poursuivons mes desseins, et tâchons en ce jour / D’accorder, s’il se peut, ma gloire et mon amour ».
Entre 1790 et 1822, l’Ardennais Etienne Méhul composa une trentaine d’opéras, seul ou en collaboration. Son Joseph (1807) est l’arbre qui cache la forêt, à moins que l’arbre en question ne soit son trop célèbre Chant du départ. Heureusement, le Palazzetto Bru Zane va mettre bon ordre à tout cela, en nous faisant redécouvrir une partie de son œuvre lyrique, dont l’exhumation semble s’être arrêtée à Stratonice (1792), recréée il y a près de vingt ans par William Christie. C’est en 1791 que Méhul composa son Adrien, qui n’eut pas l’heur de plaire aux régimes successifs, qui exigèrent diverses modifications au nom d’une censure implacable. L’œuvre ne fut donc créée qu’en 1799, et le Centre de musique romantique française a choisi de commercialiser ce premier enregistrement mondial sous la forme exclusive du téléchargement.
Cet opéra où la noblesse de la déclamation gluckiste se pare ici et là d’accents guerriers constitue-t-il pour autant un événement ? Pas sûr. Le premier acte est une longue exposition à peu près dénuée d’airs, même si sur ce point, Méhul se rattrape au second : il faut bien quelques airs (à la française, toutefois) pour animer le dialogue opposant Adrien aux deux femmes entre lesquelles il balance, avant que l’action reprenne ses droits sous la forme d’une tentative d’assassinat contre l’empereur. Hélas, ce n’est pas du chef hongrois György Vashegyi qu’il faut attendre l’impulsion apte à galvaniser ses troupes : bien plus habitué à la musique sacrée avec son Orfeo Orchestra, il a un peu tendance à laisser s’assoupir les récitatifs (nombreux), là où il faudrait au contraire presser le mouvement. Même les passages orchestraux paraissent parfois un peu lourds (la Pantomime du deuxième acte), et le Purcell Choir ne semble guère coutumier du genre opéra. Le français des choristes est assez bon, mais ces dames et ces messieurs ont-ils la moindre idée de ce qu’ils chantent ? Alors qu’ils sont censés crier leur terreur ou leur soif de sang, ils donnent à la musique un côté éthéré pour le moins déplacé. Il faudrait ici plus de chair, plus de tripes !
Heureusement, les solistes s’avèrent, eux, tout à fait à la hauteur et appartiennent à l’équipe dont le Palazzetto a su s’entourer. De Marc Barrard, on apprécie le timbre et le style, mais le vibrato est vraiment bien envahissant, même pour un personnage d’une génération plus âgé que les autres protagonistes. Dès son premier air, certaines notes tenues vacillent de façon inquiétante, et l’on a beau se dire que cela s’arrange au fil du concert, le problème revient au dernier acte, avec des graves qui bougent beaucoup. Dommage que l’excellent Jean Teitgen, dans la même tessiture, se voie confiné à un rôle de second plan : passé son monologue initial, on n’entend plus guère Flaminius. Quant à Nicolas Courjal, on enrage de le voir réduit au troisième hallebardier, avec quelques répliques ici ou là. Pour les voix de ténor, on aurait pu souhaiter une différence plus nettement affirmée entre les deux Philippe, mais l’un (Do) est davantage du côté de la vaillance et de l’autorité, et l’autre (Talbot) dans la fougue juvénile. Quant aux dames, si l’on n’est pas toujours séduit par le timbre de Jennifer Borghi, on est une fois de plus conquis par Gabrielle Philiponet, qui a su s’imposer dans des rôles pour lesquels elle ne semblait pas forcément taillée à ses débuts, même si sa Violetta de Massy en janvier dernier devrait rester une prise de risque exceptionnelle pour laisser à ses moyens le temps de s’épanouir sans risque. On la retrouve dans le bonus vidéo de 7 minutes ajouté en fin de parcours, où elle interprète un extrait d’Adrien au Palais des arts de Budapest, entourée de Philippe Do et de Nicolas Courjal, avant d’être rejointe par Marc Barrard et Philippe Talbot et le chœur.