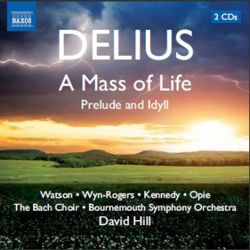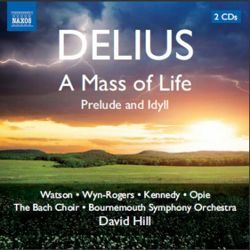En 1897, Delius avait composé une mélodie sur un passage d’Also Sprach Zarathoustra, « Noch ein Mal ». Un an après, y ajoutant d’autres extraits, il en reprit la musique pour lui donner une forme plus ambitieuse : ainsi naquit Mitternachts-Lied Zarathustras, pour baryton solo, chœur d’hommes et orchestre. En 1903, il écrivit à son ami Edvard Grieg : « De mon Mitternachtslied ai-je besoin de te dire qu’il n’a absolument aucune relation avec le Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss que je considère comme un échec complet ». Dès l’année suivante, estimant peut-être qu’il n’avait pas lui-même rendu justice au texte de Nietzsche, il devait y revenir, et c’est sur un collage d’extraits réalisé par le chef d’orchestre Fritz Cassirer qu’il composa la musique de cette « messe » qui n’a pas grand rapport avec la liturgie officielle, en réutilisant notamment pour la conclusion le morceau composé en 1898, complété par des voix de femmes et amputé de sa conclusion paisible, remplacée par un tutti vocal et orchestral. Il s’agit donc d’une partition complexe, dont la gestation fut longue, et qui reflète diverses influences : paroxysmes post-wagnériens auxquels se mêlent des tourbillons de joie rappelant certaines pages de Gustave Charpentier, mais aussi passages pleins de douceur qui lorgnent plutôt du côté de Debussy. Dirigé par David Hill, le Bournemouth Symphony Orchestra défend avec brio et conviction l’un des chefs-d’œuvre de Delius.
La première audition intégrale en avait été dirigée en 1909 par Sir Thomas Beecham, le texte étant chanté dans une traduction anglaise (A Mass of Life). En 1951, l’illustre chef britannique décida qu’il était temps d’en donner la version originale, en allemand. Pour Eine Messe des Lebens, il était donc assez logique de s’assurer le concours d’un chanteur germanophone, et l’on fit appel à un baryton allemand de 23 ans pour tenir le rôle principal. Le jeune homme qui fit alors ses débuts en Angleterre n’était autre qu’un certain Dietrich Fischer-Dieskau… Ce n’est hélas pas avec lui que Beecham réalisa son enregistrement en 1952-53 : apparemment, Fischer-Dieskau aurait dû y participer, mais il tomba malade au mauvais moment, tout comme pour le deuxième enregistrement de l’œuvre, réalisé en 1972. A ces deux premières versions devait s’en ajouter une troisième en 1997, chez Chandos. Dans ce nouvel enregistrement qui coïncide avec le vingt-cinquième anniversaire de Naxos et le cent-cinquantième anniversaire de la naissance du compositeur, Alan Opie succède à Bruce Boyce, Benjamin Luxon et Peter Coleman-Wright, et même si l’on peut regretter qu’au disque, aucun chanteur de renommée internationale ne se soit attaqué à cette partition (qu’y aurait donné un Thomas Hampson ?), il faut reconnaître que le baryton britannique défend fort bien cette partie écrasante, avec une noblesse de diction que n’ont pas toujours eu ses devanciers.
Si le baryton-Zarathoustra est quasi omniprésent, le chœur est lui aussi extrêmement sollicité, intervenant à peu près constamment, massif au premier plan, ou plus léger en tapis sonore derrière les solistes : The Bach Choir se montre tout à fait à la hauteur de l’exercice, dans la douceur comme dans les déchaînements d’euphorie collective. Les trois voix solistes n’interviennent, elles, que dans quatre des douze numéros, soit 45 minutes sur une heure quarante que dure cette messe en deux parties. La contralto a un peu plus à chanter en solo, lorsqu’elle devient l’incarnation de la Vie, mais le ténor et la soprano doivent se conter de quelques phrases. Catherine Wyn-Rogers profite fort bien des quelques moments que lui offre la partition pour déployer son beau timbre grave. Entendu à l’Opéra de Lyon dans les rôles mozartiens et dans The Rake’s Progress, Andrew Kennedy coule ici sans peine sa voix ferme et élégante dans un format plus héroïque. De la straussienne Janice Watson, récemment Maréchale à l’ENO, on entend surtout le vibrato ; elle livre une prestation beaucoup plus envoûtante, mais non exempte de duretés dans l’aigu, toutefois, dans Prelude and Idyll, arrangement conçu en 1932, à partir de fragments de l’opéra Margot la Rouge (1902), sur un nouveau texte, anglais cette fois, tiré de poèmes de Walt Whitman.