Célèbre rivale de la Cuzzoni et compagne de Hasse, Faustina Bordoni avait inauguré cette collection dédiée aux voyages des stars du temps jadis, Antonio Florio et ses Turchini accompagnant déjà Roberta Invernizzi, dont il est permis de se demander si elle ne serait pas la véritable héroïne de cette aventure singulière… Domenico Gizzi (1687-1758), en revanche, ne dira probablement rien aux mélomanes, sinon à quelques baroqueux pointus : parmi les castrats de cette génération, seule la réputation de Senesino et de Bernacchi a réellement traversé les siècles. De Gizzi, la postérité a surtout retenu les qualités de pédagogue grâce, notamment, au sopraniste Gioacchino Conti, qui lui rendit hommage en choisissant pour surnom « Gizziello », les compositeurs Latilla, Jommelli et Feo ayant également bénéficié de son enseignement au conservatoire de Sant’ Onofrio. Natif d’Arpino, dans le royaume de Naples, le chanteur fit une brève apparition à la Chapelle Giulia du Vatican dès 1705, mais ce n’est qu’en 1718, après avoir conquis la cité parthénopéenne, qu’il fera ses débuts scéniques à Rome. Le récital publié par Glossa embrasse une douzaine d’années de création dans la ville éternelle depuis le Telemaco d’Alessandro Scarlatti (1718) jusqu’à L’Andromaca de Francesco Feo (1730), alignant de nombreux inédits sélectionnés avec le concours du musicologue Juan José Carreras.
Cette anthologie, censée couvrir la période de maturité du musico, ne brosse pas le portrait d’un virtuose hors du commun. Doté d’un ambitus de deux octaves, l’organe était manifestement agile mais sans posséder une longueur de souffle ni une élasticité exceptionnelles. Ainsi, les brillants extraits de l’Adelaide de Porpora (« Volo il mio sangue a spargere ») et du Valdemaro de Sarro (« La brama di regno ») s’avèrent moins exigeants que les coloratures destinées, dans les mêmes ouvrages, aux jeunes Farinelli (rôle-titre d’Adelaide) et Caffarelli (Alvida dans Valdemaro) auxquelles se sont frottés Karina Gauvin (Porpora arias) et Franco Fagioli (Arias for Caffarelli). A moins que les limites de l’interprète aient biaisé le choix du programme… Celui-ci n’est pas pour autant toujours adapté à ses moyens, car au-delà de certaines options de tempo, l’écriture de plusieurs pages pousse le soprano milanais à la limite de ses possibilités, l’aigu ne nous ayant pas habitués à de telles duretés, sinon à des sonorités disgracieuses et lassantes lors d’une écoute intégrale de l’album. Par contre, son éloquence raffinée fait mouche dans le gracieux (« Amor che nasce » de Vinci illuminé d’un sourire dans la voix) et le pathétique (sobre et délicat lamento de Bononcini « Barbara siete, o Dei ») où l’art de Gizzi devait probablement s’épanouir.
Dans le désespoir comme dans la fureur, l’Ariodante de Sarro (Ginevra principessa di Scozia) affiche une tout autre sensibilité que le héros de Haendel et son lyrisme paraitrait sans doute tiède si Roberta Invernizzi ne lui conférait juste ce qu’il faut de vivacité et d’urgence pour libérer l’affect. De Pyrrus dans L’Andromaca de Francesco Feo, nous aurions aimé découvrir l’ultime numéro « Alma bella ombra diletta », si prisé des connaisseurs, mais la fougueuse aria « Prima’ l vorace fulmine » qui ouvre le récital illustre également les propos admiratifs de Burney à l’endroit du Napolitain dont « le feu, l’invention, la force dans la mélodie et l’expression des mots » tordent le cou aux idées reçues sur le style galant. Daniela Barcellona avait déjà exhumé de somptueux airs de bravoure dévolus au personnage de Sicoreo (Alessandro Scarlatti Opera Arias), mais le rôle-titre de Telemaco semble également bien doté, s’il faut en croire la vigueur expressive de « Crude Parche » et de « O a morir o a goder ». Au rayon des raretés, signalons encore la délicieuse déclaration d’amour, qui plus est ornementée avec goût, tirée de L’Eupatra de Giovanni Battista Costanzi, très fécond musicien attaché au service du cardinal Pietro Ottoboni dont, hélas, seule une poignée de compositions ont survécu.


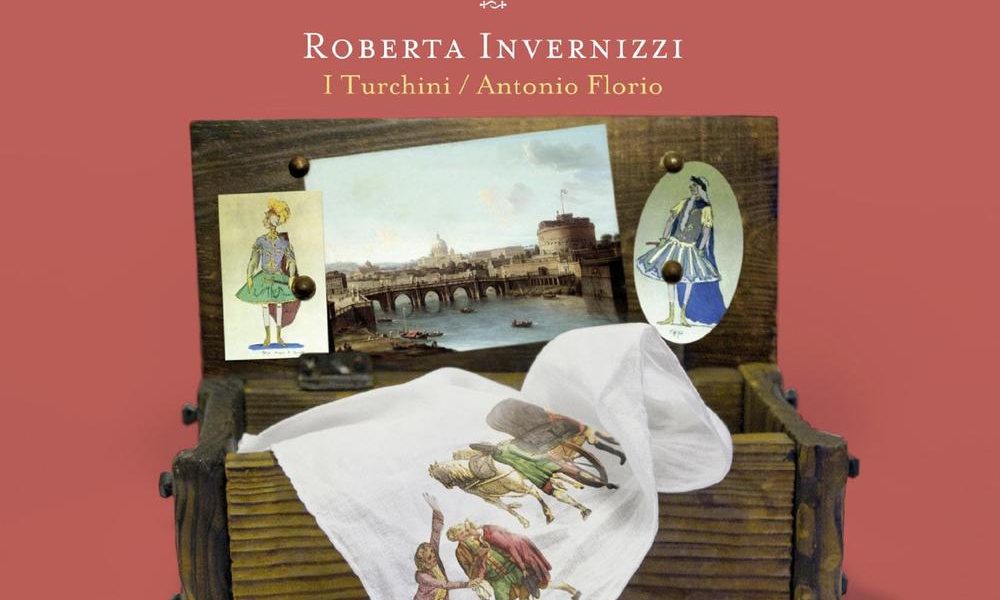




 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes


