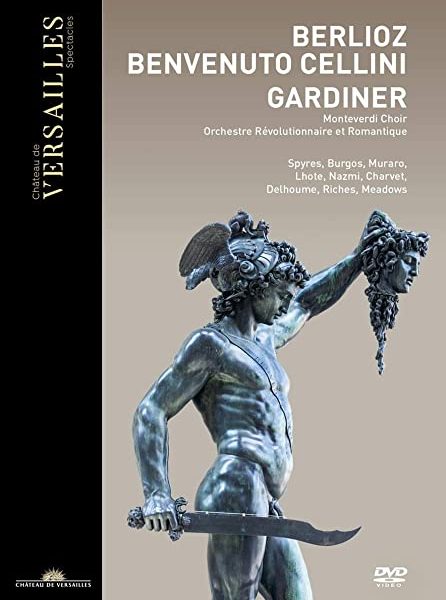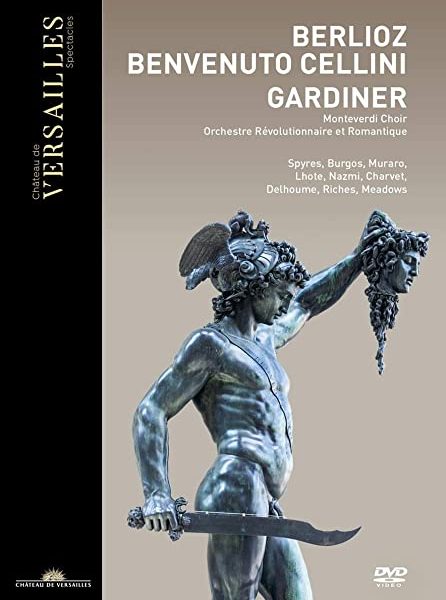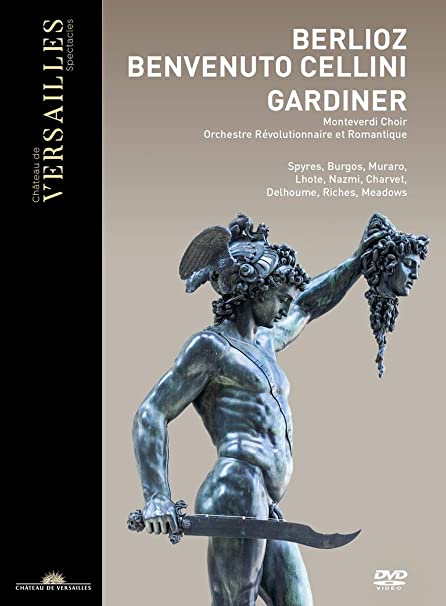Le 10 septembre 1838, la création du Benvenuto Cellini de Berlioz a constitué un échec retentissant pour son auteur, abattu par ses audaces – auxquelles le public de la salle Le Peletier n’était pas franchement préparé – et surtout par ses (nombreux) ennemis. La presse, se faisant l’écho du naufrage, prenait le relais. Le grand caricaturiste Benjamin Roubaud, alias Benjamin, croquait bientôt dans Le Charivari Berlioz en marionnettiste échevelé, essayant tant bien que mal de donner à lui tout seul un Malvenuto Cellini, cette « Grrande (sic) représentation extraordinaire de (…) avec pasquinades littéraires et arlequinades musicales… À la fin de la parade, une grrande (sic) statue sera coulée… l’auteur aussi ».
La carrière de cet opéra-comique pourtant génial en sera durablement marquée et il n’y a guère que ces dernières années, après la fantastique résurrection de l’œuvre par Colin Davis, qu’il est donné avec davantage de régularité.
À l’occasion de l’année Berlioz, pour les 150 ans de sa disparition, l’Opéra royal de Versailles accueillait après le Festival de La-Côte-Saint-André ce Benvenuto Cellini sous la direction de John Eliot Gardiner dans une version mise en espace par Noa Naamat et devant les décors originaux représentant la perspective de la Galerie des batailles dans un palais de marbre et d’or, créés par Cicéri à l’occasion de l’inauguration, en 1837, de ladite Galerie. On dit que Berlioz y aurait dirigé son grand concert du 29 octobre 1848 dans les mêmes conditions que pour ce spectacle. Forumopera avait rendu compte de ce dernier, capté en DVD, dont la réalisation de Sébastien Glas, soignée et intelligente, rend justice au spectacle sur lequel on se focalise comme si nous y étions, et moins à ce fameux décor, qu’on ne voit que de loin.
Le disque confirme parfaitement le ressenti de Laurent Bury, qui avait assisté au spectacle pour Forumopera, même si la captation favorise davantage les artistes. Michael Spyres, presqu’imbattable dans ce répertoire, est de fait souvent aérien et magnifique, mais il n’en est parfois pas moins imprécis et même sur la corde, notamment dans le dernier tableau : son « Sur les monts les plus sauvages » est un rien acrobatique dans ses délicates variations. Sophia Burgos, très appliquée voire un peu sage, elle n’en est pas moins crédible en Teresa. Adèle Charvet nous ravit en Ascanio. Lionel Lhote compose un cocasse et parfait Fieramosca. Le Balducci de Maurizio Muraro est sans doute celui qui a la diction française la moins convaincante de toute la troupe, mais ses graves profonds l’absolvent aisément. Quant au pape Clément VII de Tareq Nazmi, s’il impressionne un peu moins, il est loin de démériter, d’autant qu’il joue parfaitement la comédie.
Car on la joue, la comédie, et même plutôt très bien. Le chœur lui-même, dont certains membres complètent les solistes pour les autres rôles, s’amuse avec gourmandise sur son estrade derrière l’orchestre. La mise en espace est bien trouvée, efficace. Elle confirme qu’il vaut parfois mieux ce genre de dispositif plutôt qu’une mise en scène, a fortiori ratée. La captation permet d’ailleurs de mieux voir certains détails amusants, comme l’entrée du somnolent pape Clément, qui vient appuyer sa tête contre l’épaule du chef d’orchestre, lequel le réveille d’un coup de coude, la mine renfrognée.
Les instruments d’époque de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dont l’existence même est aujourd’hui en danger à cause de la crise, font merveille dans cette œuvre. John Eliot Gardiner dirige avec énergie la partition d’un compositeur qu’il a lui aussi, comme d’autres Britanniques (Beecham, Davis) ou Américains (Nelson) avant lui, si bien servi.
Une belle réussite en somme, qui restitue tout ce que ce spectacle avait de réjouissant. Rien que pour cela et par les temps qui courent, n’hésitez pas à vous en repaître.