Hasard du calendrier : c’est au moment où les amateurs de cinéma peuvent voir sur les écrans son délirant « Homme qui tua Don Quichotte » que Naxos propose le Benvenuto Cellini de Terry Gilliam capté en mai 2015 à l’opéra d’Amsterdam. On aurait pu prédire une parfaite osmose entre le premier opus lyrique de Berlioz et l’imagination sans borne du metteur en scène étasunien. Au début, tout marche bien et le foisonnement de couleurs, de mouvement, de gags « pondus » par Gilliam épouse parfaitement la vie trépidante de l’artiste de la Renaissance. Tout est gai, vivant, drôle et finalement parfaitement fidèle à l’esprit de l’opéra. Il y a certes transposition (vers des époques et des lieux très variés, d’ailleurs), mais comme les thèmes traités dans le livret sont immortels, la mécanique fonctionne. Le finale de l’acte I, et sa fameuse scène du Carnaval romain, est à verser dans les anthologies de l’histoire du théâtre lyrique. Le problème est que la richesse du propos finit par devenir indigeste. L’acte II accumule tant de péripéties, de détails foutraques que l’attention finit par faiblir. Le final semble prendre de court l’imagination de Gilliam, et c’est bien dommage : on était près de tenir une référence, nettement plus convaincante que Philippe Stolzl dans son DVD de Salzbourg (Naxos lui aussi).
Même trajectoire decrescendo avec l’orchestre philharmonique de Rotterdam et Mark Elder. Au début, l’opulence des timbres et la chatoyance de la baguette séduisent, et toutes les familles d’instruments assument crânement leurs parties, jusque dans les pièges les plus redoutables de l’écriture berliozienne. Mais les instrumentistes fatiguent en même temps que l’imagination du régisseur, et les choses ont tendance à s’alourdir, cela alors que la partition réclame tout du long une légèreté aérienne, notamment au niveau rythmique. Tout le monde semble soulagé d’arriver aux dernières mesures sans gros pépin, mais on est loin de l’esprit de comédie qui devrait présider. A noter aussi quelques décalages entre la fosse et la scène, qui mettent parfois en péril l’intonation des chanteurs.
John Osborn était très attendu dans le rôle-titre. Ses triomphes dans les rôles belcantistes, son aisance dans le Guillaume Tell français de Londres et l’évolution naturelle de sa voix le désignaient comme « le » Benvenuto de sa génération. Au final, sa prestation laisse une impression mitigée. La justesse est impeccable, l’investissement scénique fait plaisir à voir. Osborn prend visiblement son pied à jouer les rockers. Mais vocalement, le compte n’y est pas. L’instrument apparaît comme trop mince, trop fluet pour rendre les ardeurs amoureuses et créatrices du Florentin. On a une pointe d’aiguille, alors qu’il faudrait un ample pinceau. Le costume est trop large pour le ténor, et malgré une diction française devant laquelle on tire son chapeau, on est loin de la référence laissée par Gregory Kunde avec John Nelson (Virgin) ou Colin Davis (LSO). Mariangela Sicilia a moins d’atouts que son amant. Si le timbre est agréable, elle se débat avec les voyelles et sa conduite du chant est bien quelconque. En dépit d’une façon agréable de colorer ses ornementations, voilà une Teresa qui ne marquera guère. Surtout qu’elle doit faire face à un Ascanio flamboyant : Michèle Losier porte la culotte aussi bien que la moustache, et il faut la voir faire un sort à chacune de ses interventions, avec la gourmandise d’un chat qui joue avec sa souris juste avant de la dévorer. « Cette somme t’est due » fait trembler les murs du théâtre, tout en respectant scrupuleusement les règles du bel canto le plus orthodoxe. La chanteuse bondit et virevolte sur scène comme un papillon, et elle est idéalement cette incarnation de la jeunesse voulue par Berlioz. Au même niveau d’excellence, le Fieramosca de Laurent Naouri. Certains étaient au départ sceptiques sur cette idée de confier le rôle à un baryton-basse, mais Naouri a l’aigu facile et il faut plus que des problèmes de tessiture pour lui faire perdre sa faconde, son jeu de scène et son habileté à jongler avec les mots. Celui qui fut un inoubliable Balducci pour John Nelson prend rang comme un des meilleurs Fieramosca de son temps.
Du côté des autres clés de fa, le bilan est bien moins glorieux : Maurizio Muraro est encore plus engorgé que d’habitude, et on offrira son poids en or à qui parvient a comprendre un traître mot de ce qu’il chante. Le pape Clément d’Orlin Anastassov est le type même du chanteur qui mâchonne son français et semble ne pas comprendre grand-chose à son texte. Son émission brouillonne n’a rien pour séduire. Dommage, le rôle est essentiel à l’équilibre de l’opéra, et Terry Gilliam lui a ménagé des scènes de derrière les fagots, qui tombent un peu à plat a cause de l’inconsistance vocale de l’interprète. Des chœurs bien tenus mais épais, et des seconds rôles corrects complètent un tableau finalement très moyen. Ereinté par la critique lors de sa création, mal reçu par le public, peu représenté sur les scènes modernes, Benvenuto Cellini attend toujours la version DVD qui parviendra à en révéler toutes les splendeurs.


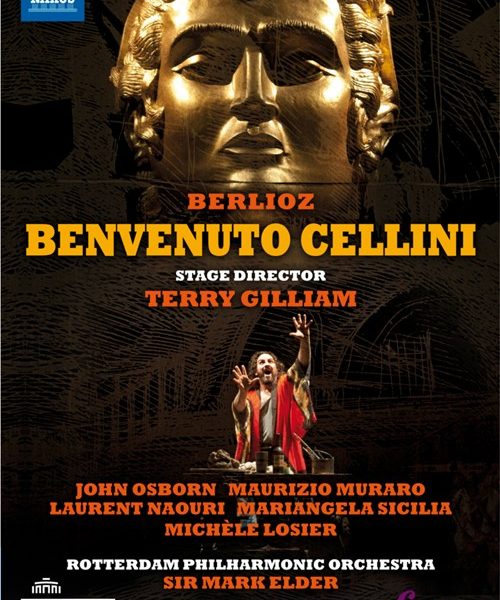
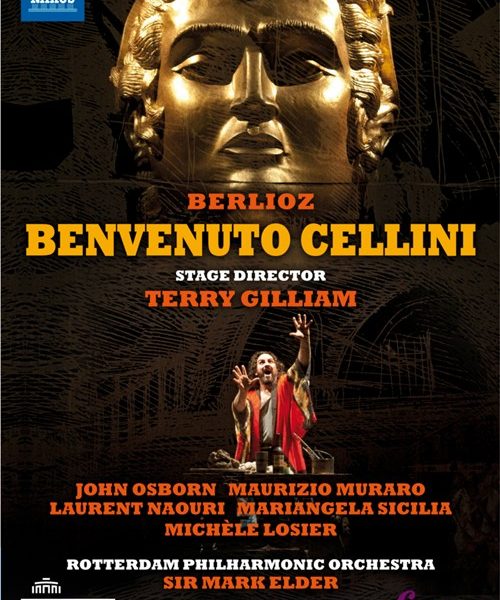


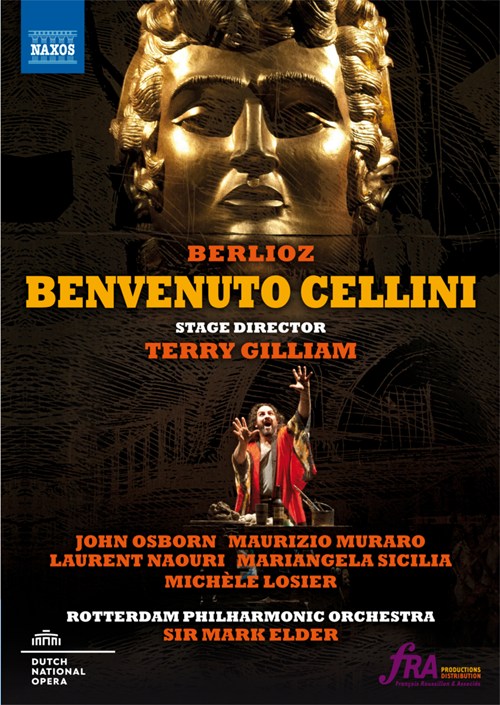

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



