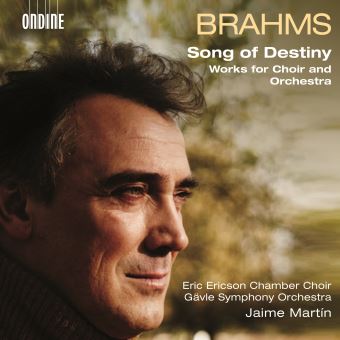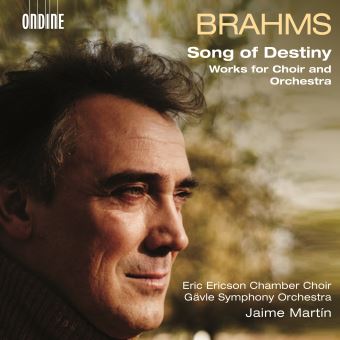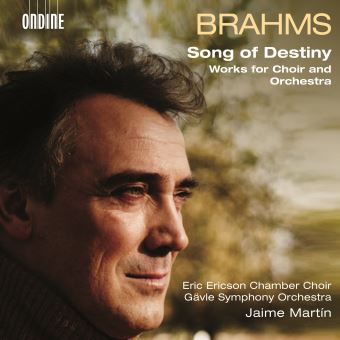Ce nouvel enregistrement dirigé par Jaime Martin réunit deux volets de l’inspiration brahmsienne pour chœur et orchestre. D’une part celui de la spiritualité luthérienne, dans quatre œuvres majeures, complémentaires au Requiem allemand, et d’autre part, celui de la veine populaire, simple et fraîche, même travaillée, illustrée ici par les Lieslieder-Walzer.
La spiritualité brahmsienne, qui nous vaut tant de chefs d’œuvres, se traduit par une résignation sereine devant la mort, avec austérité et gravité, dans la filiation de celle de Schütz et Bach. Les trois premières œuvres forment une sorte de triptyque inspiré de l’Antiquité. Le Schicksalslied [Chant du destin], de 1871, sur un texte d’Hölderlin (tiré d’Hyperion) et le Gesang der Parzen [Chant des Parques], de 1882, sur un extrait de l’Iphigénie en Tauride de Goethe, s’ils portent la marque de cette spiritualité, voient les messages des poètes quelque peu détournés par la musique, qui y ajoute l’espérance et la confiance. En 1881, la Nänie, de Schiller, est une déploration consolatrice, en ré majeur, alors que les autres pièces optent pour l’ut mineur, ou le ré mineur (Gesang der Parzen). De 1859, Moins connu, mais d’un intérêt et d’une force équivalents, Begräbnisgesang [chant d’enterrement] fait appel aux vents pour accompagner les voix afin d’en permettre l’exécution en plein air. Le texte de Michael Weisse, extrait du Gesangbuch des böhmischen Brüder, nous renvoie au message de cette église tchèque, héritière de Jan Hus, antérieure à la Réforme, sans hiérarchie, où la piété individuelle est exaltée.On regrette seulement que le programme n’ait été complété par les deux motets de l’opus 74, de la même veine («Warum ist das Licht gegeben», et «O Heiland, reiss die Himmel auf»), où le chœur peut donner toute sa mesure, a cappella. Le minutage l’autorisait.
Le climat change radicalement avec une sélection de neuf des Liebeslieder [Chants d’amour], opus 52 et 65, réalisée par le compositeur, qui les orchestra. On connaît les deux recueils dans leur version originale, avec deux pianos, composés de pièces charmantes, contrastées et élaborées, dont la séduction se renouvelle. Les pièces sont ici enregistrées dans l’ordre de leur édition sous cette nouvelle parure.
Il n’est pas un chef de chœur qui ignore le nom d’Eric Ericson, personnalité mythique, disparue en 2013. Il marqua de son empreinte le chant choral de l’après-guerre. La formation qu’il créa en 1945, promue rapidement à l’excellence, perpétue cet héritage avec une exigence et une probité rares. Sous la baguette de Jaime Martín, cette nouvelle lecture de Brahms, animée, servie par un orchestre aussi ductile que le chœur, se situe au plus haut niveau, rivalisant voire surpassant les versions dites de référence. L’effectif réduit du chœur autorise une articulation, des interjections, des modelés, des contrastes que les grandes formations écrasent. Toujours la lumière, la transparence sont au rendez-vous, avec cette dimension grave, dépourvue de toute ostentation, qui sied à la musique de Brahms.
Les extraits des Liebeswalzer, pour parfaite qu’en soit l’exécution, surprennent, tant on a dans l’oreille la sonorité percussive des deux pianos. Curiosité plus que révélation. Une mention spéciale cependant. Au seul numéro retenu de l’opus 65, la soliste, Elin Skorup, joli soprano, traduit remarquablement le texte, Nagen am Herzen fühl ich [Je sens mon coeur rongé].
Un enregistrement dont la qualité exceptionnelle est indéniable, mais dont l’écoute en continu est pour le moins dérangée par l’abîme qui sépare les premières pièces de celles de la seconde partie, d’un intérêt anecdotique.