Le paradoxe des Chants d’Auvergne, c’est que l’orchestration en est luxueuse, paysagère, veloutée, versicolore, et que de ses splendeurs elle enveloppe de petites mélodies rustiques, gentilles, sans façons, des chansons de bergère auvergnate.
Prenez Jou l’Pount d’o Mirabel. L’orchestre suggère de vastes espaces, imagine des collines ondulantes où le soleil poudroie, avec tenues nasales des bois, cuivres en demi-teintes, pizzicati des contrebasses, ondulations de la harpe, notes égrenées d’un piano, cor anglais nostalgique, c’est la campagne avec tout le confort de la ville. Ce qu’on aimerait, pour faire contraste, comme un plan serré sur un visage sans maquillage derrière lequel se déploierait un panorama sans fin, ce qu’on aimerait c’est entendre la voix simplette, sans chichis, voire acidulée, d’une petite jeune fille de St Chely d’Aubrac ou de Montivernoux, qui garderait ses brebis et chantonnerait en tricotant (on est en plein cliché, pardon !)
Or ce sont toujours de grandes dames qu’on y entend (et on les adore, évidemment, Dame Kiri, Frederica, Dawn, Véronique, la lumineuse Arleen – idéale selon nous, et d’ailleurs idéale partout et toujours – et la chère Victoria, si candide et émouvante, par laquelle on découvrit ces mélodies voici pas mal de lustres). Exceptions, Madeleine Grey dans les années 1930 (avec Elie Cohen), d’une savoureuse verdeur, et Netania Davrath (avec un mystérieux Pierre de la Roche *), dont l’ingénuité fruitée, parfois acide, parfois surjouée, approchait d’une chimérique authenticité.
Carolyn Sampson, qu’on connaît surtout dans le répertoire baroque, Monteverdi, Haendel, Bach et qu’on a souvent entendue avec Robert King, Philippe Herreweghe ou Daniel Reuss, mais qui chante aussi le Lied (elle a consacré un disque à Schumann) et la mélodie (un autre dédié à Verlaine), aborde ce répertoire avec une évidente sincérité, beaucoup de probité, un respect fidèle des indications, un timbre lumineux et une maîtrise impeccable des grandes lignes mélodiques que Canteloube recueillit sur le terrain avant de les sertir dans une instrumentation virtuose.
Est-ce à dire qu’on adhère tout à fait à son interprétation ? Pas vraiment, car on y cherche en vain la simplicité, l’utopique rusticité qu’on aimerait. Petite tendance au portamento, un vibrato parfois excessif, quelque chose de compassé dans l’expression de l’émotion, d’un peu trop cantatrice, un rien affectée dans les pièces humoristiques (Lou boussu), parfois d’une truculence qu’on dirait forcée (Malurous qu’o uno fenno, de toute façon pas facile)… On voit par là combien il est difficile d’être simple, ingénu, quand de surcroît l’écriture de Canteloube demande souvent à la voix d’aller se percher sur les notes hautes.
Les grandes joies viendront ici de l’orchestre, d’autant que la prise de son est somptueuse. Le Tapiola Sinfonietta fait des merveilles sous la direction de Pascal Rophé. On sait que Canteloube emprunte à la fois à l’impressionnisme debussyste et au lyrisme de Vincent d’Indy, son mentor. Cor anglais et basson, souvent sollicités, rivalisent de fruité (le prélude de La Delaïssádo), un hautbois virtuose est évidemment en charge du pastoralisme, les cordes sont soyeuses et on aime la souplesse voluptueuse de La Brezairola (une berceuse), la rutilance de Malurous qu’o uno fenno, les mélanges acides de Per l’éfon, le pointillisme bondissant de Tchut, tchut, les agaceries bigarrées de Lou coucut. Il faut dire que Canteloube, derrière un visage austère de notable et le monocle du hobereau monarchiste convaincu que « la terre ne ment pas », se délecte de voluptés sonores et prend un évident plaisir à jouer des bigarrures infinies d’un orchestre raffiné et spirituel, et que Pascal Rophé s’en amuse lui aussi.
Au total, un fort joli disque, qu’on écoute avec plaisir, mais qui ne met pas un point final à la discographie de ces pièces fragiles et fleurant bon leur terroir (ou leur territoire, selon la terminologie en vigueur).
* Pseudonyme derrière lequel se cacherait Pierre Monteux, dit-on.


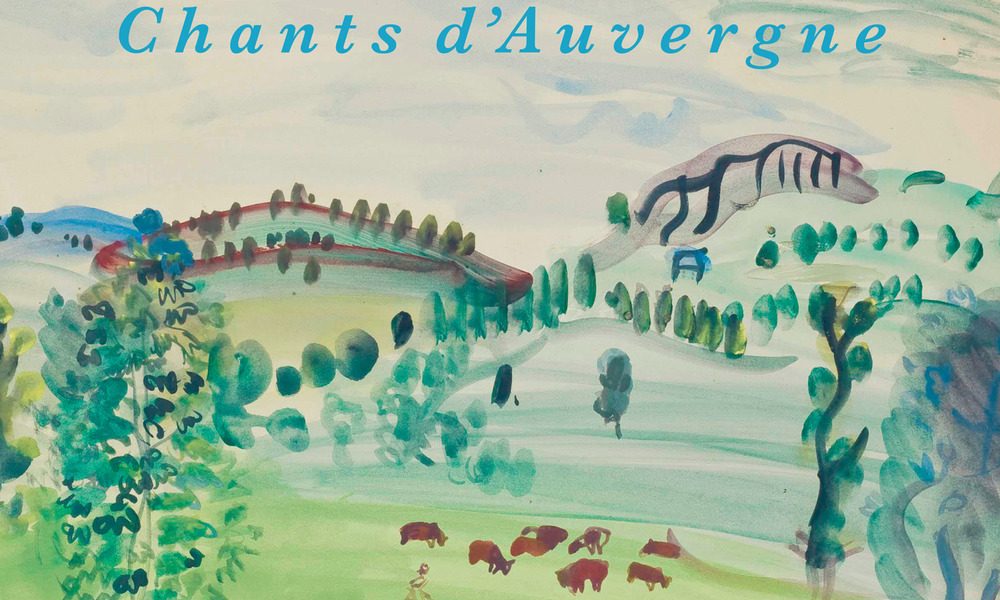
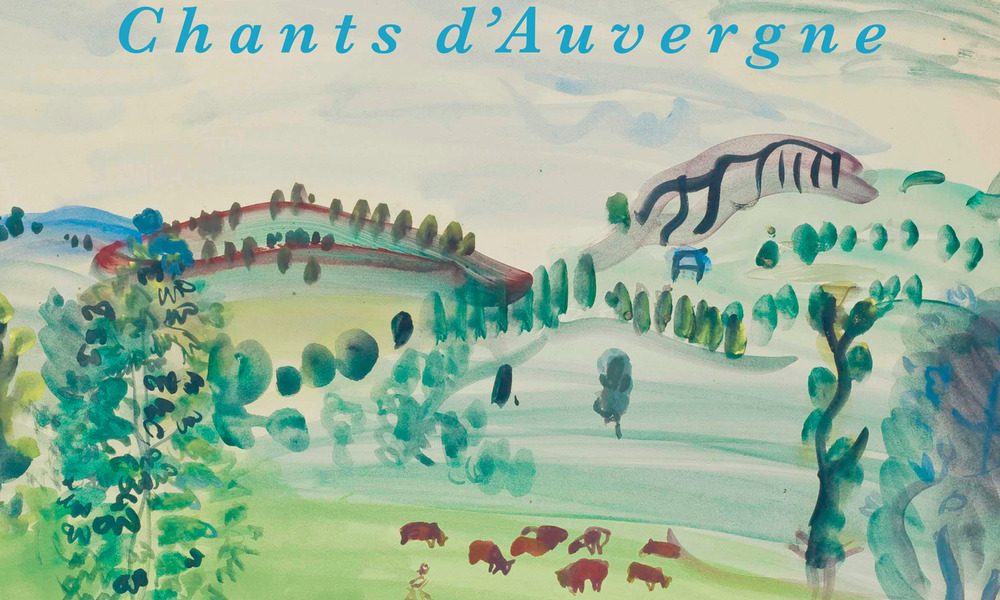




 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



