Un gigantesque portrait de Nietzsche s’offre à la vue du spectateur durant le prélude de ce Parsifal. Dieu est-il mort ? Le message, dans une telle œuvre, pourrait sembler tantôt provocateur, tantôt pertinent, le premier acte se déroulant de toute façon dans un royaume que foi et espérance semblent bel et bien avoir déserté. Surtout, il dévoile plus sûrement que la colère hystérique des détracteurs de « Sur le concept du visage du fils de Dieu » la poésie et la profondeur de l’univers de Romeo Castellucci.
Un univers profondément imprégné par le fait religieux, où chaque geste, chaque visage, chaque personnage semble destiné à incarner une attitude, rejet ou adhésion, pessimisme ou optimisme, face à la foi. Un univers panthéiste, où personnages et nature, au I, se confondent, où Kundry, Eve dénaturée, est associée, au II, à un serpent. Un univers ambivalent, qui s’ouvre en point d’interrogation : où vont ces innombrables figurants, au III, pour autant que leur long cheminement les mène véritablement quelque part ? Un univers, enfin, dont on découvre vite qu’il tourne autour de Parsifal pour mieux en scruter la surface – et en éviter les profondeurs : l’inventivité des décors a beau être complètement ahurissante, et les images, d’une incontestable et hypnotique beauté, rien jamais ne fait vraiment corps avec l’œuvre de Wagner.
Tout fonctionne comme si Castellucci superposait sa propre rhétorique au langage du compositeur, préférant, au lieu de participer à la fusion que suppose le Gesamtkunstwerk, composer sa variation toute personnelle, bien souvent magistrale, finalement déroutante. Parsifal, bien entendu, suscite davantage de questions qu’il n’apporte de réponses ; mais c’est à une réflexion d’un autre genre qu’est invité ici le spectateur : pour sa première incursion dans le monde de l’opéra, le scénographe italien a choisi de ne pas mettre son esthétique au service de l’œuvre, mais au contraire, de faire de l’œuvre le moyen (on n’ose écrire : le prétexte) de sa démarche artistique. Ce serait, pour un peu, Richard Wagner qui mettrait en scène Romeo Castellucci. Et tout surprenant (et contestable) que soit ce spectacle, il devait être immortalisé comme une expérience théâtrale particulièrement stimulante.
Quid de l’expérience musicale ? Elle nous trouvera plus concis : la distribution peut compter sur l’engagement impressionnant d’Andrew Richards, l’alto ductile d’Anna Larsson, ou le beau style de Thomas Johannes Mayer, qui montre en Amfortas des subtilités de chanteur d’oratorio. Avec le Gurnemanz usé de Jan-Hendrik Rootering et le Klingsor détonnant de Tomas Tomasson, les choses se gâtent passablement.
C’est avant tout l’orchestre que l’on retient : comme à Paris en 2008, Hartmut Haenchen réalise un travail remarquable, où la clarté de chaque pupitre n’empêche pas la cohésion d’un puissant jeu d’ensemble, où la précision « analytique » du geste se rallie, une fois n’est pas coutume, du côté de l’expressivité et de l’émotion. C’est beaucoup, pas tout à fait suffisant pour égaler la (lourde) concurrence dans ce domaine. Castellucci, décidément, passe ici avant Wagner !


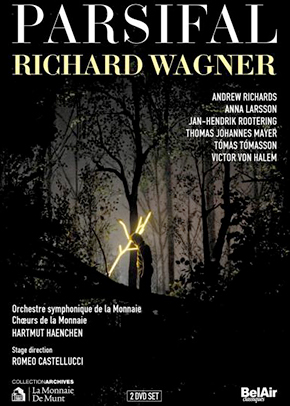
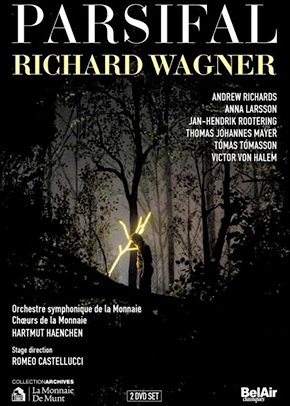



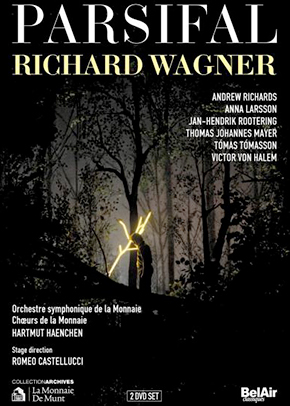

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



