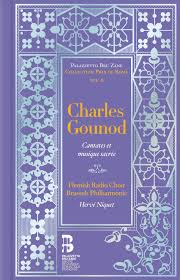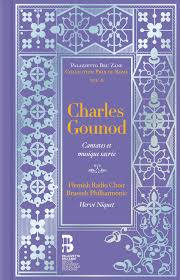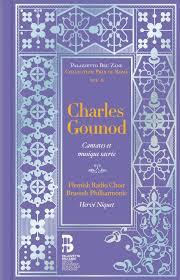Pour le jeune Charles Gounod, le dilemme fut longtemps cornélien : devait-il se tourner vers la prêtrise ou composer pour le théâtre ? Devait-il écouter ses penchants ou suivre les injonctions de sa mère ? Au fil des années, ayant renoncé à servir Dieu directement, il allait trouver le moyen de concilier ses diverses aspirations, tant en incluant dans ses œuvres scéniques des moments de religiosité – la fameuse « Scène de l’église » dans Faust, l’inspiration de Polyeucte – qu’en consacrant sa musique à l’exaltation de la foi chrétienne, avec des œuvres comme Rédemption ou Mors et vita.
Ouvrant ses portes à Gounod à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, la collection « Prix de Rome » du Palazzetto Bru Zane reflète très exactement cette tension entre deux orientations. Les deux disques enchâssés dans le livre réalisé avec tout le soin habituel sont consacrés, l’un aux trois cantates soumises au concours trois années de suite, jusqu’à l’obtention du Premier Grand Prix, l’autre à des œuvres pieuses conçues à Rome entre 1840 et 1842, dont l’un des fameux « envois » exigés par l’administration du concours. Est-ce à dire que le premier disque est tout entier voué au registre profane et aux séductions du théâtre, et le second exclusivement dédié à la plus sévère piété ? Ce serait trop simple.
Le CD1 propose les cantates dans un ordre non chronologique. Comme l’explique Alexandre Dratwicki dans son texte d’accompagnement, Gounod arrive à une date-charnière du Prix de Rome, lorsque la cantate imposée, qui a déjà pris un caractère dramatique plus évident avec le passage à deux voix au lieu d’une, atteint son apogée opératique au moment où l’on introduit une troisième voix. Les effets sur lesquels reposait à la même époque le triomphe de Meyerbeer sont désormais permis aux candidats. On est frappé par les préludes orchestraux que Gounod propose : Hervé Niquet ne manque pas de mettre en valeur la saisissante introduction de la cantate de 1837, ou le prologue de celle de 1839, à la fois mozartien et annonciateur du début de l’acte du jardin de Faust. Le premier essai peut sembler un peu laborieux, mais le succès final de Fernand ne surprend pas, car malgré ses concessions aux conventions du temps, c’est une vraie réussite. Et le trio y prend la forme d’une prière, « Dieu qui lit dans les cœurs » (prière aussi dans La Vendetta, mais à deux voix, « Dieu, dont l’éternelle clémence »). Et bien sûr, ce sont ces trois cantates qui offrent aux chanteurs le plus d’occasions de briller. Chez les dames, on retrouve Chantal Santon-Jeffery, souvent sollicitée par le PBZ, qui campe avec pudeur son personnage de mère corse. La voix de Gabrielle Philiponet ne cesse de prendre de l’ampleur, au point de devoir parfois se montrer précautionneuse pour ne pas malmener la musique. Quant à l’héroïne de Fernand, Judith Van Wanroij y est superbe et confirme qu’elle est parfaitement apte à aborder les partitions du XIXe siècle, où l’on commence seulement à l’entendre plus régulièrement : gageons qu’elle sera dans quelques jours une magnifique interprète du Tribut de Zamora. Chez les messieurs, Nicolas Courjal confirme sa véritable adéquation avec le répertoire français, Sébastien Droy se tire correctement du rôle de Rizzio, mais la véritable révélation, c’est l’autre ténor, ce Yu Shao que l’on avait pu voir dans Le Timbre d’argent. Mais qui chante aussi bien, se demande-t-on, qui chante dans un français aussi châtié, avec un timbre aussi charmant ? Le ténor chinois, qui fait ici merveille et qu’il y urgence à retrouver dans cette musique ; espérons que le petit rôle de Ruiz dans Le Trouvère en juin prochain à Bastille lui permettra d’aborder ensuite de vrais grands rôles.
Côté musique religieuse, malgré la belle prestation du Chœur de la radio flamande, on est d’abord un peu refroidi par l’austérité extrême de la Messe vocale, archaïsant et a cappella (l’orgue mentionné dans le livret ne s’entend guère). Les pages avec orchestre sont d’un attrait plus manifeste, et l’on est immédiatement séduit par le Christus factus est, à la mélodie caressante, où le théâtre reprend ses droits, et où Judith Van Wanroij ravit l’oreille une fois encore. Dans l’Hymne sacrée, l’essentiel du texte est confié au baryton soliste, un très convaincant Alexandre Duhamel, précédé par le ténor Artavazd Sargsyan, à l’aigu souvent un peu tendu. Et la Messe de Saint-Louis-des-Français permet de mieux écouter le beau timbre grave de Caroline Meng.