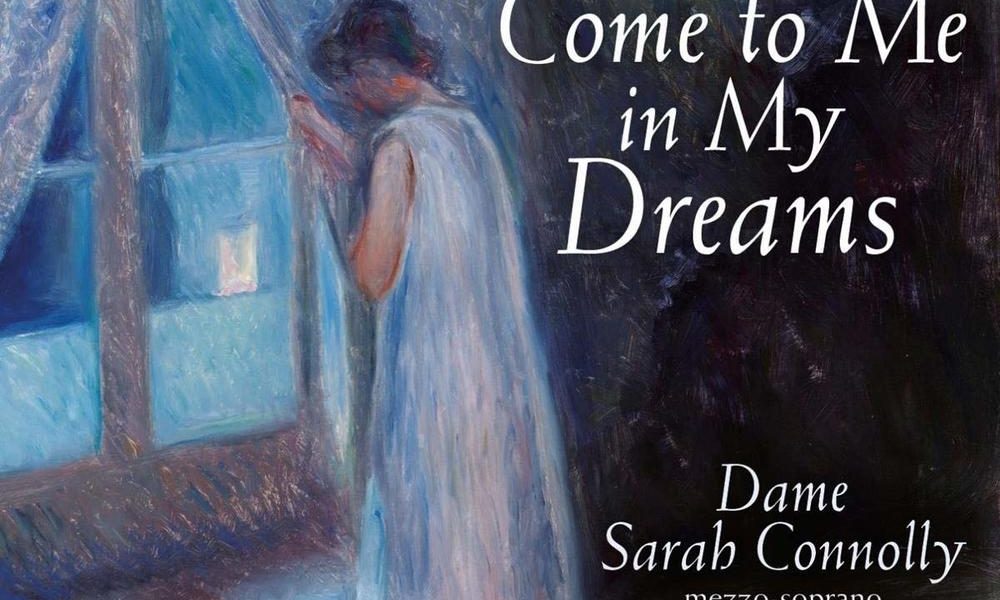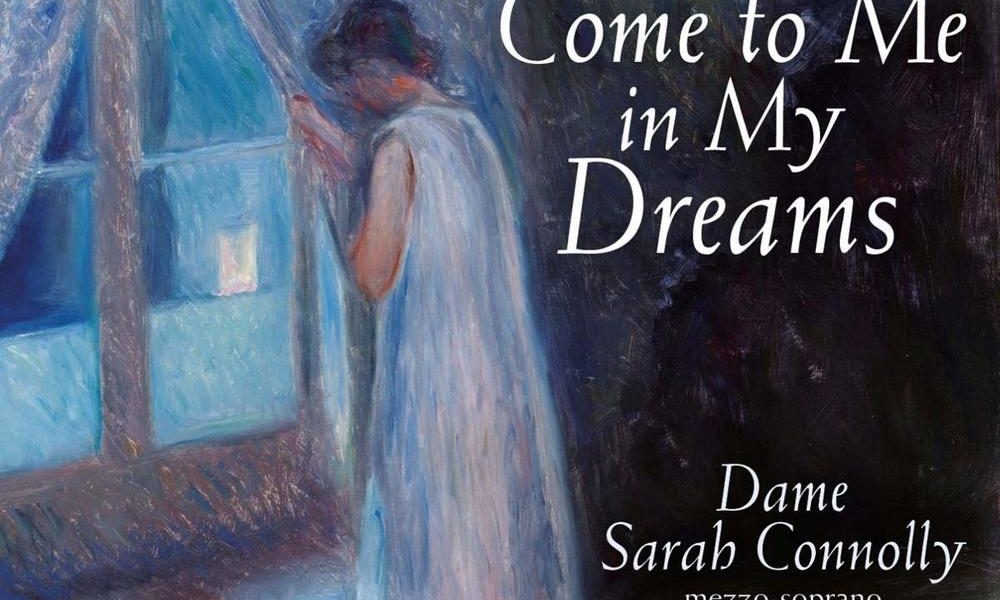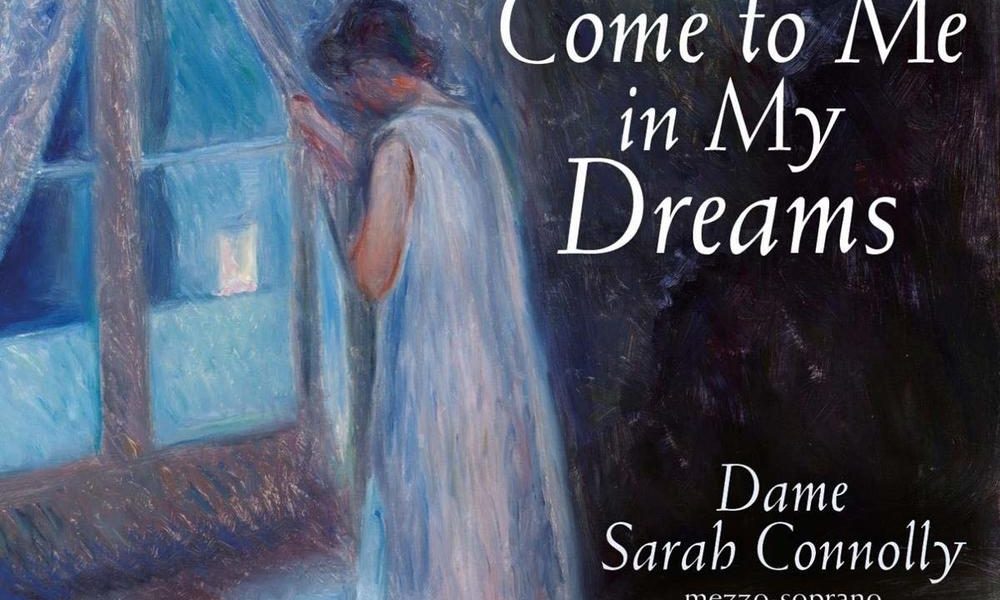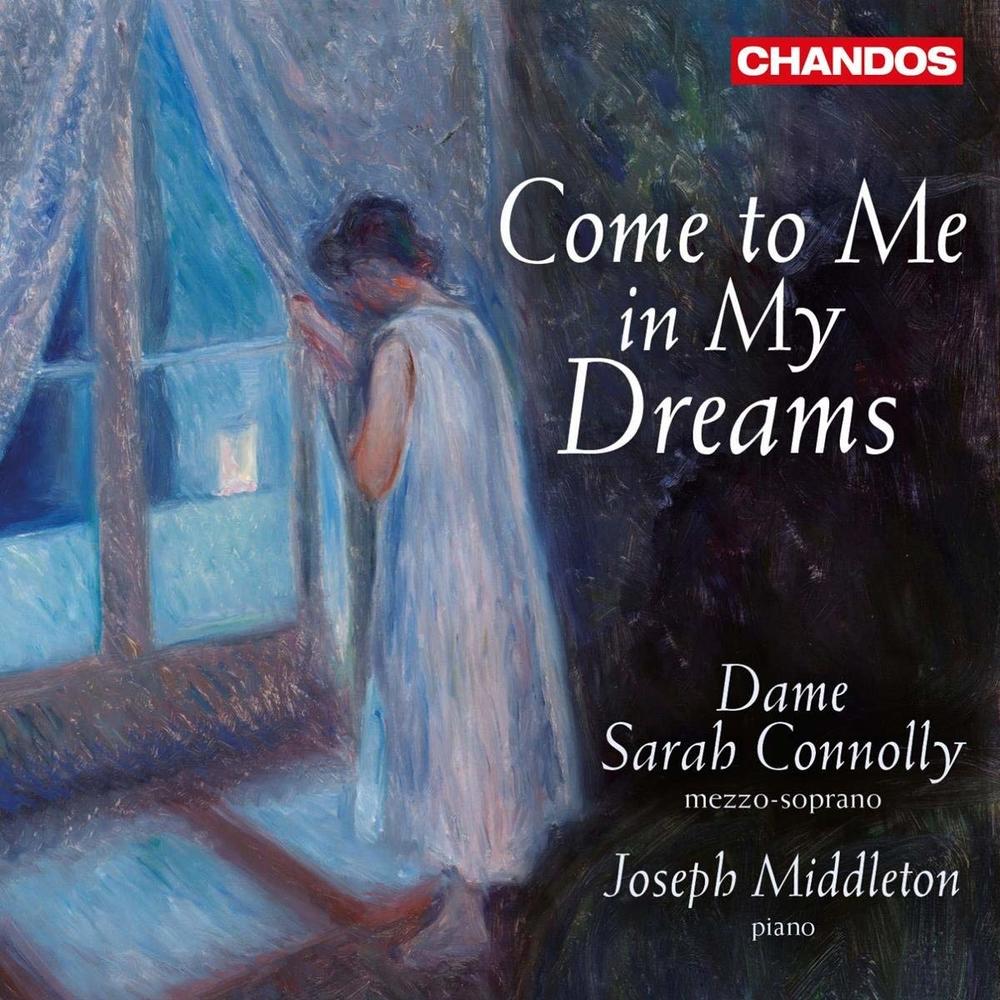Ne cherchez pas : le nouveau récital de Dame Sarah Connolly n’a d’autre but que de proposer un échantillon de mélodies britanniques composées entre le début du XXe siècle et notre époque. Seul fil conducteur, si c’en est vraiment un : tous les compositeurs dont on entend ici une ou plusieurs œuvres sont passés par le Royal College of Music. Fondée en 1882 par le prince de Galles, cette institution ouvrit officiellement ses portes en 1883 et s’installa une dizaine d’années plus tard dans South Kensington (c’est l’un de ces immenses édifices victoriens aux allures de château que l’on trouve dans ce quartier de Londres, à l’instar du Victoria & Albert ou du Science Museum).
Après y avoir elle-même fait ses études, la mezzo britannique s’est une fois de plus plongée dans les ressources de la bibliothèque du RCM pour constituer un programme relativement varié, où la star qu’est Britten est entourée de toute une constellation d’astres dont la lumière brille plus rarement de ce côté-ci du Channel. Le tout offre un échantillon assez représentatif de l’art de la mélodie britannique, même si l’on peut imaginer que bien d’autres volumes du même genre pourraient encore suivre : dans le livret d’accompagnement, Sarah Connolly dit ne pas avoir trouvé le moyen d’inclure Samuel Coleridge-Taylor (compositeur anglais de père africain) ou Elizabeth Maconchy. Affaire à suivre, donc.
En attendant, Come to Me in My Dreams – titre emprunté à une mélodie de Frank Bridge – couvre un large spectre, le plus ancien des compositeurs présents étant né en 1848, et le plus jeune en 1960. On entendra les tout premiers professeurs du Royal College of Music, Charles Villiers Stanford et Hubert Parry, mais aucun des tout premiers étudiants inscrits dans l’établissement. Le plus ancien des élèves de Stanford ici présent est Gustav Holst, arrivé en 1891, et dont on ne joue guère en France que Les Planètes. Dans toute une série de noms peu familiers, on relève celui de Frank Bridge, avec les audaces harmoniques de « Journey’s End », ce Frank Bridge dont Britten devint le disciple plusieurs années avant d’entrer au Royal College of Music en 1930. Deux dames dans la liste, Rebecca Clarke, entrée en 1907 et première élève femme de Stanford, ainsi que Muriel Herbert, boursière à partir de 1917 (on est saisi par les premières mesures a cappella de « The Lost Nightingale », avec laquelle s’ouvre le disque). Parmi les quasi-inconnus du mélomane, on remarque notamment le debussysme virevoltant de l’accompagnement de « Earth’s Call » de John Ireland – c’est l’occasion de saluer le piano virtuose et miroitant de Joseph Middleton. Tout auréolé de la gloire liée à la création brillante de Peter Grimes, le Britten de 1947 s’amuse avec la tonalité dans A Charm of Lullabies, recueil de cinq berceuses, auxquelles s’adjoignent ici deux pièces finalement non retenues par le compositeur, « A Sweet Lullaby » et « Somnus », qui n’avaient encore jamais été enregistrées.
Avec Michael Tippett, on croit d’abord entrer dans une franche modernité, mais ce n’est qu’une illusion créée par le « jingle » initial des trois Chants pour Ariel, car le reste de la partition est beaucoup plus sage, malgré les aboiements qui rappellent un peu les Heu-Heu de l’écureuil de L’Enfant et les sortilèges). Auteur, entre autres, des opéras Anna Nicole et Coraline (ce dernier sera présenté à Lille la saison prochaine), Mark-Anthony Turnage ferme la marche avec une mélodie spécialement composée pour l’interprète.
Sarah Connolly déplie avec délicatesse les pages de ces partitions redécouvertes, qui nécessitent en général de la sensibilité plus que toute autre chose. Quelques-unes lui donnent malgré tout l’occasion de donner davantage de la voix. Peut-être n’aurait-il pas été mauvais d’inclure aussi quelques pièces propres à arracher l’auditeur au climat de rêverie doucement mélancolique qui flotte sur tout ce programme crépusculaire. Ce sera pour une prochaine fois.