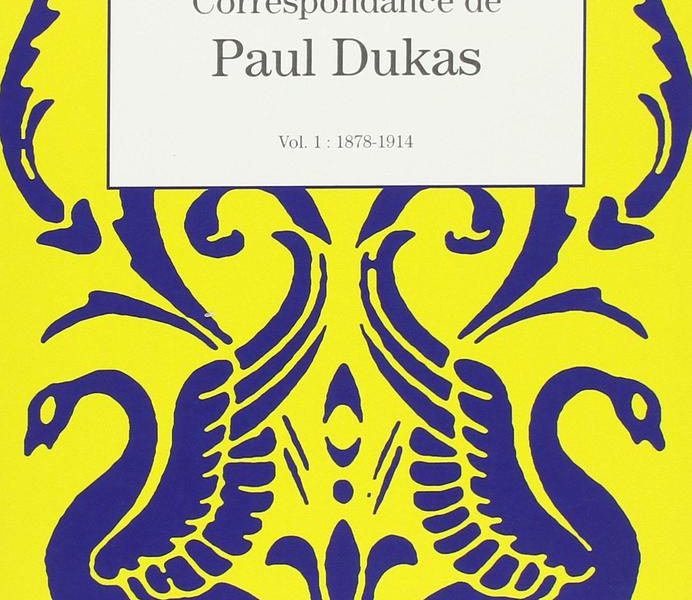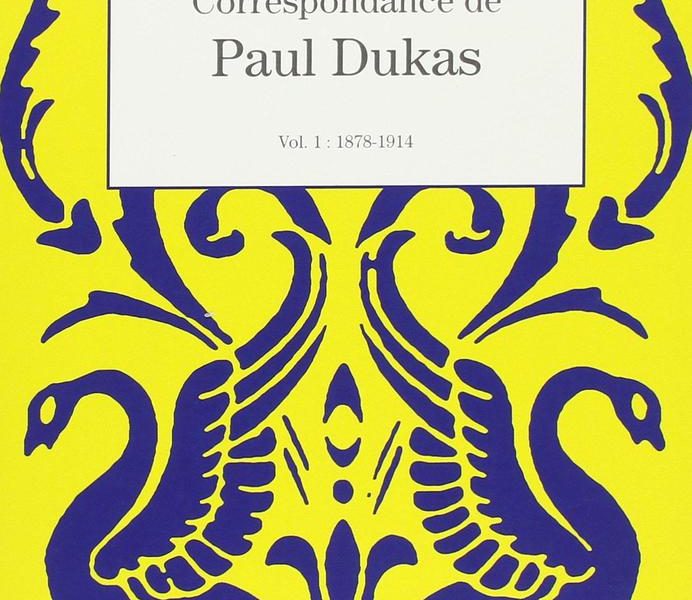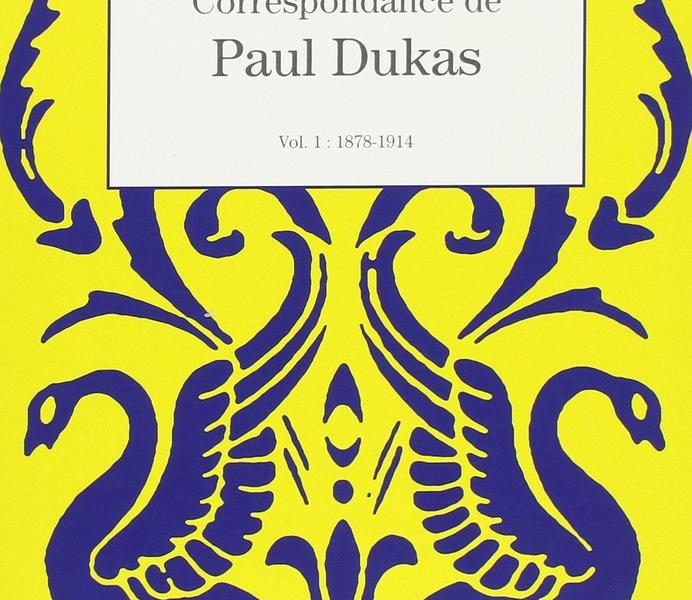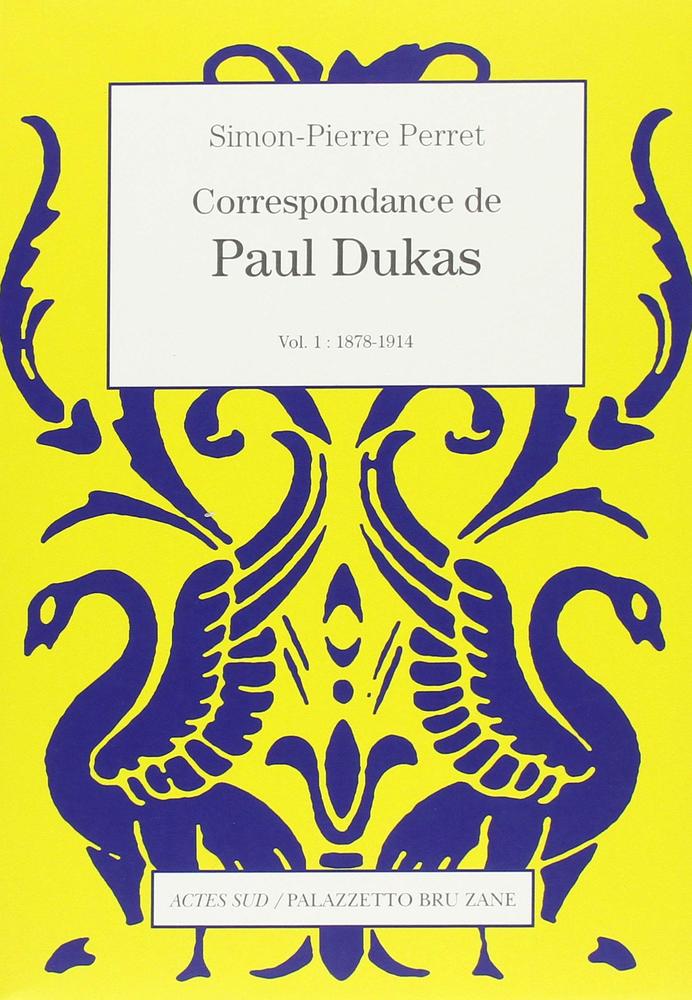Comme le montre le titre de ce compte rendu, tiré d’une lettre de 1912, Paul Dukas n’avait pas sa langue dans sa poche, et n’y allait pas par quatre chemins lorsqu’il avait quelque chose à dire : parvenu au IIIe acte de la composition de son unique opéra, il craint d’avoir commis « une ordure à la Paladilhe » ; quelques années à peine après la mort du malheureux Chausson, la musique de son confrère lui semble déjà « d’un art pénible », « ‘lointain’ et fâné » ; quand il reçoit sa photographie en 1907, il s’exclame horrifié « Je ressemble à [Théodore] Dubois !!! ». Qu’il ait, adolescent, pratiqué un humour potache avec son frère (à base d’allusions au vomi et au caca), cela n’a peut-être rien d’étonnant. Mais qu’il ait conservé toute sa vie un goût pour les calembours, les poèmes absurdes ou les messages en faux ancien français, voilà qui surprend un peu plus. Ce côté plaisantin est l’une des découvertes que permet le premier volume de la Correspondance de Paul Dukas, éditée par Simon-Pierre Perret, cardiologue et mélomane passionné, co-auteur en 2007 d’un biographie de Dukas parue chez Fayard, décédé un an et demie avant cette nouvelle parution ; deux autres tomes sont annoncés pour couvrir les vingt dernières années de la vie du compositeur, ce qui montre que Dukas s’est mis à écrire beaucoup plus à partir de 1914, ou que ses lettres ont été mieux conservées.
Cette correspondance permet notamment de suivre les débuts de l’apprenti non pas sorcier mais compositeur lyrique, qui fait ses armes en orchestrant la Frédégonde laissée inachevée par Guiraud, le travail sur plusieurs livrets détruits les uns après les autres (Horn et Rimenhild, L’Arbre de vie, Le Nouveau Monde), et enfin la lente gestation de « cette Ariane qui ne jamais à mes yeux qu’un essai, une manière de musique de scène », qui connut pourtant un éblouissant parcours et valut à son auteur le surnom de Richard Strauss français. On entrevoit les balbutiements d’un renouveau baroque : Dukas est chargé de la révision des Indes galantes pour l’édition Durand, on donne Dardanus à Dijon en 1907, Charles Bordes impose à ses amis un déchiffrage d’Atys au piano où il chante tous les rôles, on joue Le Couronnement de Poppée au Théâtre des Arts en février 1913. Pourtant, une certaine frustration se dégage de cette lecture, car l’épistolier ne s’étend guère sur toutes ces musiques qu’il mentionne. Alors qu’il assiste à toutes les créations majeures de son temps, de Fervaal à Bruxelles en 1897 à Pénélope de Fauré, il n’en dit presque rien dans ses lettres, comme si cette timidité et ce perfectionnisme l’empêchaient de s’exprimer (ou peut-être simplement parce qu’il livrait ses opinions dans sa critique musicale publiée). « J’ai écrit également, en assez grand nombre, des mélodies et des chœurs, mais tout cela est et doit rester inédit », affirmait-il déjà en 1899.
L’âge venant et la guerre approchant, Dukas s’autorise parfois à se montrer plus disert sur son art. On retient par exemple un éloge de ce qu’il appelle le « théâtre raté », ces opéra hors-normes que sont « Fidelio, Les Troyens, Euryanthe, Genoveva, etc. » Mais quelques mois plus tard, force est de constater que « la musique est fort dans le marasme » : « Vieilles choristes logées en des hôtels louches, danseuses sans emploi, professeurs de piano naufragés »… Alors qu’Ariane lui avait valu le surnom de Richard Strauss français, Dukas s’écrie le jour de la déclaration de guerre : « Si ça tourne mal, je me ferais plutôt casser la figure que de voir Richard Strauss K[apell]meister impérial à l’Opéra de Paris ». On espère qu’il se sera par la suite enhardi à davantage parler musique, ce que les volumes suivants nous apprendront.