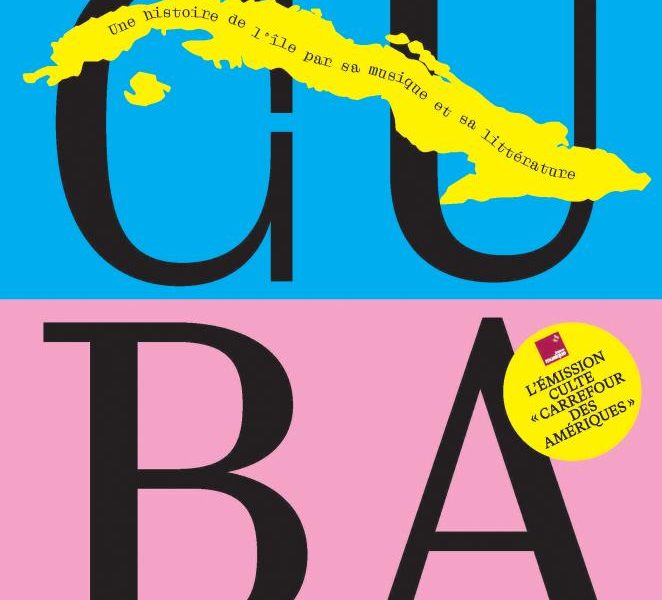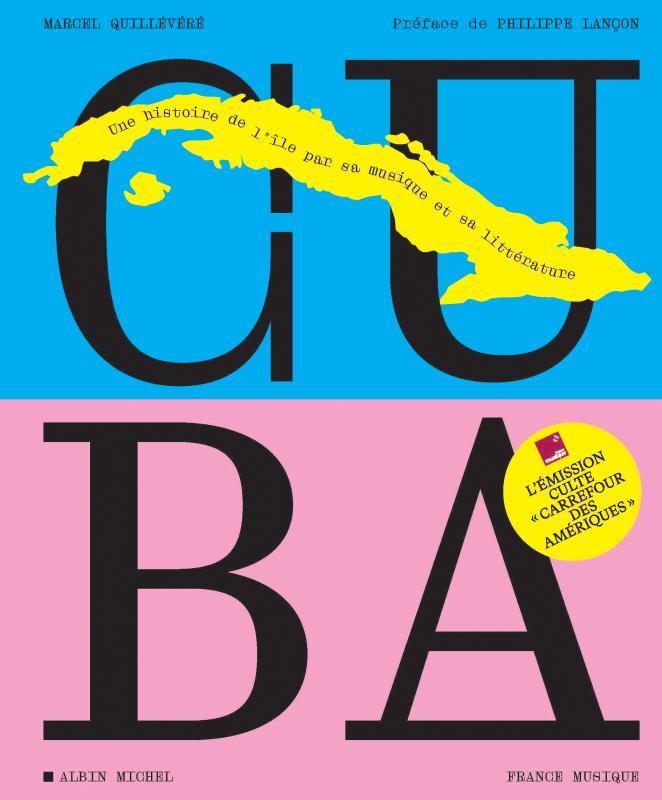Guajira, habanera, guaracha, rumba : autant d’invitations à danser collé-serré, autant de corps moites qu’un ventilateur aux larges palmes s’épuise en vain à tempérer, autant d’odeurs âcres d’épice et de sueur, autant de rhum versé à larges rasades sur un comptoir de fortune, autant de plages frangées de cocotiers, autant de clichés. L’onomastique, chère à Marcel Proust, a des limites que l’histoire musicale de Cuba racontée par Marcel Quillévéré s’emploie à repousser.
L’île baptisée Fernandina lors de sa découverte par Christophe Colomb ne saurait se réduire à l’inventaire de ses rythmes tropicaux. D’Esteban Salas (1725-1803), le premier grand compositeur cubain dont les partitions majeures sont d’abord religieuses, de José Manuel Jimenez (1851-1917), « le Liszt d’ébène », de Claudio Brindis de Salas Garrido (1852-1911), « le Paganini noir », de José Mauri (1855-1937), dont l’opéra d’inspiration vériste La Esclava (1921) dénonce la ségrégation raciale et sociale d’une île meurtrie par son passé négrier, de Guillermo Tomás (1868-1933), le fondateur des harmonies municipales cubaines qui fera jouer Wagner à La Havane, de Moisés Simons (1889-1945), accueilli en star dans son pays d’origine après le succès parisien de son opérette Toi, c’est moi (1934), d’Ernesto Lecuona (1895-1963) et ses fameuses zarzuelas, jusqu’à Tania León (1943), engagée par le Grand Théâtre de Genève pour la création en 1999 de son opéra Scourge of Hyacinths dans une mise en scène de Bob Wilson, la liste des musiciens cubains est plus longue qu’on ne le pense. Marcel Quillévéré ne se satisfait pas de les citer ; il les présente ; il les commente ; il les aime.
Cet amour irrigue son texte, abondamment illustré de photos parmi lesquelles, au détour des pages, surviennent bon nombre de visages familiers : Enrico Caruso, Ninon Vallin, Kirsten Flagstad, Igor Stravinsky, Elisabeth Schwarzkopf… Car Cuba au 20e siècle se trouve au carrefour musical des Amériques – titre de l’émission radiophonique à l’origine du livre. C’est là que Tosca accosta un an avant Paris en 1902. C’est avec Aida dirigée par Tullio Serafin que fut inauguré en 1915 le Grand Théâtre de La Havane, splendide édifice néobaroque à la façade ivre. C’est là que débarquèrent Enrico Caruso, Tito Schipa dans les années 1920 et plus tard de grands chefs d’orchestre – Erich Leinsdorf, Bruno Walter, Herbert Karajan dont « le caractère hautain et un peu condescendant » s’adapta mal au tempérament « enjoué et généreux » des cubains. Leur venue prélude à une fièvre wagnérienne qui entrainera le long du Malecón Kirsten Flagstad, Helen Traubel puis Astrid Varnay et qui culminera en 1948 par une représentation de Tristan prise d’assaut. Ainsi s’accomplira la prophétie du plus célèbre des lieder cubains, composé par Guillermo Tomás : » Le pin du Nord sous la neige rêve d’un beau palmier, là-bas, au pays du soleil ».
L’histoire s’assombrit ensuite avec la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959. Beaucoup d’artistes préfèrent l’exil à un régime communiste autoritaire et liberticide. Mais Marcel Quillévéré refuse d’interrompre son récit. Bâillonnée, Cuba chante encore. Si « la pluie est tombée » et si « le ciel est couvert » lorsque s’achève le dernier séjour de l’auteur à La Havane en 2017, c’est par une note d’espoir que se conclut ce magnifique voyage culturel dans l’île enchanteresse. Avec pour slogan « Patria y vida », en réaction au « Patria o muerte » castriste, la naissance en 2018 d’un mouvement pour la liberté d’expression laisse entrevoir des lendemains meilleurs. Prend alors tout son sens la phrase de l’écrivain cubain Lezama Lima, citée par Marcel Quillévéré en quatrième de couverture : « Vous êtes sur le chemin des illuminations caraïbes où tout se résout dans la lumière ».