Vous qui entrez dans la collection « Opéra français » du Palazzetto Bru Zane, gardez toute espérance : oui, il est encore possible de découvrir des fleurons de notre répertoire jusque-là injustement condamnés à l’oubli. Le Dante de Benjamin Godard vient apporter un éclatant démenti aux oiseaux de mauvais augure pour qui ce qu’on ne joue plus ne doit surtout pas être repris.
Avec cet opéra de 1890, Godard se révèle doté d’une voix personnelle, avec une ampleur d’inspiration qui lui permet de s’élever au-dessus des conventions et des formules. Sorte de Gounod moderne, plus affranchi du découpage traditionnel que Massenet, il possède une veine mélodique qui ne succombe jamais à la facilité et s’exprime à travers dans de superbes monologues, ariosos aux contours souples, le tout animé par un vrai sens du théâtre. On admire ainsi le flottement quasi debussyste du « Comme un doux nid sous la ramée » de Béatrice, suivi d’un superbe duo Dante-Béatrice plein de raffinements harmoniques. Même le « rêve de Dante », qui transporte le poète aux Enfers et au Paradis, passage-piège s’il en est, est riche de moments magnifiques, et Godard relève le défi haut-la-main.
Evidemment, pour qu’une résurrection soit réussie, il ne suffit pas que l’œuvre soit à la hauteur des espérances, encore faut-il que la distribution réunie soit apte à la porter. Sur ce plan, aucun souci, le Centre de musique romantique française pouvait compter sur ses plus fidèles collaborateurs. Après Cinq Mars et avant Le Tribut de Zamora, Ulf Schirmer rend à Godard les mêmes bons et loyaux services qu’il rend à Gounod : l’orchestre de la radio de Munich donne tout son relief à la partition de Godard. Seul le chœur de la radio bavaroise semble manquer un peu de mordant mais peut-être est-ce une question de prise de son. Heureusement, ce reproche ne vaut guère qu’aux deux premiers actes, et on ne trouvera rien à reprocher à sa prestation en anges et en damnés dans la vision du troisième acte.
Pour les solistes, on retrouve le couple formé pour Herculanum. Alors que, au concert ou en scène, Edgaras Montvidas donne parfois l’impression de pousser sa voix sans ménagement, rien de tel pour ce disque, où le ténor lituanien prodigue mille nuances délicates. Quand Dante fait son entrée, sur un monologue d’abord tissé d’imprécations, on craint pendant quelques instants qu’Edgaras Montvidas ne force tout au long, mais pas du tout, car ce bref discours enchaîne aussitôt sur un air plein de douceur, « Le ciel est si beau sur Florence », où la voix sait se faire suave, recourant à bon escient au falsetto quand les mots s’y prêtent. Et contrairement à l’impression créée à Versailles, la prononciation est irréprochable. Dans un rôle qui respecte sa pudeur d’interprète, Véronique Gens se surpasse une fois encore, et sa Béatrice mérite tous les éloges, par l’évidence de sa diction, par la beauté du timbre et par l’intelligence de son incarnation. A ses côtés, Rachel Frenkel a de jolis graves, et la voix de Gemma se distingue suffisamment de celle de Béatrice. En méchant de l’histoire vite repenti, Jean-François Lapointe n’a pas un rôle bien passionnant, mais il a au moins un soliloque, puis un beau duo avec la mezzo. Personnages plus épisodiques, l’écolier a le timbre chaud de Diana Axentii, tandis qu’Andrew Foster-Williams est un Virgile qu’on suit bien volontiers aux Enfers ou au Paradis.
Autrement dit, en nous rendant de telles œuvres, le PBZ fait mieux que remplir sa mission et nous rend l’espoir d’en découvrir encore bien d’autres du même calibre.



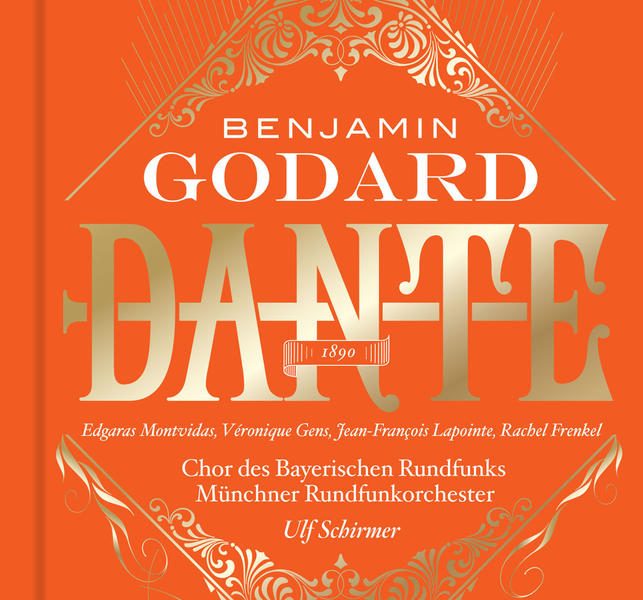
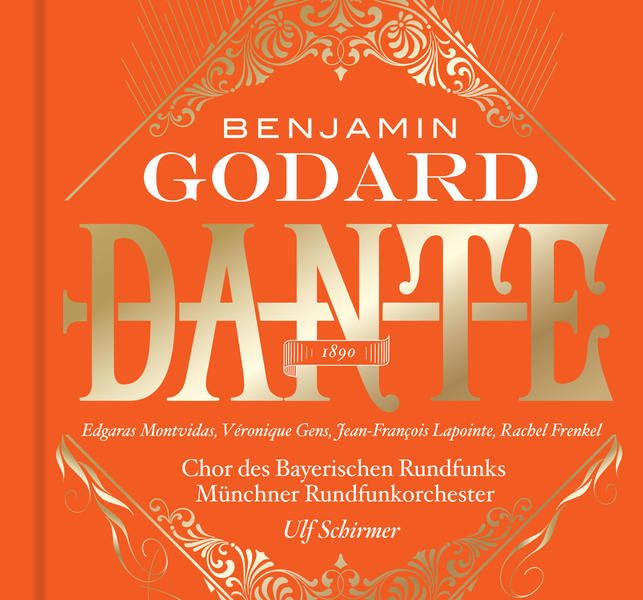



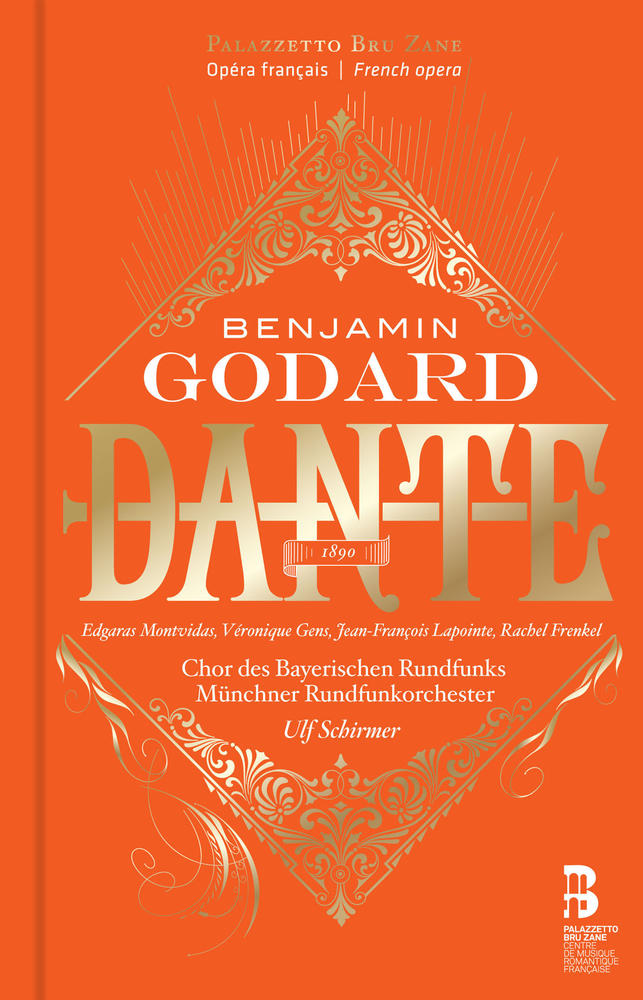

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes

