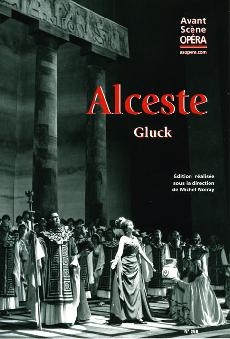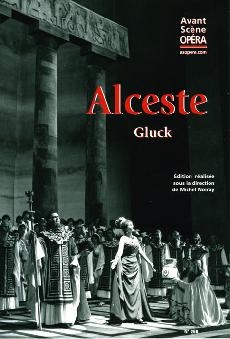Alceste de Gluck. Oui mais laquelle ? L’italienne, créée en 1767 à Vienne sur un livret de Ranieri Calzabigi qui, dans sa célèbre Préface, attribuée à tort au compositeur, déclare vouloir rompre avec les codes de l’opera seria alors en vigueur sur la plupart des scènes européennes. Ou la française, de neuf ans postérieure (1776), qui voit le texte original adapté par François-Louis Gand Le Bland Du Roullet, l’acte III entièrement remanié, la trame dramatique encore resserrée et simplifiée.
Michel Noiray, qui a dirigé la réalisation de ce nouveau numéro de l’Avant-Scène Opéra, ne tranche pas. Au contraire, il explique adopter une approche qui confronte les deux versions, sans en privilégier aucune, partant du principe qu’elles s’éclairent l’une l’autre et que Gluck, en révisant sa partition, a lui-même mis en évidence les mécanismes musico-dramatiques d’Alceste. Le guide d’écoute qui en découle diffère sensiblement de celui que l’auteur proposait en mars 1985 dans le n°73 de L’Avant-Scène Opéra, déjà consacré à Alceste de Gluck. Moins attaché aux détails de l’ouvrage qu’à l’architecture des scènes qui le compose, moins linéaire, plus circonstancié dans son approche, plus impartial aussi, le temps ayant vraisemblablement assagi le rapport qu’entretient Michel Noiray avec l’œuvre. Ni moins pertinent, ni plus intéressant mais complémentaire.
Les autres articles de la revue se substituent avantageusement, pour la plupart d’entre eux, à ceux de l’édition précédente. Seuls deux d’entre eux sont communs aux deux numéros : l’étude de Jean-Michel Brèque sur la légende d’Alceste, d’Euripide à Hofmannsthal et plus particulièrement sur l’opéra de Lully et les deux tragédies lyriques de Gluck ; le portrait de Rosalie Levasseur par Caroline Bouju avec, en encadré, un bon mot rapporté par le Journal de Paris le 21 janvier 1777. Lors d’une représentation d’Alceste, un spectateur, excédé par les accents tragiques de la cantatrice, s’écria « Ah ! Mademoiselle, vous m’arrachez les oreilles », ce à quoi un autre lui cloua le bec en répliquant : « Ah monsieur, quelle fortune si c’est pour vous en donner d’autres ! ».
Plus qu’une anecdote, une manifestation de la querelle qui depuis 1774, année des représentations parisiennes d’Iphigénie en Aulide et d’Orphée, divisait en France gluckistes et piccinistes. Les premiers à l’inverse des seconds se voulaient partisans d’une musique qui sacrifiait la beauté du chant à l’expression dramatique. Bizarrement, et c’est peut-être la seule faiblesse de ce numéro, la polémique n’est que peu abordée, du moins sous son angle historique, alors que la création française d’Alceste contribua à entretenir le débat. Tout juste est-elle suggérée par Jean-Philippe Grosperrin qui cite quelques critiques de l’époque – « lamentable jérémiade », « déplorable psalmodie » – avant d’analyser l’esthétique du terrible dans Alceste et son imitation du rite religieux. La controverse est un peu plus évoquée par Michel Noiray dans Provocation esthétique et plaisir des larmes, une étude qui en déchiffrant le succès de l’œuvre s’attarde sur les réactions qu’elle suscita. Il reste cependant dommage de ne pas avoir reproduit dans cette nouvelle édition les commentaires d’Elisabeth Giuliani sur la position adoptée à l’époque par Jean-Jacques Rousseau. On sait le rôle majeur joué par le philosophe dans les discussions musicales qui agitèrent le XVIIIe siècle français. Tout comme l’on connaît au siècle suivant l’action militante d’Hector Berlioz en faveur de la musique de Gluck. Joël-Marie Fauquet rappelle à ce propos l’enthousiasme rageur du compositeur français dont onze exemples du Traité d’instrumentation et d’orchestration modernes sont tirés d’Alceste.
Enfin, vidéographie et discographie achèvent de rendre nécessaire la lecture de cette nouvelle édition. La discographie surtout car Gérard Condé ne se contente pas de détailler les défauts et les qualités d’une quinzaine d’enregistrements, il enseigne aussi. Il souligne par exemple la triple transgression contenue dans le sacrifice d’Alceste : la mère qui abandonne ses enfants, la reine ses sujets, l’épouse son mari. Il relève également l’erreur qui, selon lui, consiste à interpréter aujourd’hui les airs de Gluck sans ornementation, estimant impensable que l’époque ait pu accepter la reprise d’un air sans qu’il soit un tantinet varié. Il exalte le lyrisme de la version française pour mieux mettre en valeur le dramatisme de la version italienne. Pour autant, il ne choisit pas entre l’une ou l’autre : il nous convainc, après Michel Noiray, que les deux sont essentielles pour qui veut comprendre les enjeux d’Alceste de Gluck : un manifeste en forme d’opéra.
Christophe Rizoud