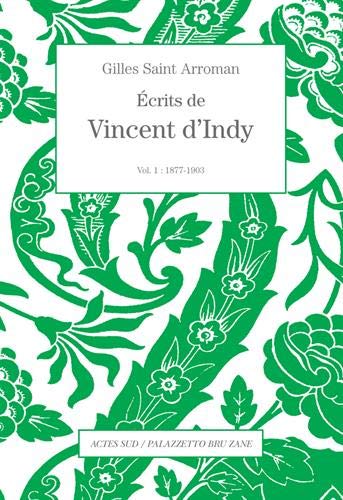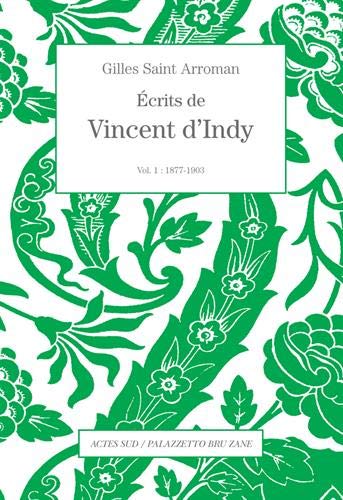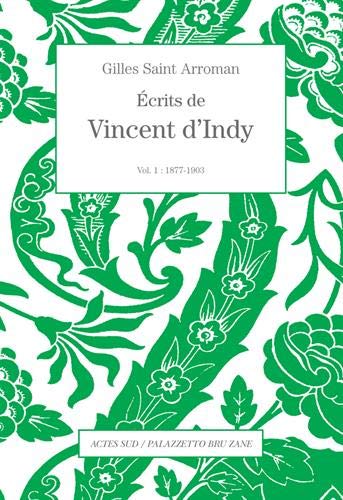En collectant les écrits publiés de son vivant par Vincent d’Indy, le Palazzetto Bru Zane se lance dans une entreprise de longue haleine, puisque le premier tome sorti cet automne devrait être suivi de deux autres. Au cours des 80 années qu’il passa sur cette terre, le compositeur français se montra assez prolixe, malgré ses réticences initiales à s’exprimer autrement que par sa musique. De fait, sur les cinq cents pages que compte ce volume, les cent premières correspondent à la période 1877-1890, les deux cents suivantes à la décennie 1890-1899, et les deux cents dernières aux quatre seules années 1900, 1901, 1902 et 1903 (et il faudra donc un millier de pages pour les trois dernières décennies).
Ce que reflète surtout ce premier volume, c’est la multiplicité des combats menés par Vincent d’Indy, la diversité des passions qui ont pu le pousser à prendre la plume. L’amitié et l’admiration l’incitent à rédiger un hommage à Chausson, à César Franck. Bien sûr, sur tous ces écrits, on compte un certain nombre de rapports correspondant à ses fonctions de jury de concours ou de membres de commissions diverses, et l’on rencontre à plusieurs reprises les réponses plus ou moins succinctes adressées à la presse soucieuse d’obtenir l’opinion de quelques illustres contemporains sur les sujets (musicaux) les plus variés : Verdi, Meyerbeer, Mignon, le Prix de Rome… Il peut aussi s’agir de textes présentant les concerts « pédagogiques » conçus par d’Indy, concerts historiques balayant deux siècles de musique pour révéler au public tout ce qui avait précédé son temps. C’est l’occasion pour le compositeur-musicologue de s’appuyer sur les connaissances acquises grâce à son travail d’éditeur de partitions anciennes, comme celle de l’opéra-ballet Les Eléments de Destouches. Vincent d’Indy développe ainsi une vision téléologique de l’histoire de la musique, qui pourra étonner plus d’un lecteur : que les compositeurs du Grand Siècle soient jugés à l’aune de Bach, passe encore, mais y voir des « précurseurs de Wagner », c’est un peu plus difficile à avaler. Certes, il s’agit d’un compliment, de la part d’un homme encore jeune, pour qui Wagner constituait un aboutissement à peu près indépassable, et qui rédigea en 1886 une amusante évocation du festival de Bayreuth à ses balbutiements.
Dans ces écrits, d’Indy règle aussi ses comptes avec les institutions : l’Opéra-Comique, « théâtre breveté avec garantie du gouvernement pour tout ce qui concerne les coupures, mutilations d’œuvres, etc., célérité et discrétion », et l’Opéra de Paris, « la grande momie qu’on appelle l’Académie nationale de musique ». Evidemment, la première parisienne de Lohengrin, pour laquelle il prépara le chœur, n’eut pas lieu dans un théâtre national, et Vincent d’Indy était l’un de ceux pour qui il aurait été souhaitable de créer un Théâtre lyrique populaire, où l’on monterait, sans le luxe des spectacles donnés à Garnier mais « avec art », des œuvres anciennes délaissées ou des nouveautés refusées par l’Opéra.
Hélas, force est de signaler également un côté nettement moins plaisant de ces textes, mais tout à fait représentatif de l’air du temps. Sans doute rendu indulgent par la longue fréquentation de son sujet d’étude, le musicologue Gilles Saint-Arroman cherche à situer les propos de Vincent d’Indy dans le contexte de cette Belle Epoque qui vit se déchirer dreyfusards et anti-dreyfusards. Membre de l’aristocratie, catholique convaincu – de nombreux textes développent son amour du chant grégorien, sa conception stricte de la musique d’Eglise –, d’Indy prit parti contre Dreyfus, et cela contribua sans doute à libérer une parole anti-sémite virulente. Certes, autour de 1900, « La confusion entre politique et esthétique est à son comble », rappelle Gilles Saint-Arroman, mais l’insistance de Vincent d’Indy risque de rester en travers de la gorge de pas mal de lecteurs aujourd’hui. Quantité de fois, on trouve des références à « la néfaste période judaïque », c’est-à-dire l’époque allant de 1830 à 1870, à « l’école judaïque qui retarda la marche de l’art pendant une grande partie du XIXe siècle », façon de théoriser une vieille détestation de l’opéra sous influence italienne, sans parler des allusions au « péril juif ». Alors, oui, d’Indy eut la clairvoyance, au même moment, de se prononcer en faveur de Pelléas, tout comme il avait salué Louise, deux chefs-d’œuvre ressortant à des esthétiques totalement opposées entre elles et à la sienne. Et il ne fut pas non plus le seul à émettre des propos nauséabonds, d’autres compositeurs les ayant émis à une époque plus sinistre encore. Du moins, en mourant en 1931, l’auteur de Fervaal n’aura-t-il pas eu le temps de voir la peste brune s’abattre sur l’Europe.