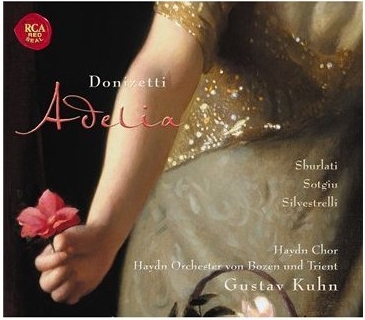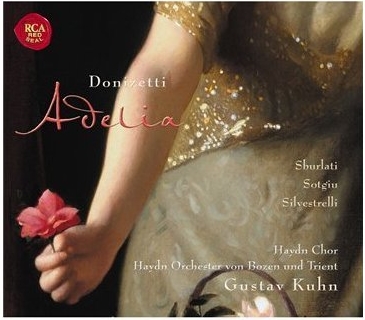« C’est la plus belle ouverture de Donizetti ! », déclarait avec flamme son biographe de langue allemande Robert Steiner Isenmann, à l’auteur de ces lignes, plus intrigué que jamais. On ne connaissait rien alors de Adelia, à cette époque où l’on redécouvrait Sancia di Castiglia, au glorieux Teatro Donizetti de Bergame, en 1984. Depuis, dans un concert où elle figurait et ensuite lors de la reprise complète de l’ouvrage, dans le frémissement du bicentenaire de la naissance de l’Illustre Enfant de la Cité médiévale, on a pu l’entendre, cette ouverture-miracle…
Intéressante, captivante même dans son donizettisme, c’est-à-dire son mélange mystérieux mais parfait, d’allégresse romantique un peu naïve, chaleureuse, mais toujours élégante. Ainsi parée de ce bel avantage, elle nous console de ne pas atteindre, en fait, l’accomplissement de l’ouverture de Maria di Rohan, peut-être la plus complexe, la plus théâtralement symphonique, en ce sens qu’elle élabore de manière symphonique des thèmes de l’opéra, alors que la plus symphonique — celle de Linda di Chamounix — a de quoi l’être si l’on peut dire, car le Maestro la tira de l’un de ses quatuors…
Quant à Adelia, il s’agit d’un surprenant ouvrage qu’un public ému et intrigué se préparait à entendre, ce soir de septembre 1997 au Teatro Donizetti de Bergame. Intrigué car curieux d’entendre ce que son compositeur favori pouvait inventer, entre deux bijoux tels La Favorita et Maria Padilla… Un surprenant ouvrage par son aspect dramatique enflammant la poésie inhérente à toute œuvre donizettienne. Dans Adelia, la passion flambe, anime les personnages conventionnels de Felice Romani et malgré sa déception de ne pouvoir obtenir de fin tragique (la censure pontificale !), Donizetti réussit à donner une scène de folie à son héroïne… juste avant la radieuse cabalette finale de jubilation. On pourrait citer pratiquement tout l’opéra, car même les récitatifs, souvent élaborés en ariosi, du reste, sont gracieux et chaleureux. Ah ! le délicieux sursaut donizettien dans la stretta finale du duo Oliviero-Adelia, sur les paroles : « un sol d’amor, un giorno sol d’amor » (les années seront pour nous un seul jour d’amour)…et la véhémence de la stretta finale du deuxième acte qui coupe le souffle et donne le frisson ! Dans celle-ci Donizetti nous offre même une sorte d’apothéose, en ayant l’idée de couronner les cadences finales, d’une reprise fortissimo à l’orchestre du thème si prenant de la stretta, accompagnant ainsi à merveille la chute du rideau : un climax parfait.
En 1997, c’était déjà le Maestro Gustav Kuhn, fondateur en Toscane d’une Académie destinée à former les artistes du théâtre musical, qui donnait de l’œuvre une lecture flamboyante au point que les membres de la très active « Freunde der Musik Donizetti’s » de Vienne trouvaient qu’il tirait Donizetti trop vers Verdi (ce qui vaut mieux que le tirer vers Rossini, quelque peu baroquisant de fioritures). Le même maestro nous revient, passionnément engagé, avec une foi intacte envers un fort bel opéra, auquel il a voulu donner une chance de diffusion supplémentaire en gravant son interprétation. Vibrante comme au premier jour et pour notre plus grande joie, elle se révèle la meilleure direction d’orchestre disponible : le charme poétique et la chaleur ne sont jamais entravés par des tempi rapides comme c’est le cas trop souvent aujourd’hui encore. Quant aux passages dramatiques, il sont menés avec une ferveur passionnée mais jamais « cassante », autre défaut actuel de chefs ne sachant comment « prendre », aborder, un opéra italien romantique. A la tête d’un efficace « Orchestra regionale Haydn di Trento e Bolzano », le chef autrichien obtient à la fois poésie et flamboiement dramatique, et transcende les petites imperfections de ses chanteurs.
Michela Sburlati, connue des donizettiens par sa participation à l’éclatante reprise de Il Duca d’Alba au « Festival dei Due Mondi » de Spolète en 1990, prête à Adelia, et avec une belle efficacité, sa voix corsée, charnue, faite pour les rôles dramatiques… c’est peut-être ce qui motive les difficultés dans les aigus, parfois un peu tendus et en conséquence coupants. En revanche, les passages « spianati » c’est-à-dire à la ligne mélodique épurée, sans ornementation, sont toujours bien restitués. Son interprétation se rapproche de ce qu’offre à Bergame Daniela Longhi, vibrante, brûlante et insurpassée Adelia, plutôt que de la sensible, impeccable, mais « ciseleuse » avant tout, Mariella Devia.
David Sotgiu possède un timbre clair mais corsé, qu’il plie efficacement à la plainte (dans les passages largo ou dans sa cavatine), comme au « brillant désespéré » (dans les cabalettes et strettes) des mélodies donizettiennes. Par cette expression de brillant désespéré nous entendons ce panache extrême, cette sorte d’allant chaleureux dans les airs d’adieu à la vie, comme Donizetti en composa tant et notamment dans Anna Bolena, Fausta, Parisina, Roberto Devereux, Poliuto, Maria di Rohan. Loin du fade amoureux transi, Oliviero est un sensible personnage, il faut en effet remarquer comment Donizetti, attendri, lui compose des accents frappants par leur affectueux abandon, chaque fois qu’il lui fait ouvrir la bouche à toute nouvelle parution sur scène. L’auditeur remarquera en particulier la tendresse de la musique sur laquelle il s’exclame, ou seulement prononce : « Adelia ! ! ! », le nom de sa bien-aimée. Si David Sotgiu assume les nuances et l’abandon inhérents au personnage, on souhaiterait évidemment un peu plus de chaleur dans le timbre, et l’on pense immanquablement à Marcello Bedoni, choisi par le Teatro Donizetti pour la résurrection de l’œuvre, et qui s’avérait idéal dans le rôle, par son talent et la saisissante similitude de timbre avec celui du Grand Disparu, Ténor de soleil.
Son Oliviero est à la fois noble et affectueux, tel que l’a conçu musicalement le Grand Bergamasque, même si l’on tremble parfois un peu sous l’incertitude de certains aigus…
Dans l’impitoyable père d’Adelia, Arnoldo, Andrea Silvestrelli surprend aujourd’hui comme il nous surprenait en 1997 : une grande et impressionnante ampleur de timbre, plutôt de type slave du reste, une voix caverneuse en somme… ce qui est un mérite pour une basse. Le problème est que sa voix résonne en lui mais s’extériorise mal, faisant qu’il semble chanter pour lui, faire le ventriloque. D’autre part, quelque chose vibre mal dans les cordes vocales : défaut d’émission ? de projection ? un peu comme si l’on entendait, au temps des disques en vinyle, une voix déformée par la restitution d’une pointe de lecture usée. C’est dommage, car la stature, l’autorité et la tyrannie du personnage sont rendues, malgré une articulation qui a tendance à « mouliner » les paroles, défaut nouveau ou consécutif de celui que nous avons tenté de décrire. Dans cette oeuvre fortement dramatique, avec des « heurts » père-fille impressionnants, dignes de ceux de Maria Padilla ou de Linda di Chamounix, il faut un Arnoldo et une Adelia au tempérament affirmé et c’est ce que nous offre cette intégrale, bienvenue compte tenu de la présence fantômatique de celle de Bergame, non officielle, hélas.
Giulio Mastrototaro, en Carlo il Temerario, Duca di Borgogna, propose un timbre clair et un peu tremblotant mais le personnage est plutôt « décoratif », et d’ailleurs le chef des archers Andrea Silvestrelli n’en fait qu’une bouchée tant, par contraste, son timbre est impressionnant de profondeur par rapport à celui du duc !
L’Odetta de Hermine Haselböck est le reflet de son amie Adelia, dans les aigus tendus et déchirants de son timbre aux reflets aigrelets mais gracieux. Dans Cominon le chambellan du duc de Bourgogne, Xavier Rouillon offre un chant aussi impeccable que ne l’est pas sa prononciation de l’italien, venant confirmer cette curieuse vérité selon laquelle le Français éprouve plus de difficultés avec une langue pourtant cousine, bien mieux abordée par Anglo-Saxons, Asiatiques ou Slaves !
Le livret italien-anglais proposé en format informatique « pdf » dans le second disque, se présente de manière aérée et fort agréable, d’une graphie harmonisée avec celle de la plaquette, le rappel du numéro des plages en regard. Seules fautes à corriger, le pauvre Donizetti ne se prénomme pas « Gaetanto » même si en effet il composa « tanto e tanto » (tant et tant !)… et du reste pour le plus grand bonheur des fervents de l’opéra romantique italien, trouvant en lui la chaleur passionnée du Romantisme, mais toujours avec élégance et mesure ! D’autre part, si avant le rappel de la distribution on mentionne bien les auteurs Felice Romani et G. M. Marini, il faut par contre ignorer une indication curieusement égarée en tête du livret : « Opera seria in two acts by Caterino Mazzolà after Pietro Metastasio » (!), mais soyons « cléments » comme cet empereur mozartien concerné par ces librettistes ici malvenus.
La sonorité de l’auditorium Haydn de Bolzano évite la froideur et la réverbération de bien des salles modernes et aucun bruit ne viendra déranger les adeptes de l’enregistrement en conserve… pardon, en studio ! car les applaudissements du public ne surviennent qu’à la fin des actes.
Une bonne interprétation pour découvrir une œuvre étincelante de Romantisme, parfois moins bien chantée que l’intégrale avec Mariella Devia, mais plus vibrante et enflammée par le Maestro Kuhn qui insuffle sa ferveur à tous.
Yonel Buldrini