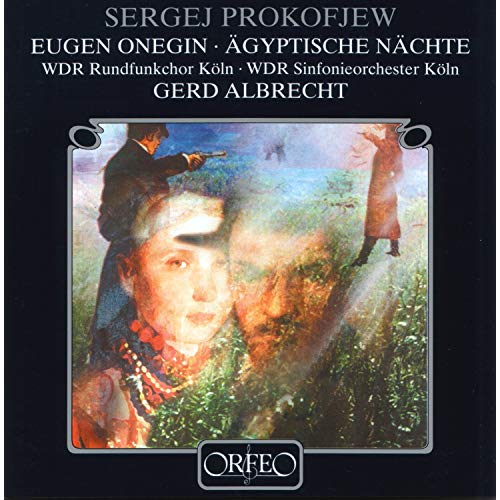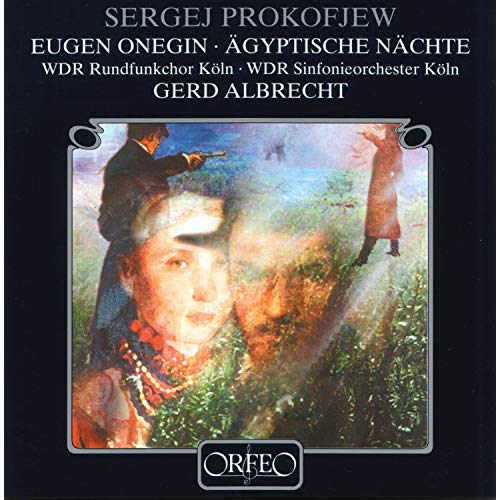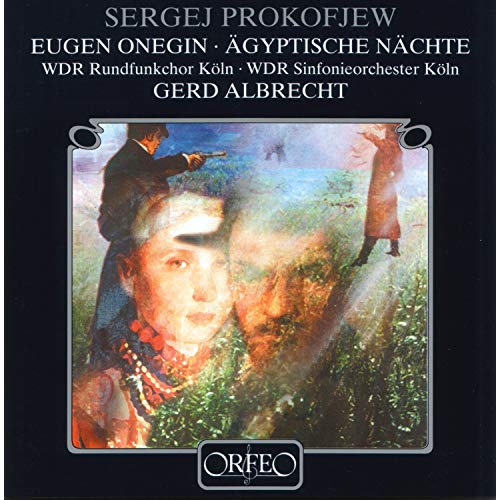Mettre en musique Eugène Onéguine après Tchaïkovski, c’est assez culotté. Surtout pour un compositeur russe. Il fallait oser (ou pas), et Prokofiev l’a fait. Pour le centenaire de la mort de Pouchkine, en 1937, le compositeur de Pierre et le Loup avait apparemment décidé de marcher sur les plates-bandes de ses illustres aînés : il s’était engagé à concevoir une bande-son pour un film d’après La Dame de pique, une musique de scène pour Boris Godounov, et une autre pour une version théâtrale d’Eugène Onéguine. Sauf que, dès 1936, le climat idéologique devint quelque peu tendu en U.R.S.S., et qu’aucun de ces trois projets ne put finalement aboutir. Prokofiev put quand même composer Trois romances sur des vers de Pouchkine mais les autres partitions furent condamnées à l’oubli, ou presque. Presque car une musique écrite n’est jamais perdue, et Prokofiev s’autorisa à réutiliser certains fragments de ces œuvres inédites et, au sens premier du terme, inouïes, dans d’autres compositions qui, elles, purent être entendues et applaudies. En 1964, soit onze ans après la mort de leur compositeur, ces œuvres furent redécouvertes par une musicologue, mais c’est seulement en 1973 que la musique de scène pour Eugène Onéguine fut publiée. Elle fut créée peu après, et le disque Orfeo est un écho de la première en Allemagne.
Donc, il ne s’agit pas d’un opéra, mais l’on y chante (un peu). Et il ne s’agit pas non plus de musique purement symphonique, puisqu’elle avait été écrite pour soutenir la déclamation des acteurs : c’est donc au sens strict un mélodrame, les différents morceaux étant pour la plupart conçu pour accompagner la parole, en l’occurrence les vers de Pouchkine, conservés encore plus fidèlement que dans le livret de Modeste Tchaïkovski. A part un ou deux épisodes, on retrouve ici tous les grands moments de l’opéra, dits au lieu d’être chantés (et donc un peu plus brefs).
Là où la chose devient intéressante pour le lyricomane, c’est que l’on entend beaucoup de Guerre et paix dans cet Eugène Onéguine. On y entend un des thèmes principaux de l’opéra « patriotique » d’après le chef-d’œuvre de Tolstoï, et l’on trouve aussi une valse qui a des parentés avec celle de Natacha et du prince André. D’autres fragments furent réemployés dans Les Fiançailles au couvent. L’intérêt est donc avant tout historique, pour qui voudrait mieux connaître la genèse des derniers opéras de Prokofiev. On s’amusera peut-être aussi de constater que la mort de Lenski évoque les moments les plus sombres d’Alexandre Nevski. A la tête de l’orchestre symphonique de la radio de Cologne, Gerd Albrecht exalte le romantisme de ces pages.
On l’a dit, on chante un peu durant les 42 minutes que dure cette partition. On ose à peine mentionner ce que fredonne vaguement Onéguine sur les mots (en français) « Elle était fille, elle était amoureuse ». En revanche, le chœur de la radio de Cologne intervient bien pour chanter, lors d’une mascarade correspondant à l’anniversaire de Tatiana, mais cela ne dure guère qu’une minute.
Les cinq « solistes » sont des acteurs, dont certains – les messieurs surtout – paraîtront peut-être un peu grandiloquents, mais l’exercice est toujours assez périlleux, qui impose de déclamer des bribes d’un long poème narratif au détriment de la continuité permise par une véritable représentation théâtrale. Est-ce l’interprète de Tatiana, Natalia Andreitchenko, qui chante la courte phrase bouche fermée qui vient peu après la chanson française d’Onéguine ? On peut le supposer, dans la mesure où cette comédienne avait étudié le ballet et le chant.
En complément de programme, la suite d’orchestre tirée de la musique de scène écrite en 1934 pour la pièce Nuits égyptiennes, pot-pourri d’extraits du César et Cléopâtre de Bernard Shaw, d’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, auxquels s’ajoutait un monologue tiré des Nuits égyptiennes de… Pouchkine.