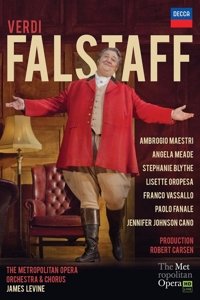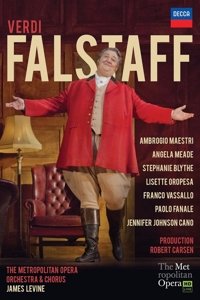Nul ne peut en douter, Ambrogio Maestri règne aujourd’hui sur Falstaff. Et ce royaume, il l’agrandit d’année en année, puisque nous en voici au cinquième DVD qui l’immortalise dans le testament de Verdi. Il y en a donc ainsi pour tous les goûts : élisabéthain ultra-classique à Busseto en 2001 (Euroarts) ou discrètement actualisé à Parme en 2011 (CMajor), mélangeant les époques à Zurich en 2012 (CMajor également), modernisé et surtout peu compréhensible, à Salzbourg en 2013 (Euroarts encore). Avec la production filmée au Met quelques mois après le spectacle salzbourgeois, on tient un version transposée au XXe siècle mais réalisée avec une subtilité et un goût qui font de cette captation une référence. C’est initialement pour Londres, en mai 2012, que Robert Carsen avait réglé cette mise en scène, coproduite par La Scala et la Canadian Opera Company. Situant l’action dans ces années 1950 qu’il n’en finit pas de revisiter, avec des décors et costumes qui proposent un condensé de britannisme (boiseries et fauteuils dignes d’un club anglais, portraits de chevaux aux murs et cheval véritable dans l’écurie où échoue Falstaff au troisième acte, Quickly habillée en Elizabeth II…), Carsen propose une vraie comédie qui respecte les données du livret. Quelques grands moments : le restaurant du deuxième tableau où le temps est suspendu pour le duo de Nannetta et Fenton, ici devenu serveur, ou le pillage en règle de la cuisine très fifties d’Alice Ford. Devant cette succession d’intérieurs clos, on en vient à craindre que la nature soit absente du dernier tableau : erreur, car les panneaux s’écartent pour laisser découvrir un vaste ciel étoilé, et la scène des fées est aussi magique qu’on peut le souhaiter. Et surtout, comme l’œuvre l’y invite mais comme Carsen sait le faire avec La Flûte enchantée, par exemple, Falstaff se termine sur une vraie réconciliation, avec un grand banquet final réunissant tous les protagonistes après « Tutto nel monde è burla ».
Ce qui fait aussi tout le prix de ce DVD, c’est qu’on a le sentiment d’y entendre une vraie troupe, une distribution composée avec soin, où chaque timbre a son individualité qui correspond idéalement au personnage. Le Met a pris soin d’engager plusieurs Italiens, ce qui n’est pas une mauvaise idée dans ce genre de conversation en musique : Carlo Bosi, indispensable comprimario ; Paolo Fanale, dont le physique de jeune premier convient idéalement à Fenton et dont la voix n’est pas en reste ; Franco Vassallo, baryton qui fait son chemin et qui devrait bien finir par s’imposer dans les emplois verdiens dont il a amplement la carrure. Et bien, sûr, l’italianissime Ambrogio Maestri, pour qui l’on monte Falstaff un peu partout, qui l’a chanté sans attendre de ne plus avoir de voix, comme cela arrive hélas trop souvent, et qui n’a quasiment pas besoin de rembourrage pour camper le rôle-titre ; acteur de chaque instant, qui possède son personnage de fond en comble, qui le vit désormais, à condition que la mise en scène le lui permette, ce qui est le cas ici. Keith Jameson et Christian Van Horn ne sont pas natifs de la péninsule, mais forment un couple Bardolfo-Pistola bien dessiné. Du côté des dames, la hiérarchie des quatre voix fonctionne à merveille. Stephanie Blythe est une Quickly-née, avec un timbre sonore naturellement situé dans cette tessiture de contralto, et elle joue fort bien son rôle de commère-entremetteuse. Un cran moins grave, Jennifer Johnson Cano confère à Meg Page autant d’épaisseur que le lui permettent la partition, la mise en scène et sa voix chaude. Habituée à Norma ou à Leonora, Angela Meade s’amuse visiblement d’un rôle qui ne lui coûte aucun effort et où elle impose une jeunesse vocale qui rend tout trucage inutile. Plus à sa place ici qu’en Constanze à Paris l’hiver dernier, Lisette Oropesa est, comme il convient, une Nannetta pleine de fraîcheur, scéniquement très crédible en adolescente. Cela dit, il est assez piquant d’entendre certaines de ces joyeuses commères exiger du parlement une loi contre les gens gros, dans la mesure où leurs propres rotondités plus que plantureuses ne les distinguent pas toujours très nettement de leur cible.
Riche de sonorités onctueuses ou crépitantes, l’orchestre du Met fête ses retrouvailles avec James Levine après un congé-maladie prolongé : même s’il dirige assis dans une sorte de fauteuil roulant, le chef américain n’a rien perdu de sa vigueur et son Falstaff est enlevé comme il devrait toujours l’être. Réussite complète, donc. Bon, et maintenant, si on filmait Ambrogio Maestri dans ses autres rôles, pour changer ?