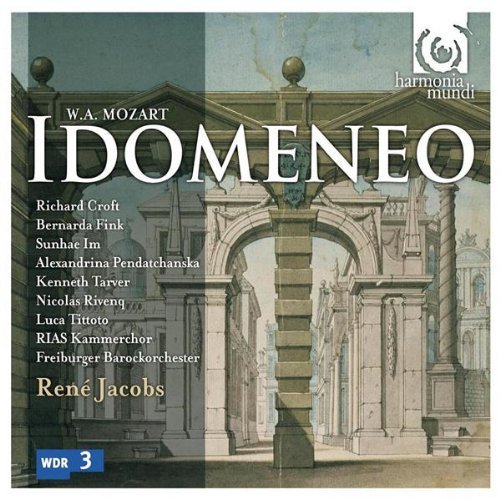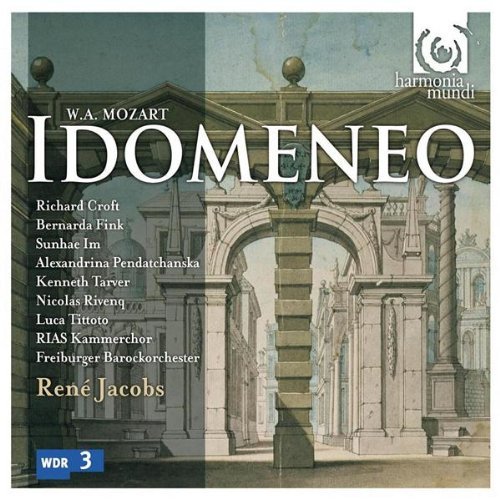Les précédentes réalisations mozartiennes de René Jacobs nous avaient amplement convaincu, jusqu’à un Don Giovanni controversé dont les carences vocales étaient largement compensées par une intelligence musicale plus d’une fois étincelante.
Il est vrai que Jacobs frayait là des chemins où s’étaient illustrés une vieille école un rien pompeuse et une école baroque un rien abrupte. Il retrouvait, comme un sentier médian, une élégance dépourvue de lourdeurs, une alacrité sans nervosité, un langage musical rendu à une jeunesse oubliée.
Certes, on pouvait noter, çà et là, des hâtes, des angles. Mais après tout, nous y avions été habitué par des relectures autrement vertes, par des interprétations où l’authenticité, nettoyant les couleurs noircies des images originelles, faisait jaillir des roses acides, des jaunes aveuglants, des bleus aigres.
Ce que l’on entend dans cet Idomeneo, c’est une surenchère. D’abord sur les partis pris antérieurs de Jacobs même : sa tendance à la vitesse, aux articulations sèches, franchit un seuil vers la brutalité et l’agitation. Et même sur ce que l’on a pu entendre chez les chefs baroques : l’orchestre cultive à loisir l’âpreté des timbres, les voix sont délibérément fluettes et poussées.
Au début, on se dit que c’est une bonne chose que ces chœurs qui aboient et ces chanteurs à court de souffle : c’est un Idomeneo tragique, implacable, qui n’admet ni les retards ni les pauses où l’ardeur mollit. Mais on ne nous ôtera pas tout à fait de l’idée qu’il y a dans cette tragédie-là des langueurs, des doutes, des passages entiers où perlent la bonté et la grâce, la patience et la tendresse. Il suffit de prendre pour exemple les retrouvailles entre Idoménée et Idamante : la scène classique de l’ « anagnorisis », ourlée par Mozart de points d’exclamations et de points de suspensions, est traitée de manière brutale par Jacobs jusqu’à ne plus rien signifier qu’une sorte de délirium rageur, dont on ne pense pas que ce soit ici le ton exact. Même l’épanchement de « Zeffiretti lunsighieri » présente des raideurs dissuasives, que la voix de Sunhae Im, jeune jusqu’à l’acidité, ne contrebalance pas.
C’est une main d’airain qui tient les chanteurs à la gorge. Le timbre agréable de Richard Croft, la soie délicate de Bernarda Fink, le métal souple d’Alexandrina Pendatchanska ne trouvent jamais de quoi s’épanouir, ni même de quoi vraiment respirer. Authentiques artistes, ils blanchissent outrageusement leur timbre, simplifient leur incarnation, se diluent dans les grincements inhabituels du Freiburger Barockorchester et dans les fulminations d’un Chœur survolté.
En somme, on ne voit à tout cela qu’une explication : Jacobs peut fort bien avoir voulu mettre en valeur le fait que cet opéra appartienne aux œuvres de jeunesse, avec leur bouillonnement un rien brouillon et vert, mais aussi à la période clairement germanique de Mozart, dont l’italien ne masquerait pas les raideurs ni les aspérités. Le continuo est surexcité, la moindre phrase est brusquée. C’est l’opéra d’un compositeur en colère, presque en révolte contre certains codes et certaines traditions. Pourquoi pas ?
Qu’on nous permette de douter qu’Idomeneo soit si univoquement violent et exaspéré. Nous y avons trop souvent entendu les nuances du sentiment et les couleurs de la passion pour ne pas adhérer à cette lecture toute livide de rage et dont les mâchoires serrées grincent vraiment trop affreusement.
Sylvain Fort