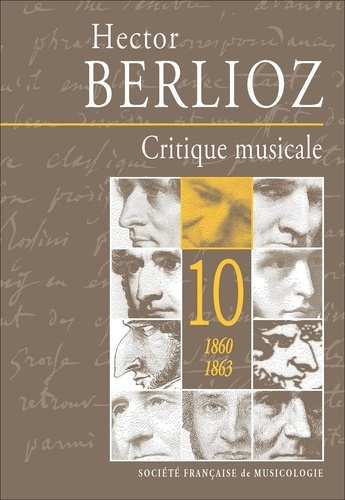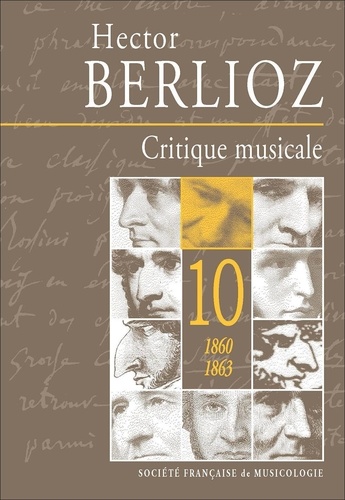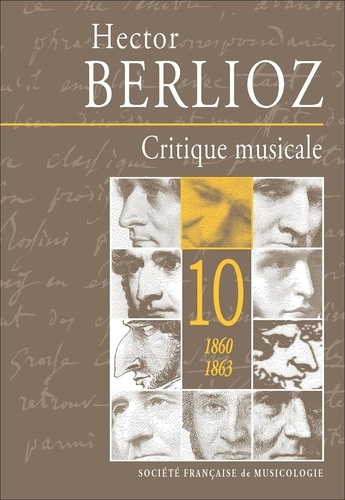24 ans après la parution du premier volume de cette édition monumentale des articles d’Hector Berlioz critique musical, la société française de musicologie en publie le dernier. Il couvre l’ultime période d’activité de l’illustre compositeur en la matière, les années 1860-1863, date à laquelle Berlioz peut enfin « raccrocher » à 60 ans grâce au succès – en Allemagne surtout – de ses Troyens et après 40 ans d’observation de la vie musicale.
Il faut d’abord saluer avec tout le respect admiratif qu’elle mérite cette somme considérable, fruit d’un long et patient travail éditorial que ses auteurs, vivants ou disparus, ont voulu porter à un degré de précision qui n’a d’égal que le soin apporté aux analyses et commentaires permettant d’éclairer pour le lecteur d’aujourd’hui les multiples traits et allusions établis par l’auteur ; mais aussi les choix éditoriaux dans l’intéressante introduction de cette vaste édition critique.
Ce volume couvre donc les dernières années durant lesquelles Berlioz a fait œuvre de critique, lui qui disait qu’il avait, un peu par nécessité, accepté cette « tâche dangereuse qui a pris avec le temps une importance si grande et si déplorable dans (sa) vie », bien qu’il semblât s’y amuser souvent. Il y est, comme dans les autres, énormément question d’art lyrique et le nombre d’articles consacrés à des œuvres aujourd’hui tout aussi oubliées que leurs auteurs, donne à lui seul une idée du foisonnement musical de l’époque. Il donne aussi bien des regrets sur ce dont l’uniformisation du répertoire que nous connaissons depuis des années nous prive, au moins si l’on en croit l’idée que se faisait Berlioz de ce qui peut nous apparaître comme des trésors cachés.
Nous avions eu l’occasion de vous présenter dans ces colonnes quelques-unes des caractéristiques de cette carrière (à retrouver ici), qui n’a pas peu fait pour le prestige de son auteur sur le plan littéraire.
Car Berlioz, c’est une vraie plume, et pas seulement pour le papier à musique. Le talent littéraire du compositeur est l’une des constantes que ce nouveau volume met à nouveau en évidence. Une plume volontiers acérée et que les dernières années ne vont pas émousser. Une plume qu’on aurait tort de toujours considérer fielleuse ou sévère, eu égard au caractère ombrageux – particulièrement dans les dernières années de sa vie – de Berlioz. Certes, nous retrouvons çà et là le Berlioz acerbe, et même violent, dans ces dernières années d’activité. Pourtant, la terrible charge contre le Barkouf d’Offenbach dans un article du début du mois de janvier 1861 ne trouve que peu d’équivalents. Si l’auteur est volontiers caustique, on est frappé, dans de nombreux articles, par la bienveillance qu’il peut avoir pour les auteurs d’une pièce, par la modération dont il sait faire preuve lorsqu’il n’est pas convaincu par tel ou tel choix musical en particulier. Mais il sait en revanche être impitoyable avec les multiples traits de son époque qui l’agacent au plus haut point et en premier lieu les facilités, qui poussent ses contemporains à enrichir leur orchestration de trombones et de grosses caisses à tout propos. On pourrait faire des volumes sur les seules critiques que Berlioz fait de l’emploi de la grosse caisse, lui qui était pourtant représenté en canonnier sur les caricatures lorsqu’il s’agissait de ses propres partitions. Ces mêmes facilités qui les conduisent à réorchestrer les grandes œuvres du passé pour les mettre au goût du jour. Berlioz est un apôtre de l’authenticité des œuvres, il supporte mal qu’on vienne retoucher Mozart (dont il regrette par exemple férocement d’avoir assisté à « l’égorgement » du Don Giovanni en février 1860) et, moins encore, son idole Gluck, qu’il retouchera pourtant bientôt lui-même pour un nouvel Orphée et Eurydice. Mais Berlioz pourra objecter que, maîtrisant son sujet, il y a touché avec toute la révérence qu’il vouait au chevalier. Délicatesse qu’il ne reconnaît pas chez tous les autres, en particulier chez Spontini, qui fit de même mais se plaignait amèrement qu’on revisitât ses propres partitions sans lui en parler, ce que Berlioz ne manque perfidement pas de lui faire remarquer.
On rit également souvent des traits parfois féroces et souvent très ironiques que Berlioz lance aux ouvrages qui lui ont déplu, livrets (toujours décrits avec force détails) comme musique.
Il ne dédaigne pas railler de temps à autre les interprètes, et en premier lieu les ténors : « Oh ! Les ténors, les ténors ! Ils ont toujours quelque chose de détraqué dans leurs rouages, extinction de voix, éraillement de voix, absence de voix, phtisie, bronchite, femme en couches, procès, châteaux en construction, châteaux en démolition, châteaux en réparation et vingt autres afflictions que je m’abstiens de nommer par discrétion. Les directeurs et les auteurs devraient se bien entendre et leur adresser une bonne fois le salutaire avertissement du grand Shahabaham : le premier qui tombera malade sera empalé. » (Journal des Débats, 16 février 1860) ; ou encore cet article du 29 octobre 1862, intitulé « Les ténors sont fort chers » où une ironie presque jubilatoire ne l’empêche pas, plus sincèrement, de dire son admiration pour la voix de certains d’entre eux : « Vous en voulez donc à ces malheureux ténors, me dira-t-on ? Au contraire, je reconnais avec tout le monde que la voix du ténor est une voix charmante, sympathique, qui touche et émeut l’auditeur plus que toute autre, qu’elle est l’âme du drame lyrique passionné. Il y a parmi les hommes qui la possèdent des chanteurs d’un grand talent, excellents musiciens, lettrés, d’ailleurs, d’un esprit cultivé, artistes de tout point, et je les aime fort. » Suit néanmoins un « mais… » …
Gluck occupe quant à lui une place considérable dans ce 10ème volume. Tout ramène au chevalier-compositeur, qu’il s’agisse de reprises ou de considérations sur les différentes versions musicales pour Alceste. On trouve ainsi une série d’articles aussi érudits que détaillés sur les partitions que Lully, Gluck, Schweitzer, Guglielmi ont pu tirer de ce sujet, en partant de la tragédie d’Euripide et en passant par sa transformation en livrets par Quinault ou Calzabigi.
1860 est aussi l’année d’un des plus célèbres articles de Berlioz, l’un des plus passionnants pour qui veut comprendre sa vision de l’art lyrique et même du sens de la musique, et qui ouvre ce volume. Il s’agit en effet de « La musique de l’avenir », qui relate une série de concerts de Wagner au Théâtre-Italien (!) en février de cette année-là. En quelques pages virtuoses, Berlioz, sans totalement mésestimer son confrère allemand dont il apprécie par exemple le Prélude de Lohengrin, tranche : la musique de l’avenir ? « Non credo ». Il faut dire, comme le rappelle une note, que Berlioz considérait Wagner comme un « fou », à l’instar de ce qu’en pensait ouvertement Verdi, partition en main, mais bien plus nuancé dans son for intérieur.
Enfin, c’est avec Bizet et ses Pêcheurs de perles que Berlioz clôture sa carrière de critique musical. Un article bienveillant et positif qu’il conclut ainsi : « La partition des Pêcheurs de perles fait le plus grand honneur à M. Bizet, qu’on sera forcé d’accepter comme compositeur, malgré son rare talent de pianiste lecteur. ».
Les derniers mots de Berlioz pour le Journal des Débats font curieusement un écho grinçant au répertoire de l’Opéra de Paris qu’il lui arrivait déjà de trouver très uniforme (on n’y jouait sans doute pas assez Berlioz…) : « Quant au théâtre de l’Opéra, on y donne toujours de temps en temps La Favorite et les autres chefs-d’œuvre de l’immortel répertoire ; on a tort quand on lui reproche de ne rien donner de nouveau : il a donné sa démission. »…
Ecoutez Berlioz, bien sûr ; mais lisez-le aussi. C’est un bonheur de tous les instants et un fabuleux témoignage de son temps et l’on ne peut que se sentir reconnaissant qu’il nous soit désormais restitué dans son intégralité.