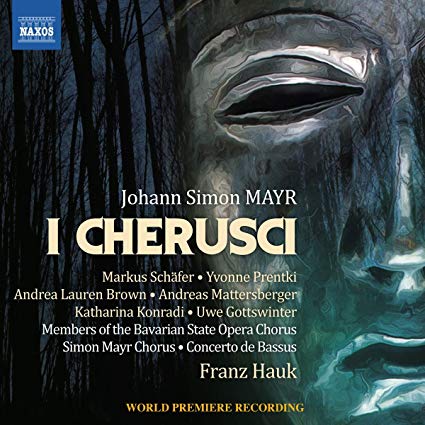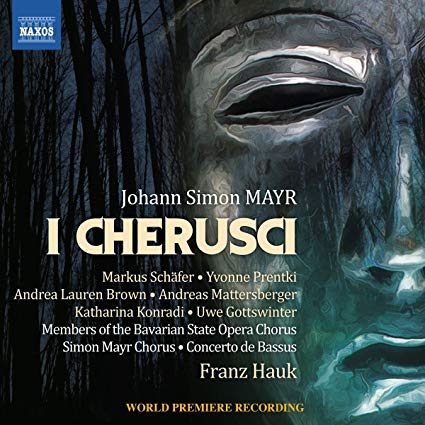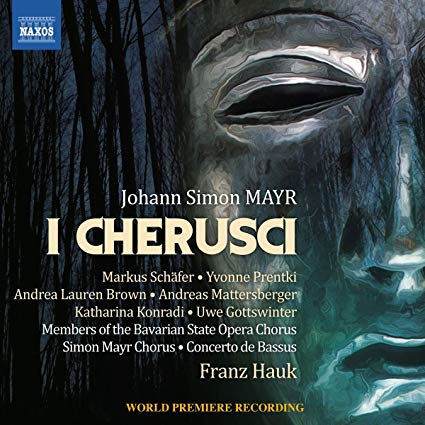Si Max Emanuel Cencic n’avait récemment braqué les projecteurs sur l’Arminio de Haendel, on peut se demander cet éminent personnage historique, roi des Chérusques (17 av.J.-C. – 21 ap.J.-C.), serait encore présent dans les mémoires, surtout de ce côté-ci du Rhin. Ce Vercingétorix teuton avait pourtant fait l’objet d’une série d’échanges franco-allemands. Sous son nom latin d’Arminius, il inspira Georges de Scudéry dès 1643, puis Campistron en 1684, et Biber en fit un opéra en 1691. Le livret écrit en 1703 par Antonio Salvi pour Alessandro Scarlatti en 1703, fut adapté en 1737 pour Haendel. Et c’est peu après qu’Arminius devient, sous le nom d’Hermann, une figure du nationalisme germanique, grâce à Johann Elias Schlegel en 1741, puis Klopstock en 1769, et Kleist en 1808. En 1772, l’illustre Jean-Grégoire Bauvin fait représenter par les Comédiens Français le non moins illustre tragédie intitulé Arminius, ou les Chérusques (adaptation du drame de Schlegel). Et en 1807, Gaetano Rossi y va de son livret, I Cherusci – ou Gli antichi Cherusci – , mis en musique par Stefano Pavesi. A l’opéra, rien ne se perd, et dès l’année suivante, le texte en question est récupéré par le compositeur allemand installé en Italie Giovanni Simone Mayr. Et voilà comment Naxos publie aujourd’hui une intégrale de ces Cherusci, poursuivant vaillamment son entreprise de défense et illustration du chaînon manquant entre Mozart et Rossini.
Chaînon manquant, ou peut-être plutôt maillon faible, car Mayr est un très bon faiseur, davantage qu’un génie comme les deux grands entre lesquels il s’inscrit. I Cherusci fut créé en 1808 au Teatro Argentina de Rome, qui entrerait dans l’histoire musicale huit ans plus tard pour avoir accueilli la création du Barbier de Séville ; Rossini est alors encore un inconnu, mais Mayr compose dans l’atmosphère où s’épanouira bientôt le cygne de Pesaro. Mort depuis une bonne quinzaine d’années, Mozart reste la référence, surtout pour un Allemand, et Mayr ne se gêne pas – une fois de plus – pour emprunter au divin Wolfgang telle ou telle phrase mélodique : ici, c’est l’introduction de l’air de concert « Ch’io mi scordi di te » qui est citée note pour note, par exemple. Au total, rien d’inoubliable mais un jalon historique, intéressant à connaître pour se rappeler que Rossini n’est pas surgi dans un néant musical. Le livret tourne autour de trois personnages principaux : Treuta, roi des Marcomans ; Tamaro, barde et roi des Chérusques (rôle travesti) ; Tusnelda, fille adoptive d’un Chérusque mais en réalité fille de Treuta et aimée de Tamaro. La belle échappe de justesse au sacrifice, et comme il faut bien un grand-prêtre pour manier le couteau sur l’autel, celui-ci s’appelle Zarasto (non, il n’y a pas de coquille, c’est bien Zarasto, sans R dans la dernière syllabe). Evidement, tout cela est très fantaisiste, le livret utilisé par Haendel étant bien plus conforme aux éléments relatés par Tacite et Strabon, et il n’y a ici ni Arminius ni Hermann, ni aucun de ses ennemis romains (les présenter au public romain comme les méchants de l’affaire n’aurait sans doute pas été une bonne idée).
Le chef Franz Hauk est un défenseur convaincu de Mayr, dont il a déjà gravé plusieurs œuvres lyriques, notamment une récente Saffo. On voudrait qu’il soit un chef également convaincant, mais ses lectures ne semblent hélas guère de nature à insuffler la vie nécessaire à ces partitions. Il faut dire, à sa décharge, qu’il doit s’accommoder des chanteurs dont il dispose, et que ceux-ci n’ont peut-être pas tout à fait les moyens des artistes sur lesquels pouvait compter Mayr. L’inévitable Markus Schäfer est-il vraiment l’homme de la situation ? Dans le rôle du roi, on entend ici l’un de ces ténors d’école allemande qui faisaient jadis des ravages dans La Clémence de Titus : l’interprète s’efforce d’alléger son émission, sans quoi il bascule aussitôt dans un vilain nasillement, mais cela aboutit à faire de Treuta un pleutre qui émet ses aigus en falsetto, là où un chant plus péremptoire serait de mise. Elle aussi déjà présente dans Saffo, Telemaco et quelques autres, Andrea Lauren Brown trouve cette fois les couleurs un rien plus sombres qui conviennent à son personnage masculin, et son timbre se distingue de celui de la prima donna, mais l’italien n’est pas toujours très naturel, surtout dans les récitatifs. Pour un personnage appelé Zarasto, qui devrait être mieux qu’un second couteau, on imaginerait volontiers une voix plus grave et plus sonore que celle d’Andreas Mattersberger. Heureusement, l’héroïne autour de laquelle s’articule toute l’intrigue bénéficie avec Yvonne Prentki d’une titulaire de qualité, parfaitement capable de toute la virtuosité exigée par des airs où, en quelque sorte, le Rossini à venir se souviendrait de « Martern aller Artern ».
On saluera donc le courage du label Naxos, même s’il est donc vraisemblable que Medea in Corinto reste longtemps la seule œuvre de Mayr parfois montée par les théâtres.