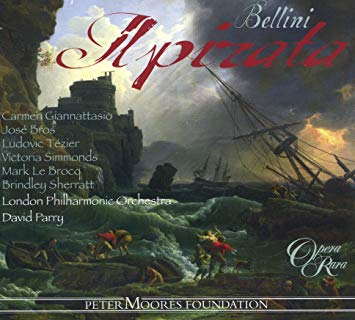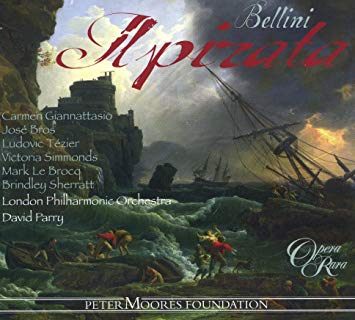Premier triomphe de Vincenzo Bellini, Il Pirata n’a jamais réussi à s’imposer aussi durablement que des ouvrages comme Norma ou I Puritani, sans parler d’I Capuleti ed i Montecchi, moins inspiré que les deux précédents mais autrement plus facile à monter. Plusieurs raisons viennent expliquer cette relative discrétion. D’abord, le livret ne permet aucun développement dramatique d’importance : quand notre pirate débarque sur la côte, son ancien amour (Imogène) est dorénavant mariée et mère ; il ne lui reste qu’à attendre la fin du second acte pour se suicider, en alternant au passage des comportements très agités (menacer de tuer l’enfant, supprimer le mari). En son for intérieur, Imogène doit sans doute se féliciter d’avoir échappé à un tel fou-furieux. Ensuite, la musique est écrite pour des gosiers exceptionnels, pratiquement impossible à réunir. Créateur du rôle de Gualtiero, Giovanni Rubini offrait un mi bémol dès l’air d’entrée (la partition publiée abaisse l’aria d’un demi ton) : il sera le premier Arturo d’I Puritani quelques années plus tard. A ses côtés, Henriette Méric-Lalande avait déjà été la créatrice d’Il Crociato in Egitto de Meyerbeer et sera celle de la Lucrezia Borgia de Donizetti. Antonio Tamburini sera quant à lui le baryton le plus célèbre de son temps, aussi à l’aise dans le répertoire dramatique (création d’I Puritani) que comique (création de Don Pasquale). Il aura même droit à une parodie par Offenbach dans Monsieur Choufleuri. La musique, enfin, en partie recyclée d’ouvrages précédents, n’atteint qu’occasionnellement les sommets des chefs-d’œuvre de la maturité.
La discographie est à la hauteur de ces difficultés. Elle est surtout servie … par les pirates. Ceux-ci sont dominés par l’interprétation de Maria Callas au Carnegie Hall (malheureusement mal entourée). Dans une approche moins dramatique mais plus élégiaque, Montserrat Caballé y est au sommet de son art (là encore, les partenaires ne sont pas au niveau). Au studio, on retrouve Montserrat toujours mal servie. Il faut attendre les années 90 pour entendre un ténor digne de l’enjeu avec Stuart Neill, dirigé par le regretté Marcello Viotti : cette fois, c’est Lucia Aliberti qui n’est pas à sa place.
Dans un tel contexte, la parution de l’enregistrement d’Opera Rara, connu pour le soin et le scrupule apporté à ses réalisations, était particulièrement attendue. A défaut d’être exceptionnel, le résultat a le mérite de l’homogénéité. José Bros campe un Gualtiero de fière allure, au chant soigné, combinant les accents virils et la science belcantiste. Bien capté par les micros, le timbre perd certaines nasalités que l’on peut ressentir à la scène, mais le timbre reste un peu blanc. L’enregistrement vient malheureusement un peu tard dans la carrière du ténor : on sent quelques tensions dans l’extrême aigu, le contre-ré est à peine esquissé, les variations des reprises sont ornées dans le grave ou le medium, ce qui se révèle au global un peu frustrant. A ses côtés, la jeune Carmen Giannattasio campe une belle Imogène, avec ce qu’il faut d’investissement dramatique et une belle technique belcantiste. Le phrasé est impeccable, les variations de couleurs subtilement adaptées à la caractérisation du personnage. On note également une virtuosité certaine dans les vocalises. Néanmoins, l’instrument ne possède pas la largeur nécessaire pour ce rôle, ce qui conduit la chanteuse à gonfler artificiellement sa voix à plusieurs reprises (on sait ce que ça a donné chez Lucia Aliberti). Au studio, son Imogène convainc, mais à la scène il en serait autrement. Ludovic Tézier ne manque pas non plus d’arguments belcantistes : le timbre est superbement capté, le legato parfait, complété par une authentique science de la coloration. Le chanteur se retrouve toutefois en difficulté dès que la virtuosité est sollicitée : variations et suraigus ne sont pas son fort et si la vocalisation reste correcte, c’est avant tout parce qu’elle est prudente. A la tête du London Philharmonic Orchestra, David Parry défend cette musique avec passion, soutenant l’intérêt de l’ouvrage même dans ses passages les plus faibles. On regrettera néanmoins des percussions souvent trop appuyées qui viennent plomber les morceaux les plus vifs. Particulièrement motivé, le Geoffrey Mitchell Choir est également impeccable.
Comme d’habitude, le coffret est d’une présentation très soignée et les commentaires de Benjamin Walton très instructifs, mais un peu trop concentrés sur les sources littéraires du livret. Compte tenu de l’indigence de la discographie, ce nouvel enregistrement se place sans problème en tête de celle-ci. Pour imaginer une version idéale, on se tournera vers les enregistrements live de Callas et Caballé, mais pour apprécier la partition dans son ensemble, cette édition est absolument indispensable.