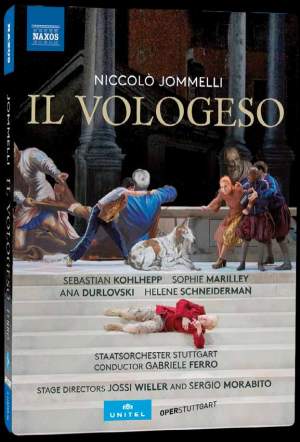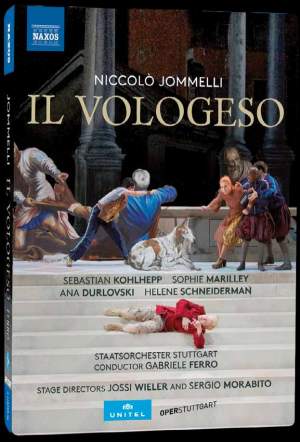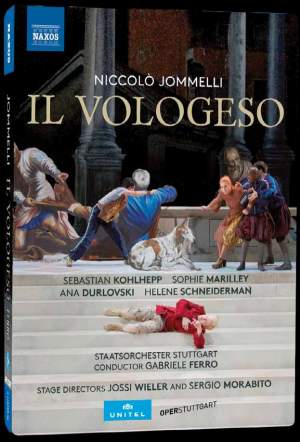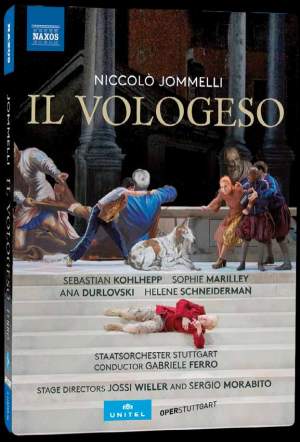Frieder Bernius avait, le premier, transcrit et enregistré intégralement l’ouvrage, il y a vingt ans, avec de remarquables solistes, servi par une prise de son de studio, qui n’a pas pris la moindre ride. Gabriele Ferro lui donne maintenant toute sa force dans une réalisation scénique opportune, se voulant au plus proche du manuscrit, sans ajout ni coupure.
Preuve de l’immense succès des livrets de Zeno, celui que Jommelli avait mis en musique une première fois sous le titre de « Lucio Vero » aura été illustré par plus d’une cinquantaine de compositeurs, de Sala à Sacchini, sous des titres variés. Lorsque notre compositeur y revient, douze ans après, en 1766, il l’appelle « Il Vologeso », délaissant l’allégorie pour la réalité humaine et l’épaisseur psychologique de ses personnages. Malgré sa longueur, la qualité du livret comme celle de la musique de Jommelli nous captivent. Pas moins de seize airs, des ensembles superbes, des récitatifs animés, la continuité du tissu musical paraît plus aboutie que dans nombre d’ouvrages célèbres, bien que postérieurs, et témoigne de l’art consommé de Jommelli. C’est particulièrement vrai de toute la fin du troisième acte, avec un finale aussi juste et puissant que celui des grands ouvrages de Mozart. On en oublie le caractère conventionnel. Un sextuor avec chœur « Al mare invitano placide l’onde » précède une page orchestrale de toute beauté.
Jommelli passa 16 ans à la cour des ducs de Wurtemberg, à Stuttgart, où il écrivit ses derniers chefs-d’œuvre, dont l’Armida abbandonata, de 1770, enregistré par Christophe Rousset. Le manuscrit est conservé à la bibliothèque du Land de Württemberg. C’est là qu’il faut chercher la raison de cette recréation in situ.
Si le livret était familier à tous les amateurs d’art lyrique du XVIIIe siècle, il est maintenant nécessaire d’en rappeler la trame. Bérénice est partagée entre deux hommes : Lucio Vero, le Romain, vainqueur de Vologeso, roi des Parthes, supposé mort au combat. Simultanément, Lucio Vero est tiraillé entre Bérénice et Lucilla, la fille de Marc-Aurèle dont le mariage devrait lui faciliter la succession et l’accès au trône. Ajoutez deux confidents, rivaux, Flavio, choisi par l’empereur pour sa fille, et Aniceto, qui en est épris, et vous aurez tous les ingrédients de l’action. La richesse des situations permet au compositeur de faire valoir tout son génie mélodique et dramatique, avec les expressions lyriques les plus variées. On comprend pourquoi son oeuvre, abondante, suscita l’admiration du Padre Martini, de Métastase comme de Mozart et de nombreux contemporains.
Jossi Wieler et Sergio Morabito signent une mise en scène efficace : un décor unique, à l’antique, façon Véronèse ou le Titien, se peuplera progressivement de figures muettes empruntées à la peinture italienne de la Renaissance, qui disparaîtront au dernier acte. Couleurs et formes des costumes se marient au décor, tous deux signés Anna Viebrock, servis par des éclairages sobres, bienvenus, appropriés aux climats. Ainsi, la scène nocturne où Vologeso chante sa confiance et sa joie retrouvées « Ah, sento che in petto », et surtout le magnifique finale, avec son contre-jour. Vologeso est amputé du bras gauche et Aniceto borgne, ce qui, d’emblée, permet de les différencier des autres protagonistes. On s’interroge sur la direction d’acteurs comme sur certains costumes. Durant l’ouverture, les chanteurs troquent leurs vêtements sportifs, pour des habits de scène qui mêlent les accessoires contemporains aux tenues Renaissance. Procédé convenu, purement gratuit, sinon négatif, dont on s’étonne qu’il soit encore usité. Sans surprise, Ils les retrouveront au finale. Les chanteurs occupent non seulement l’espace scénique, mais aussi, parfois, l’orchestre et les premiers rangs. Les personnages, en dehors de Vologeso, ne trouvent leur épaisseur psychologique que durant les deux derniers actes. Les récitatifs sont animés à souhait, le plus souvent réussis malgré cette direction d’acteur outrée qui sonne faux plus d’une fois (trivialité de Luciano Vero, minauderies de Lucilla, simulacres de boxe d’Aniceto et Vero, le premier se livrant ensuite à un massage du dos du second…).
Lucio Vero, ténor, est confié à Sebastian Kohlepp, aux aigus aisés, d’un joli timbre, à l’articulation exemplaire, auquel on pourra préférer Lothar Odinius, chez Bernius. La mise en scène en fait un personnage un peu falot, qui papillonne autour de deux jeunes femmes, sans grande profondeur psychologique avant le dernier acte. Le premier air « Luci belle » séduit, mais il faut attendre un air de fureur « Sei tra’ ceppi e insulti ancor ? », puis l’incertitude traduite par sa cavatine « Che farò » pour que le personnage devienne crédible, donc émouvant. Après Luciano Vero, Berenice – Ana Durlovski – est la plus sollicitée, non point tant par sa participation aux arias et ensembles, équivalente à celle des autres premiers rôles, mais par l’abondance des récitatifs, de la première à la dernière scène. Ses airs « Se vive il moi bene », dramatique, puis « Tu chiedi il mio core » , contrasté, sont poignants. Cependant son jeu, ambigu, laisse parfois songeur, jusqu’à son air « Ombra che pallida » et au dénouement, où elle est admirable. Gabriele Rossmanith, qui avait enregistré le rôle avec Bernius, se distinguait par la pureté, la fraîcheur de son émission. Helene Schneidermann avait déjà chanté Lucilla dans cette distribution. Les moyens vocaux sont toujours là, l’agilité comme la conduite. Mais le temps a fait son œuvre et la jeunesse, la fraîcheur, bien présents à l’orchestre, font maintenant défaut à son air « Tutti di speme ». Son jeu, dramatiquement outré ne convainc qu’à moitié. Sophie Marilley chante Vologeso, elle est Vologeso. La force de ce beau mezzo comme celle de son jeu emportent l’adhésion. Chacune de ses interventions retient pleinement l’attention. La voix est égale dans tous les registres, avec une projection et une qualité de diction exemplaires. Excellente comédienne, elle donne à son personnage une vérité singulière. Dès son premier air de vengeance « Invan minacci », elle a les accents dramatiques de son rôle. L’expression n’est pas moins juste dans « Ah, sento che in petto », où elle trouve le moyen de se réjouir de son sort, peu enviable. Dans son premier air « Crede sol che a nuovi », Flavio, Catriona Smith, est affligé d’un vibrato aussi exagéré que ses tremblements. Sinon, elle remplit honnêtement son contrat. Aniceto, le conseiller borgne, est Igor Durlovsky. Solide contre-ténor, agile, il joue à Leporello auprès de son maître, avec la même insouciance provocatrice.
L’orchestre est moderne mais l’esprit est bien là, sinon les couleurs originales. Signalons la superbe page orchestrale conclusive, délicate, ciselée, puis puissante et jubilatoire. Les bois et les cors sont agiles et clairs, les cordes réactives sous la direction attentive de Gabriele Ferro. Il impose une vie orchestrale indéniable, dès l’ouverture, enlevée. L’orchestre, précis, engagé, a tout assimilé du style. Le continuo des récitatifs secco (avec le piano-forte) est appliqué, d’une fonction purement utilitaire. Dommage, même si la qualité des accompagnements orchestraux fait vite oublier ce jeu scolaire. La prise de son, distante, manque ponctuellement d’équilibre, privilégiant parfois l’orchestre, au proscenium, aux voix, en retrait.
Un témoignage intéressant, servi par des interprètes de qualité, mais dont la restitution dramatique et sonore est quelque peu inaboutie. Le sous-titrage est réalisé en six langues, dont le français.