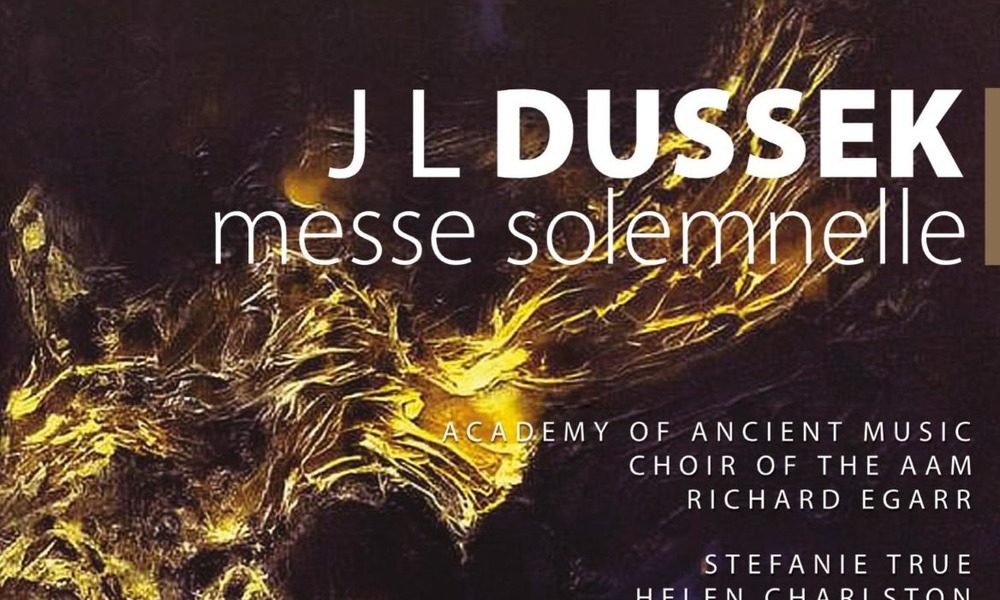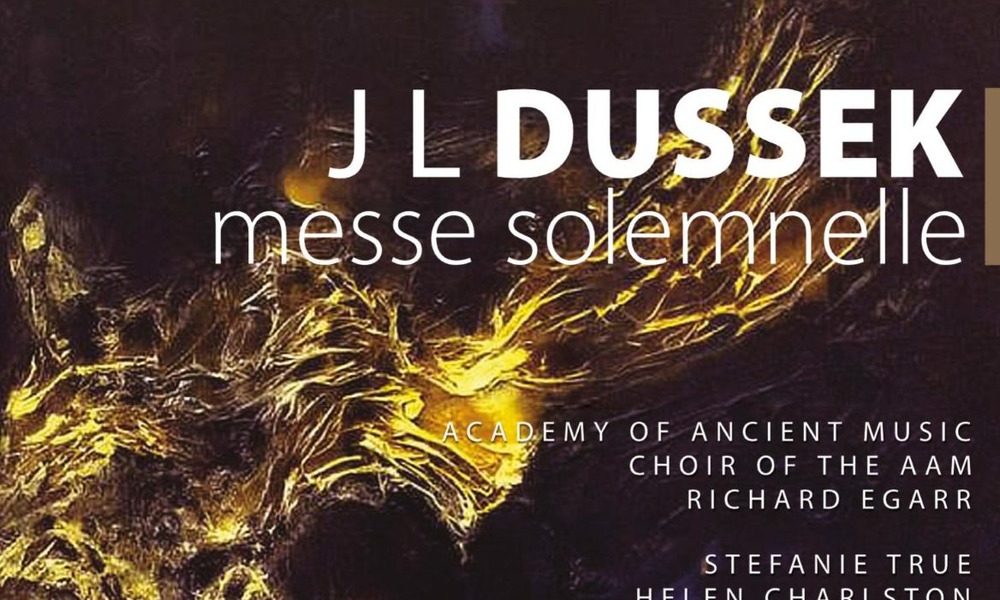Que savons-nous de Jan Ladislav Dussek (1760-1812) ? Pas grand-chose certes, même si nous avons malmené quelques-unes de ses sonatines quand on nous posa devant un piano, il y a pas mal de lustres. Une sombre et belle sonate de lui, préromantique à souhait (n° 24, 1806-07, en fa dièse mineur, op. 61, avec un superbe premier mouvement Lento patetico) dans un récent disque de Jean-Efflam Bavouzet, autour des contemporains de Beethoven (The Beethoven Connection, chez Chandos) est venue compléter une discographie pianistique non négligeable (Andreas Staier notamment s’est intéressé de longue date aux sonates et aux concertos). Mais enfin, il faut l’avouer, nous ne pensions pas à Dussek tous les jours.
Richard Eggar vient nous démontrer que c’était un grand tort avec une Messe Solemnelle, inconnue puisqu’inédite, somptueusement éditée par The Academy of Ancient Music.
Le plaisir de vivre
Dussek (ou Dusik) fut l’un des plus célèbres pianistes-compositeurs de son temps. Né en Bohème d’une famille de musiciens, on l’entendit dans les Pays-Bas autrichiens, à Hambourg (où il rencontra CPE Bach), Saint-Pétersbourg, et enfin Paris. Son talent et son physique agréable (on l’appelait « le beau visage ») lui valurent d’être apprécié de Marie-Antoinette. Il semble avoir mis à profit ses attraits et fait des ravages parmi les harpistes et les chanteuses au cours de ces années, qui, à en croire Talleyrand, étaient celles du plaisir de vivre.
Fuyant juste à temps la Révolution, il épousa à Londres une soprano, Sophie Corri, fille de l’éditeur Domenico Corri, auquel il s’associa. Leur maison d’édition fit faillite, il s’exila afin d’éviter la prison pour dettes, retourna à Hambourg avant d’entrer au service du prince Louis-Ferdinand de Prusse (à la mémoire duquel il composa la sonate élégiaque évoquée plus haut). En 1807, revenu pour toujours en France, et s’accommodant de l’Empire, il entra au service de Talleyrand, justement. Sa taille s’était considérablement arrondie, son beau visage n’était qu’un souvenir, et sa mélancolie lui inspirait des improvisations qui faisaient soupirer d’extase ses auditeurs.
Un manuscrit au bois dormant
Richard Eggar raconte qu’il avait trouvé mention dans une biographie de Dussek d’une certaine « Messe Solemnelle à quatre voix et Grand Orchestre Composée pour Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Nicolas Esterhasy » (sic). Sachant qu’Haydn et Beethoven (la Messe en ut, 1807) avaient eux aussi composé pour la fête du prince des œuvres non négligeables…, le chef anglais se mit en recherche et découvrit un manuscrit impeccable à la Bibliothèque du Conservatoire de Florence. L’œuvre, jouée à Esterhaza en 1810 ou 1811, n’avait plus jamais résonné depuis lors.
Les illustrations du luxueux (et très instructif) livret accompagnant l’enregistrement témoignent de la beauté de ce document, qui n’attendait que d’être ramené au jour. Quant à cette musique, le chef et claveciniste anglais y voit un témoignage typique de l’art de Dussek : coloré, dynamique, flexible, fertile en harmonies et modulations inventives, avec un goût marqué pour des effets d’orchestration dramatiques. Bref, estime-t-il, le personnage tient honorablement son rang, lui qui a pour contemporains Haydn, Mozart et Beethoven…
Entre baroque et romantisme
Le Kyrie se présente comme un vaste portique de quinze minutes, divisé en quatre parties. Si le premier Kyrie pourra apparaître comme une entrée en matière quelque peu académique, le Christe commencera à éveiller l’intérêt : c’est un duetto entre la soprano Stéfanie True (parfois un peu acide) et le ténor Gwilym Bowen, sur le tapis intime d’un petit effectif (belles cordes caressantes) ; un bref retour du Kyrie initial lancera une double fugue, – et là on aura le sentiment que les choses sérieuses s’installent : accélérations, voire embardées, du tempo, mordantes réponses des cors, puis de trombones grandioses, et surtout monumentalité de la construction, la fin très opératique donnant le sentiment qu’on est passé du monde baroque au monde pré-romantique.
Le Gloria, en quatre parties également, est lui aussi tout en surprises théâtrales, Dussek fait alterner les fanfares ardentes du Gloria in excelsis deo à la douceur attendrie du Et in terra pax, le chœur à quatre voix caracolant à souhait. Le Qui tollis sera confié aux quatre solistes, la mélodie se fera plus tendre, presque sentimentale, on sera à l’opéra. Le Quoniam donnera d’abord l’impression de retomber dans l’académique, en tout cas dans l’attendu, mais on comprendra en avançant que le rusé Dussek préparait la surprise d’un Cum Sancto fugué, finissant sur un triple canon, subtil entremêlement de rigueur baroque et de lyrisme, avec emballement final du tempo, très réjouissant.
Décidément épris des vastes périodes, Dussek enchaînera par un Credo en six parties. Un fervent Credo confié au chœur, introduira la sensuelle (mais oui !) lamentation du Et incarnatus, avant les fanfares quasi militaires du Et resurrexit. On écoutera d’une oreille distraite Et in Spiritum, romance assez banale, avant le retour du chœur pour le Qui locutus est, et le fugato (d’ailleurs charmant) du Et vitam venturi, qui donneront le sentiment de ressurgir du siècle précédent, mais on admirera la maîtrise avec laquelle Dussek construit d’amples et solides périodes, en s’appuyant sur des thèmes récurrents et un usage régulier d’un style fugué sans lourdeur, peut-être pour se concilier les bonnes grâces d’un auditeur que ses nouveautés pouvait déconcerter.
Le voluptueux début du Sanctus donnera justement l’impression de changer d’époque, et davantage encore les chromatismes du Benedictus, où quelques contrechants de flûte feront songer à Weber. Musique ici parfaitement en accord avec l’esprit de l’époque (1811) où elle est écrite. Trente secondes d’un vigoureux Hosanna fugué feront transition vers un Agnus Dei, aimablement pastoral comme il se doit, et un Da nobis pacem revenant dans le sol majeur initial. D’un esprit néo-classique assumé, ce pourrait être le final apaisé d’un opéra, autour d’un thème unique, varié et modulé sur un tempo modéré, contemplatif et rasséréné, mettant en valeur l’homogénéité et les belles couleurs du chœur de l’Academy of Ancient Music, soutenu ici par de vigoureux appels des cuivres, là par un hautbois songeur.
Le mauvais sujet repenti ?
L’orchestre et le chœur, emmenés d’une main vigoureuse par Richard Eggar, nous semblent au-dessus de tout éloge, rendant justice à la belle palette sonore de l’orchestration. On admirera notamment la virtuosité et la finesse du chœur. Oserons-nous suggérer que les solistes, certes très honorables et distingués, sont d’une retenue toute britannique…
Richard Eggar dit entendre dans le Dona Nobis Pacem l’aspiration d’un ancien Bad-boy (tout est relatif) au pardon et à l’oubli. Quoiqu’il en soit, on doit au chef anglais, et à sa curiosité, la résurrection musicale, servie avec soin et ferveur, d’une bien belle musique.