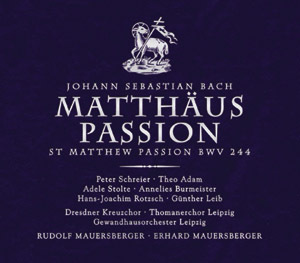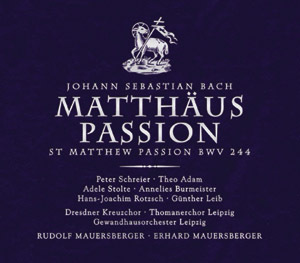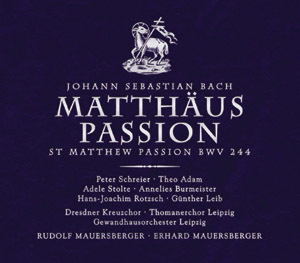Est-il une œuvre mieux représentée au disque ? Il est permis d’en douter puisque plus de 300 enregistrements ont été recensés en un siècle, celui-ci étant le 61e. Cette version est contemporaine de la première que réalisa Nikolaus Harnoncourt avec le Concentus musicus de Vienne. C’est le pur produit de la fine fleur de la R.D.A., où le Dresdner Kreutzchor, le Thomanenchor, le Gewandhaus Orchester étaient emblématiques, tout comme les solistes et chefs rassemblés pour la circonstance. Au même titre que Brecht, Bach – et Schütz dans une moindre mesure – étaient les fleurons du régime, alors qu’Eisler était boudé, malgré les honneurs officiels. La radio diffusait, en direct, une cantate par dimanche, qui prenait place dans la retransmission de l’office luthérien (rééditées chez Berlin Classics). Bien que les moyens mobilisés aient été considérables, des chœurs, de l’orchestre et du grand nombre de solistes, le discours reste toujours intelligible, les lignes claires, les interjections surprenantes de force.
La direction est partagée entre les deux frères Mauersberger, Rudolf et Erhard, tous deux ayant passé leur vie à célébrer Dieu à travers Schütz et Bach, dans le cadre liturgique avant même le concert. Cet enregistrement constitue le chant du cygne de l’aîné, qui devait disparaître un an après. Il avait formé Peter Schreier et Theo Adam. La lecture est forte, puissante et douloureuse, sans tomber dans le dolorisme qu’appellent certaines pages. Evidemment les instruments modernes du Gewandhausorchester de 1970 et leur jeu sont très loin de ce que la renaissance baroque nous a permis de retrouver. Par contre les chœurs n’ont pas pris la moindre ride. On est en droit de s’interroger sur la pertinence de confier le cantus firmus du chœur d’ouverture à des voix d’enfants. Personne ne doutait alors de l’authenticité de la pratique. Mais force est de reconnaître que les petits chanteurs du Thomanenchor sont difficilement surpassables. Il en va de même des deux chœurs, où les voix de Dresde et de Leipzig rivalisent de maîtrise, de conduite des lignes, de projection, pour nous donner une version chorale de première grandeur. Le parti pris de chanter les chorals de façon accentuée, syllabe par syllabe, peut déranger, comme les tempi retenus. Mais on ne peut nier leur adéquation au texte et à leur fonction, ni à leur fidélité à plus de trois siècles de luthérianisme. Les moments les plus dramatiques, les chœurs de turba, sont illustrés avec brio (« Sind Blitze, sind Donner… »), mais la texture instrumentale ne suit pas. C’est très germanique, puissant, fervent, mais parfois pâteux ou pesant.
Combien d’Evangélistes Peter Schreier a-t-il chantés ? Plus d’une dizaine enregistrés avec Abbado (1969 et 1997) en passant par Karl Richter (71 & 79), Karajan (71), et d’autres, moins célèbres. Combien de fois a-t-il dirigé cette Passion, depuis 1984 ? Seuls les spécialistes le savent, mais tout amoureux de Bach l’a écouté à de multiples occasions. Certainement l’un des plus grands dans cette fonction narrative et dramatique. Les récitatifs sont animés, toujours justes. En Jésus, on peut préférer tel ou tel à Theo Adam, mais on ne peut nier la qualité de son chant, humain, chaleureux et émouvant. Les quatre solistes auxquels les airs et récitatifs sont confiés ne déméritent jamais. Des solistes on retiendra le soprano quasi infantile d’Adele Stolte par sa fraîcheur d’émission (« Ich will dir mein Herze schenken » respire la félicité). Anneliese Burmeister, aux couleurs ternes, est néanmoins émouvante. Hans-Joachim Rotzsch, à l’émission franche, bien projetée, est un remarquable ténor (« O Schmerz… »). Quant à Günter Leib, ses récits et airs sont honorablement conduits.
Si le tempo du chœur d’ouverture paraît approprié, où la perception des deux chœurs est claire, l’articulation instrumentale, respectueuse du texte, est timorée. Ce sera la règle durant toute l’œuvre. Cette même retenue affectera l’ensemble des soli instrumentaux, qui datent dans leur émission comme dans leur conduite, très en retrait par rapport aux voix. La vigueur est chichement mesurée (flagellation des cordes du « Erbarm es Gott », par exemple). Autant les interjections de la foule sont spectaculaires, projetées à souhait, autant l’orchestre reste compassé.
Soignée, mais datée, cette version est un document intéressant, où les nostalgiques de leur enfance – associée aux Grossman, à Karl Richter et autres interprètes alors adulés – retrouveront des accents chargés d’émotion.