A supposer même que Puccini soit vériste, cela signifie-t-il qu’il faille nécessairement présenter ses opéras avec un réalisme absolu ? La vérité humaine des sentiments impose-t-elle un cadre en tous points fidèle à une certaine réalité terrestre ? Si l’on exclut l’option extrême que constituait le voyage sur la lune proposé à Bastille par Claus Guth, la production londonienne de La Bohème créée en septembre 2017 occupe un juste milieu entre Zeffirelli et Carsen, entre la reconstitution historique de l’un et l’abstraction poétique de l’autre. Richard Jones a eu l’intelligence de proposer un spectacle qui respecte les données du livret tout en l’envisageant d’un œil d’aujourd’hui. Déjà en 1896, l’époque Louis-Philippe était loin de Puccini, et il ne pouvait en avoir qu’une vision déformée par la rétrospection. En ce début de XXIe siècle, nous sommes encore plus loin des années 1830, d’où peut-être le regard un peu plus distancié qu’il est permis d’avoir. Les décors (mobiles) et les costumes ancrent bien l’action dans le Paris du XIXe siècle, celui des passages couverts chers à Walter Benjamin, un Paris stylisé, autant Second Empire que monarchie de Juillet, peut-être, un Paris des crinolines tel que l’imaginaient les Ballets Russes à la même époque que Puccini, revisité par Léon Bakst pour Carnaval ou La Boutique fantasque. La mansarde est réduite à une sorte d’épure architecturale, charpente parfaitement symétrique où une échelle donne directement accès à ces « cieli bigi » où Rodolfo regarde fumer les cheminées. Au troisième acte, le plateau nu où tombe la neige accueille tout juste la baraque où Marcello peint la façade. Il n’en faut pas plus pour ravir les yeux et pour que le spectateur redevienne le grand enfant qu’il aspire secrètement à être à l’opéra.
Sur le plateau, la jeunesse des interprètes et leur adéquation aux rôles est une égale source de satisfaction, à l’exception de Luca Tittoto qui ne semble pas être la véritable basse qu’on aimerait entendre en Colline. Cocorico : Schaunard est interprété par un Florian Sempey aussi truculent qu’à son habitude, et l’on peut penser qu’il ne tardera pas à délaisser les habits du musicien pour endosser ceux du peintre. Pour l’heure, Marcello trouve en Mariusz Kwiecień un titulaire totalement convaincant, fougueux comme il sied, et au timbre charmeur. Dans un rôle qui n’excède en rien ses moyens, Michael Fabiano se montre très à l’aise, Rodolfo rigolard durant tout le premier acte, avec autant de soleil dans la voix que l’exige ce répertoire. Quant aux dames, on se rappelle peut-être que Nadine Sierra aurait dû être Musetta mais que son forfait obligea la Mimì de la deuxième distribution à reprendre le rôle : en tout cas, Simona Mihai ne fait qu’une bouchée de la volage maîtresse de Marcello, en nous épargnant toute stridence de soubrette. Même si elle évoque plus de prime abord une institutrice anglaise qu’une grisette parisienne, l’Australienne Nicole Car est une Mimì touchante, loin des physiques plantureux auquel on confie parfois la cousette poitrinaire, et vocalement irréprochable. Est-ce la tristesse qu’on devine sur son visage, même lorsqu’il est rieur ? cette Mimì aux yeux bleus suscite une émotion comme on aimerait en ressentir plus souvent au spectacle.
Dans la fosse, Antonio Pappano impulse une formidable énergie à cette représentation menée tambour battant, mettant en valeur une orchestration qui prouve que Puccini était à l’écoute de ce qui se composait ailleurs à son époque. On regrette que le bonus où le chef, au piano, livre dans un langage simple quelques-unes clefs de la partition ne dure que cinq minutes, car on pourrait l’écouter ainsi bien plus longtemps, tant son discours est éclairant et accessible.


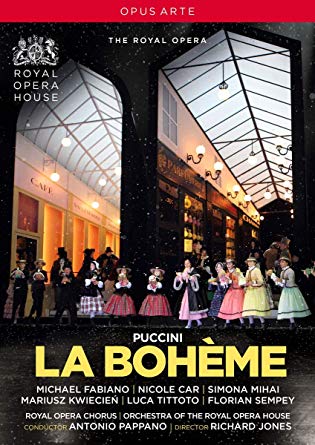
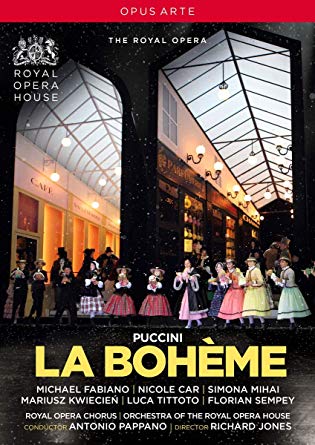


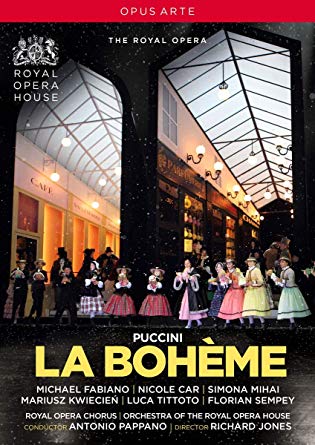

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



