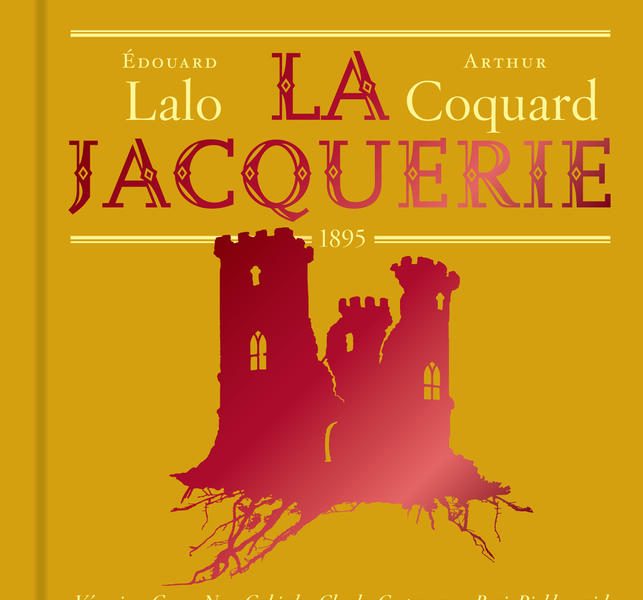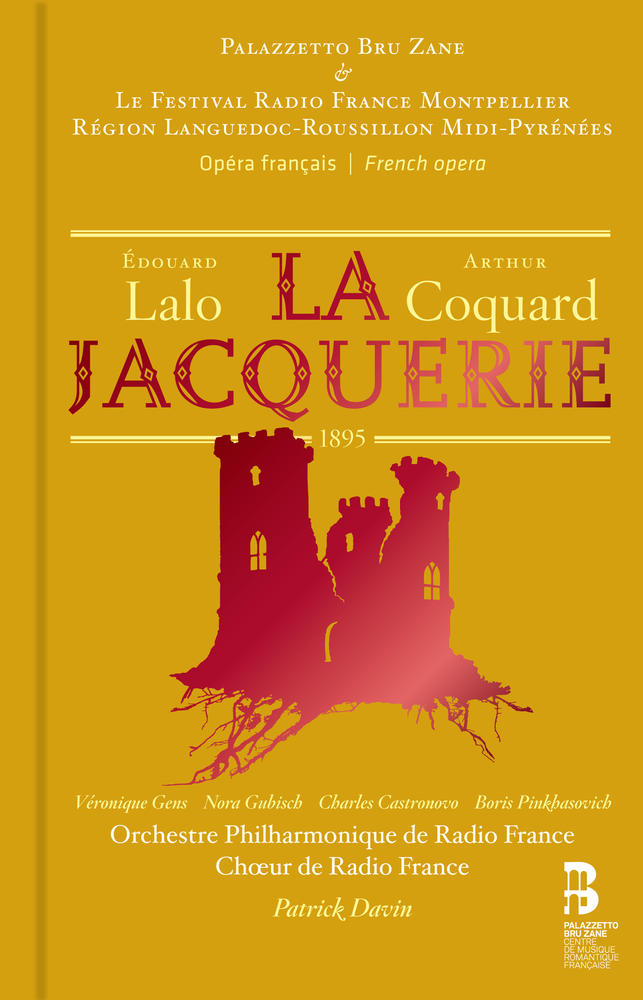Au jeu des résurrections, le Palazzetto Bru Zane a connu quelques réussites éclatantes, et l’on espère que le Dimitri de Victorin Joncières ou le Dante de Benjamin Godard finiront par reprendre le chemin des scènes. On reste un peu plus perplexe, en revanche, face à La Jacquerie, qui aurait dû être le troisième opéra de Lalo, après Fiesque (jamais représenté de son vivant) et Le Roi d’Ys, succès tardif survenu quatre ans avant sa mort. Emballé par le sujet, mais déçu par le livret qu’en tira Edouard Blau, le compositeur n’eut réellement le temps que d’écrire le premier acte, en réemployant beaucoup de matériau venant de Fiesque. Pour « achever » cet opéra à peine commencé sur un livret également laissé en plan, la veuve Lalo sollicita Arthur Coquard (1846-1910). Et là, malgré l’enthousiasme de notre collègue Yvan Beuvard, il nous est difficile d’être captivé par la musique de Coquard. Que ce monsieur ait été un « proche disciple » de Lalo, on veut bien le croire, mais un abîme sépare le bon faiseur du génial concepteur du Roi d’Ys, abîme qui se matérialise dans la différence entre le premier acte et les trois suivants. Au premier acte, même si Gérard Condé n’y voit que « marqueterie », tout avance très vite, tout s’enchaîne, porté par un véritable souffle : c’est bien simple, dans ces scènes où « le peuple » dialogue avec le Sénéchal, on croirait Lalo sur le point d’écrire un Boris Godounov français. Mais aussitôt après, quand Coquard reprend les rênes en mains, le soufflé retombe, et il faut attendre l’ultime duo pour entendre quelques belles phrases un peu plus inspirées. Pour le reste, le disciple « laloïse » de son mieux, pastichant faiblement les chœurs de la ville d’Ys, entre autres, il lorgne plus ou moins discrètement du côté de Wagner, mais on reste sur sa faim et l’on ne voit pas comment ce titre pourrait aujourd’hui susciter l’intérêt du public, malgré le relatif succès que connut La Jacquerie en son temps.
Par ailleurs, les forces en présence ne correspondent peut-être pas exactement aux exigences de l’œuvre. Patrick Davin est toujours très à l’aise dans ce répertoire, il dirige régulièrement Le Roi d’Ys, et l’Orchestre philharmonique de Radio France lui obéit avec de fort belles sonorités, le Chœur dosant ses interventions avec plus de précision que ce n’est parfois le cas. En revanche, la distribution pêche sur quelques points. Boris Pinkhasovich est doté d’un timbre superbe et d’une ardeur admirable, il faut le reconnaître, mais même s’il a nettement progressé sur ce point depuis quelques années, la diction du baryton laisse encore à désirer, avec certaines syllabes parfaitement incompréhensibles (notamment le mot « tuons » lors de sa première intervention). C’est d’autant plus frappant que les seconds rôles, eux, brillent par un français irréprochable : Jena-Sébastien Bou, bien sûr, mais aussi l’excellent Patrick Bolleire et, pour les quelques mots qu’il a à chanter, Enguerrand de Hys. L’autre problème, et l’on a peine à la dire car il s’agit d’une artiste extrêmement attachante que l’on a applaudie dans bien d’autres œuvres, tient au choix de Nora Gubisch pour défendre le rôle de Jeanne : à la création, il fut interprété tantôt par Marie Delna, tantôt par Blanche Deschamps-Jéhin, authentiques contraltos. Dès lors, l’équilibre des voix paraît compromis, les deux personnages féminins étant insuffisamment différenciés : Véronique Gens, proche du Falcon, est une pudique Blanche qui ravit toujours l’auditeur, mais l’on peine trop à distinguer l’amante de la mère lorsqu’un duo les réunit. On se réjouit que, cette fois, Charles Castronovo n’ait été victime d’aucun des empêchements qui nous ont privés de sa présence lors des enregistrements de Cinq-Mars ou d’Olympie : le ténor américain sait donner toute son ampleur épique au héros, meneur de la Jacquerie. Difficile, malgré tout, de voir dans cette œuvre autre chose qu’une curiosité destinés aux admirateurs inconditionnels de Lalo.